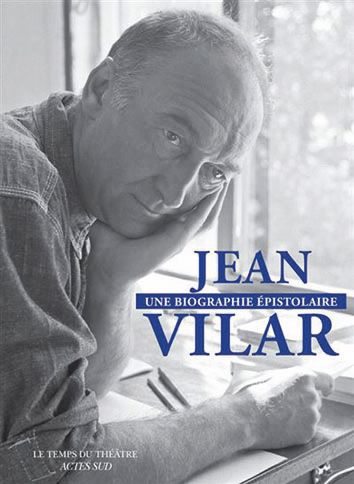Jean Vilar à André Malraux
15 février [1945]
J’ai toujours eu le désir de mettre à la scène une de vos œuvres. Et comme vous m’avez dit, au cours d’une très brève rencontre, que vous n’aviez guère le goût d’écrire pour la scène, j’ai pensé à adapter La Condition humaine, en employant tous les moyens que la scène permet ou exige : depuis le jeu muet (je pense au meurtre commis par Tchen) (sans que ce jeu n’appartienne trop aux conventions du mime) jusqu’à l’utilisation du micro ou du film.
À vrai dire, mon but est de vous suivre presqu’à la lettre. Et plus par les inventions de la mise en scène que par l’adaptation elle-même, celle-ci ne devant être qu’un rigoureux découpage de votre roman. Et pour être plus clair, peut-être, plutôt que de faire une adaptation « en esprit » (et fausse) telle que celle que Copeau a faite pour les Karamazov, suivre l’exemple des Russes adaptant Dostoïevski.
Êtes-vous opposé en principe à toute adaptation scénique de vos romans ? Ne voulez-vous pas me laisser une chance ?
Ne me laissez pas sans réponse et croyez à l’amitié de
Jean Vilar
Jean Vilar à Maurice Coussonneau
Vendredi matin 15 août [1947]
Confidentiel
Cher Maurice,
Fais tout ce qu’il t’est possible au monde, persuasion, douceur, entêtement, pour obtenir un décor pur, sobre et beau, en définitive, pour la pièce de Clavel. Il s’agit en effet de faire admettre au public du festival une pièce qui risque de passer à côté de leur attention ; et non seulement de leur faire admettre cette pièce, et son côté parfois exaspérant, mais de la leur faire aimer. J’ai en définitive, quand j’y réfléchis, plus travaillé sur la pièce de Clavel (lors des répétitions) que sur Richard II en tant que metteur en scène. Fais comme moi : concilie les exigences de Richard II et celles de la pièce de Clavel.
Il faut donc : que le rideau se lève sur un décor pur, sans ceci ou cela de mal agencé dans la toile, de mal peint. Il faut que, à sa façon, le décor ait la noble simplicité de lignes et de couleurs que nous avions si agréablement trouvée, dans un autre genre, au Prieuré. Alors, tout passera.
N. B. : Il faut un bruit d’auto. Cette auto, en pleine réplique de Jean, s’arrête (Jean le dit) au bas de l’hôtel. En bref, le bruit d’une auto que l’on entend venir, croître et s’arrêter assez près, à travers les murs, à vingt mètres (à vol d’oiseau).
Richard II et Tobie et Sara : fais en sorte que les planches ne « craquent » pas. Cela détruirait aussitôt l’illusion de certaines scènes de Tobie.
Est-il possible que les deux plateaux de Richard soient en déclivité légère ?
Je ne te pose aucune question concernant ton activité en Avignon. Prévost m’a tenu au courant, et continuera ainsi. Et, d’autre part, je vais avoir, dès son arrivée à Paris, des nouvelles toutes fraîches.
À moins de nécessité, je crois qu’il vaut beaucoup mieux que tous les rapports entre Avignon et nous se fassent par Prévost. Et d’abord, parce que tu peux la toucher plus facilement que moi. (En son absence, c’est Sabine Boritz ou sa secrétaire qui la remplace.)
J’ai une énorme confiance en ton travail et en notre succès final, au moins artistique. Et c’est pour cela que je ne te donne aucun conseil.
Et très bien d’avoir compris la présence urgente d’Élisabeth [Prévost] en Avignon.
À bientôt,
Jean Vilar
Jean Cocteau à Jean Vilar
Saint-Jean-Cap-Ferrat
3 mars 1951
Mon cher Vilar,
Si vous signez Vilar le fidèle, je puis signer Cocteau le fidèle. Croyez-moi bien, je n’ai pas oublié mes promesses.
Maintenant que j’envisage votre entreprise qui consiste, non seulement à sauver le théâtre, mais encore à enchanter le seul public qui compte, je serai encore plus apte à vous rendre le service que vous attendiez de moi.
Une pièce est longue à naître. Tenez-vous toujours à cet impromptu ?
On pourrait viser plus haut. Je vous serais très reconnaissant de m’écrire le plus vite possible sous quelle forme vous concevez notre entente, ce qui vous plairait, ce qui vous exciterait à mettre debout. En somme, j’aimerais que, dans un coin de votre loge, vous me notiez la pente de notre piste. L’essentiel en ce qui me concerne est de fuir auprès de vous une « élite » morte et de rejoindre ce public du haut qu’est le vôtre et qui vous est toujours fidèle. Salut amical à Gérard.
Je vous embrasse,
Jean Cocteau
Jean Vilar à Gérard Philipe
Sète, 11 août [19]51
Oui, j’ai reçu tes deux lettres.
Ne t’inquiète pas, brave garçon, on fera ce qu’il faut pour que tu sois avec nous dès le départ, puisqu’il semble que tu ne pourrais vivre sans cela.
Tout ce que je souhaite d’ici là, c’est que tu fasses un très beau Fanfan la Tulipe, et que ton metteur en scène se surpasse.
Méfie-toi : tu viens de faire du théâtre sans mesures : ne fourre pas du théâtre dans ton film. Enfin, je me tais, ça ne me regarde pas. Tu peux en parler avec Christian-Jaque : c’est un réalisateur qui saura écouter.
À présent, jeune héros, il faut que tu penses au Menteur. Je crois, oui, qu’il faudrait y penser sérieusement. Pour quand ? Je n’en sais rien encore.
Mais enfin, il faut que tu aies Clitandre dans les bagages avant la trentaine. Merci ! pour nous !
Cela vaut mieux qu’Alfred, je t’assure.
Quant à Supervielle : je connais Robinson. Je ne l’ai pas à Terrisol.
Si tu pouvais me faire envoyer l’édition, ça serait bien. La musique, c’est plutôt au génial [Jacques] Besse qu’il faudrait la demander.
J’ai pensé que peut-être cela pourrait être (revu dans ce sens) le spectacle pour les enfants du Peuple. Et je me demande si avant de jouer devant les parents, il ne vaudrait pas mieux commencer par jouer devant les Domi-Stefy-Criquet populaires.
J’y pense, j’y pense.
L’année a été belle.
Ah, secret absolu. Cocteau finit un Bacchus. Il nous demande de le jouer et à Coco de faire la mise en scène. Si c’est le sujet des Bacchantes d’Euripide (j’attends renseignements), cela peut être très beau. Et toi en Bacchus, c’est assez bien pensé. Je me suppose en Penthée. Attendons.
J’attends sous peu sa quatrième lettre.
Que Christian-Jaque te conserve la grâce et la force, fiston.
Jean
Gérard Philipe à Jean Vilar
[Tampon : Arrivée 17/01/[19]53]
Hôtel Seehof, Arosa
Jean, mon vieux Jean. Je crois que tu n’aurais pas pu me toucher mieux que tu ne l’as fait. Je suis absolument honteux d’avoir laissé se glisser entre nous des relations que j’abomine par ailleurs. Je voudrais cependant que tu me croies : je n’ai pas pu finir cette lettre commencée dans l’exaspération sans que vienne s’y mêler le ton de la plaisanterie… un début de coup de nerfs s’est transformé très vite en blague de collège – mais j’ai trente ans et j’oublie qu’une pirouette de ma part ressemble maintenant plutôt au coup de patte de l’ours qu’à la gracieuse révolution de l’ourson.
J’aimerais que tu me pardonnes, au nom de la réelle admiration que j’ai pour toi. Sans doute aurais-je dû te dire plus tôt combien ta solidité me semble efficace et indispensable. D’autre part, Jean, tu sais combien je suis susceptible quant à Lorenzo. Tu le sais puisque tu as pensé à faire la jonction autour de ces mots que je trouve parfaitement salutaires. Et de penser que cette distribution – demandée depuis si longtemps – ne serait complétée que par une audition tardive m’a hérissé. Et, de là à être malhonnête…
Enfin le chagrin ne demande pas d’explications – c’est de savoir que, dans ton bureau, je t’ai accablé, qui m’a profondément retourné.
Amitiés, Jean.
Gérard
Maria Casarès à Jean Vilar
Avignon, le 6 juillet 1957
Bienvenue dans la noble ville d’Avignon. Majesté ! Gloire et Honneur !
J’espère que le Festival de Marseille s’est déroulé pour votre plaisir, et je fais des vœux chaleureux et légèrement mélancoliques pour celui d’Avignon.
Malgré votre absence, cher maître, je vous ai beaucoup fréquenté ces derniers jours. Dans la chaleur tropicale qui s’est égarée jusqu’à Paris, écartelée sous le soleil aux quatre coins de mon balcon, j’ai beaucoup réfléchi et vous avez souvent occupé mes pensées. Quelques nouvelles capricieuses, des feux follets voyageurs, des coups de téléphone de Williams – charmant, dévoué et bachelier – m’ont ramenée à vous sans cesse ; et enfin, votre livre que j’ai lu enfin, et celui que vous avez bien voulu m’offrir, sur Rachel, sont venus me persuader que, quoi que je fasse, il m’est difficile en ce moment de me détourner de votre auguste personne.
Me voici donc, fidèle un peu malgré moi. Me voici, attentive et disponible.
Ce soir, le vent souffle sur Paris. Un vent d’orage, brusque et dur, brûlant comme le chergui. Je me réveille ! Je ressuscite un peu et je me sens enfin capable d’affronter la face humaine sans être tout entière ébranlée par une colère rouge et noire – colère ancestrale, issue du fond des âges, semblable à l’ire des dieux – qui me serrait la gorge jusqu’à l’étouffement ces derniers jours, à la simple vue de mon prochain.
Pourquoi ? Chi lo sa. Peut-être était-ce seulement un signe annonciateur de l’orage et du vent… Avec les femmes, vous savez, il est difficile d’expliquer, d’avoir recours à la logique ; derrière la bête domestiquée, derrière la plante inspiratrice, derrière tout ce que l’on a pu dire sur elles, il y a ce mystère bouleversant qui fait peut-être la FEMME ou la NADA ; et c’est par ce mystère que nous sommes à la fois mères, épouses, poupées, muses, girouettes et baromètres, à la fois sages et guerrières, vie et mouvement.
Oui.
Je vous informais donc de ma méchante humeur. Une humeur de chien. Je ne pouvais ouvrir la bouche que pour protester, ronchonner, honnir celui ou celle qui osait me demander si j’avais bien dormi, et m’accabler ensuite de reproches pour avoir été aigre et bête. Jamais je n’ai atteint ce degré d’éloquence. J’espère la garder pour m’en servir mieux. Maintenant le vent est là et je m’apprête déjà à la crise d’enthousiasme ; avec la vitalité que j’ai, elle va être foudroyante ; si je m’en sors, je vous raconterai.
Et maintenant, parlons sérieusement.
7 juillet
(...)
a) Projeter le texte dans la salle en le rassemblant et en lui rendant sa grâce.
b) Retrouver la passion qui ronge pour pouvoir ensuite la contenir.
c) Trouver le troisième acte (petit enfer avant le grand du quatrième).
Je crois être sur la bonne voie, mais il faudrait peut-être modifier le comportement extérieur vis-à-vis d’Œnone. Le puis-je ?
d) Retrouver la vitalité, la liberté, le vrai lyrisme, la grâce et pour cela travailler le texte sans cesse. Vous m’avez dit, un jour, que je ne me servais pas assez dans Phèdre du « pouvoir de séduction » que les poèmes de Baudelaire me prêtent parfois. Il y a là quelque chose de juste et de secret que je devine, mais qu’il m’est difficile de saisir quand je dis du Racine. Parlez m’en encore, en essayant de me le faire comprendre « musculairement », et de me le faire glisser ici.
À Strasbourg, à Zurich, j’ai eu l’impression de chercher désespérément à travers chaque alexandrin « l’état » que j’avais égaré par souci de fidélité au texte, et j’ai égaré aussi le texte. Celui-ci ne peut sortir, spontané, libre et dégagé, dans une forme pleine, que s’il est soutenu par « l’état ». Il faut donc l’oublier après l’avoir beaucoup travaillé, et ne pas craindre de dégager ensuite le personnage dans toute son originalité, les mots venant là, seulement pour souligner, dans leur chant simple. Mais il faut trouver le troisième acte ; sans cette charnière je n’aurai toujours pas le personnage, et je retomberai dans le même travers : le rechercher à travers les mots.
Je m’explique encore mal ; je pense donc que je comprends encore mal ; mais parlez-moi de Baudelaire, et j’arriverai à saisir, je crois.
(…)
4°/ De la tradition du théâtre. J’ai été très touchée par ce livre. On vous y retrouve entier, avec la tendresse, une clairvoyance confuse et comme craintive devant l’affirmation. On dirait que vous avez toujours peur que les limites posées par le choix ou l’expression ne viennent abîmer, dénaturer quelque chose de plus profond, de plus secret. Et on y retrouve aussi la volonté sourde, l’entêtement, la ténacité, votre reconnaissance devant la vie, le sage et le farfelu. Ah ! que vous êtes féminin. Mais, un conseil. De temps en temps, feuilletez ce livre. Il est bon, je crois, pour la santé.
L'annotation n'est pas reproduite ici. Se référer à l'ouvrage