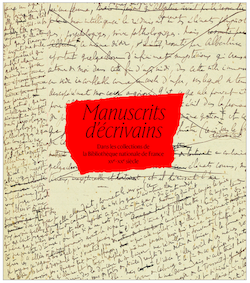Thomas Cazentre, ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de lettres modernes et docteur en littérature française, il est conservateur au département des Manuscrits de la BnF, en charge notamment des fonds Victor Hugo et Roland Barthes. Il est l'auteur de Gide lecteur (Kimé, 2003) et d'articles sur la littérature et la photographie. Il a fait partie des commissaires de l'exposition Été 14, les derniers jours de l'ancien monde (BnF, 2014). Aux éditions de la BnF, il a signé en 2016 deux volumes de la collection L'Œil curieux : Petite Reine. Fous du vélo et Paris 1900. L'exposition du siècle.
Vous êtes conservateur au département des Manuscrits de la BnF. L’ouvrage collectif, Manuscrits d’écrivains, dont vous avez dirigé l’édition et que vous avez préfacé et commenté, paraît le 27 octobre prochain chez Textuel.
Qu’est-ce qui a motivé la publication de ce beau-livre qui contextualise et donne à voir près d’une soixantaine de manuscrits, allant du XVe au XXe siècle ?
Thomas Cazentre Faire découvrir à un public plus large les richesses des collections fait partie des missions de la BnF. Malgré la numérisation massive, le patrimoine écrit ne bénéficie pas de la même visibilité que celui des musées, par exemple ; il est généralement considéré comme le domaine privilégié voire exclusif des chercheurs. Or chaque fois que nous avons l’occasion de présenter des manuscrits à un public non spécialisé, nous constatons un intérêt, une curiosité voire une fascination indéniables. Un livre comme celui-ci, avec une riche illustration et des textes accessibles, répond à cette attente. Les Éditions de la BnF et Textuel avaient consacré en 2018 un volume similaire aux Trésors de la musique classique ; ces Manuscrits d’écrivains prennent en quelque sorte la suite. Ajoutons que la prochaine réouverture, après dix ans de travaux, du site Richelieu enfin rénové, offre une occasion de mettre en valeur les trésors qu’il renferme.
C’est le manuscrit de la première femme de lettres ayant vécu de sa plume, Christine de Pizan (1364-1430), qui ouvre le recueil… Quels ont été les critères de sélection pour constituer ce corpus ?
T.C. Le processus de sélection a été un travail collectif, passionnant et passionné, parfois déchirant. Les critères de base étaient : des manuscrits appartenant aux collections de la BnF, autographes (avec deux seules exceptions, justifiées dans les notices : la Guirlande de Julie et L’Esprit des lois), de textes littéraires (écartant donc en principe les journaux et correspondances, à l’exception des lettres de Mme de Sévigné, qui relèvent pleinement de la littérature), et en excluant les auteurs vivants (pour éviter les conflits de susceptibilité). Ensuite sont entrés en compte divers critères, plus ou moins objectifs : l’importance des textes dans l’histoire de la littérature et des idées, la « présence » des auteurs à notre époque (certains noms qui se seraient imposés il y a trente ans se sont un peu éloignés, et inversement), la photogénie propre des manuscrits… Donner leur pleine place aux auteurs femmes a bien sûr fait partie des exigences, même si, en l’occurrence, tous les noms que nous avons retenus, de Christine de Pizan à Nathalie Sarraute, s’imposaient naturellement. Nous avons aussi voulu mettre en valeur des manuscrits entrés récemment dans les collections (Glissant, Queneau, Pagnol…).
Quelques mots sur les origines de la Bibliothèque nationale de France et l’histoire de ses collections constituées depuis le Moyen Âge ?
T.C. C’est une longue histoire, difficile à résumer ! On fait généralement remonter l’origine de la bibliothèque à la « librairie » personnelle de Charles V, au XIVe siècle, dont certains volumes sont encore dans les collections. Mais la vraie naissance de l’institution a lieu sous François Ier, avec l’instauration du dépôt légal (qui attribue à la bibliothèque royale un exemplaire de tout livre publié en France) et la conservation des collections royales (qui, auparavant, étaient dispersées à la mort de chaque souverain, comme un patrimoine privé). Bibliothèque royale, nationale, impériale… l’institution a traversé les époques et les régimes en restant au cœur de la politique patrimoniale de la France, jusqu’à aujourd’hui. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, la bibliothèque s’enrichit de grandes collections achetées ou offertes, et des « cabinets » spécialisés (des estampes, des manuscrits, des monnaies, médailles et antiques…) sont créés. Les saisies révolutionnaires des bibliothèques aristocratiques et ecclésiastiques enrichissent encore considérablement les collections. Aux XIXe et XXe siècles celles-ci ne cessent de s’accroître, avec l’industrialisation de l’imprimerie et de la presse, et de se diversifier avec les innovations techniques : photographies, enregistrements sonores, films, vidéogrammes, logiciels, jeux vidéo, produits numériques… L’organisation de la bibliothèque suit cette évolution en se métamorphosant sans cesse, et les bâtiments suivent comme ils peuvent, jusqu’à l’ouverture du site François-Mitterrand en 1996. Une longue histoire qui se poursuit aujourd’hui : bibliothèque numérique Gallica, rénovation du quadrilatère Richelieu, création d’un nouveau site de conservation hors de Paris…
Les notions de droits d’auteur et de propriété littéraire s’affirment progressivement au siècle des Lumières. Le statut de l’auteur évolue et la valeur du manuscrit aussi…
T.C. Effectivement. Jusque-là, les auteurs n’étaient pas vraiment reconnus comme producteurs des textes et, à ce titre, possédant sur eux certains droits, moraux et patrimoniaux. Les manuscrits n’étaient généralement pas conservés une fois le texte cédé à un éditeur-libraire et publié. Au XVIIIe siècle s’impose très progressivement, grâce au combat d’écrivains comme Beaumarchais, l’idée qu’un auteur doit être justement rémunéré en tant que créateur de l’œuvre, et qu’il conserve des droits même après la publication : on ne peut traduire, adapter, rééditer ses textes sans son accord, etc. Le manuscrit est la preuve matérielle de cette propriété, et il devient important de le conserver. Parallèlement se développe autour de certains auteurs (Voltaire ou Rousseau, en France) un véritable culte laïc, que la Révolution consacrera, notamment avec la panthéonisation ; dès lors, tout écrit de leur main prend une valeur nouvelle.
La diffusion du livre imprimé efface-t-elle progressivement celle du texte manuscrit ? (Il semblerait que les écrits personnels, pensées ou réflexions demeurent souvent à l’état de manuscrits autographes jusqu’au XVIIIe siècle et sont diffusés sous le manteau pour échapper à la censure.)
T.C. C’est un processus inévitable, mais qui, de l’invention de Gutenberg à l’âge du traitement de texte, a été beaucoup plus progressif qu’on ne le pense généralement. L’imprimé n’a pas « effacé » le manuscrit mais l’a petit à petit marginalisé ; il s’est lentement substitué à lui dans le domaine public — même si la diffusion de textes sous forme manuscrite a été courante jusqu’au début du XIXe siècle, l’imprimerie étant alors un procédé couteux et très surveillé par les autorités — et refoulé dans le domaine privé. De même, le texte manuscrit cesse d’être un produit fini pour n’être plus qu’une étape dans le processus d’élaboration d’un texte, dont l’imprimé devient l’aboutissement naturel.
Avec le Romantisme, le manuscrit est sacralisé et devient « manifestation concrète de la création littéraire ». Le « geste » de Victor Hugo en est un exemple… Cependant, les écrivains, quelles que soient les époques, n’entretiennent pas tous la même relation à leurs brouillons…
T.C. Oui, le Romantisme pousse à son terme l’évolution engagée sous les Lumières en sacralisant l’écrivain comme créateur. Le manuscrit matérialise, sous forme d’encre et de papier, cette puissance créatrice. Il devient une relique et suscite l’intérêt des collectionneurs (bien avant celui des institutions, qui ont souvent un train de retard !). En les conservant et en les léguant à la Bibliothèque nationale, Hugo consacre la patrimonialisation de ses manuscrits. Mais effectivement tous les écrivains ne le suivent pas dans cette démarche. Si la plupart des auteurs, à partir du milieu du XIXe siècle, conservent plus ou moins scrupuleusement leurs manuscrits comme un héritage à transmettre, certains (de Baudelaire à Sartre et Foucault) les détruisent ou les perdent, pour des raisons difficiles à éclaircir : indifférence, superstition, volonté d’effacer les traces de leurs recherches ou de leurs hésitations pour ne laisser subsister que le texte achevé… D’autres les offrent à leurs proches (Camus)… ou les vendent à des collectionneurs (Gide, Valéry…).
On voit dans ce recueil combien les manuscrits sont riches d’enseignements sur l’œuvre en cours, révélant la singularité de chaque écrivain, permettant de comprendre comment s’est élaboré un texte, d’explorer les variations, les rejets et évitements, d’en étudier la genèse, notamment grâce à divers éléments matériels (pigments de l’encre, couleur du papier, entêtes, etc.)…
T.C. C’est même une vraie branche des études littéraires, apparue dans les années 1970, qui a ses chercheurs spécialisés et ses laboratoires : la critique génétique, qui envisage les œuvres non comme des aboutissements fixes et immuables, mais comme des processus. Les manuscrits, quand ils sont conservés, sont le matériau de base de cette approche. Des auteurs comme Flaubert ou Proust ont laissé des mines presque inépuisables d’ « avant-textes » à explorer (brouillons, plans, notes, versions successives d’une même page…) ; chez Zola, le manuscrit de chaque roman est accompagné de tout un dossier méthodique ; de même chez Perec, où il s’agit quasiment d’un mode d’emploi indispensable à la compréhension profonde du roman ; chez Huysmans, la quête du mot rare se traduit par de multiples ratures. Chez d’autres au contraire (Saint-Simon, Sand) le texte semble couler de source et naître aussitôt dans sa forme quasi définitive. Quant à la matérialité des manuscrits, elle apporte certes des informations sur le processus d’écriture, mais trahit aussi la vie sociale et professionnelle de l’auteur : les cahiers d’écolier de Radiguet, les papiers récupérés chez leurs employeurs respectifs par Vian (Association française de normalisation), Huysmans (Ministère de l’Intérieur), Giono (Comptoir d’escompte), les papiers à lettre d’hôtels ou de compagnies maritimes (Aragon, Malraux)…
N’y-a-t-il pas toujours une part de l’œuvre qui se dérobe à tous les modes d’approches (que ce soit l’analyse génétique, psychanalytique ou structurelle) ?
T.C. Bien sûr, et heureusement ! Les manuscrits nous font entrevoir le processus créatif, mais ne nous en donnent pas toutes les clés. Pourquoi l’auteur a-t-il substitué tel adjectif à tel autre, raturé cette phrase, ajouté ce paragraphe, rebaptisé ce personnage… On peut élaborer des hypothèses, c’est un jeu stimulant, mais on se heurte forcément à une part inaccessible, y compris pour les auteurs eux-mêmes, qui seraient souvent bien en peine d’expliquer pourquoi ils ont fait telle ou telle retouche : il y a une grande part d’intuition, d’oreille… Les manuscrits nous donnent à voir le travail parfois acharné que constitue la création littéraire, mais aussi sa fragilité, avant que l’imprimé ne fige l’ordre des mots. C’est un changement de perspective passionnant.
Parlez-nous des enluminures médiévales et contemporaines (collaboration de Vieira da Silva et René Char, par exemple), des dessins ou peintures qui accompagnent l’écriture manuscrite…
T.C. Notre parcours commence à la fin du Moyen Âge, peu avant l’invention de l’imprimerie. Le manuscrit est alors un produit fini, un livre dont l’exécution est confiée à des professionnels : copistes pour le texte, enlumineurs pour l’illustration des manuscrits de luxe. Christine de Pizan, qui supervise la réalisation de ses manuscrits et y met parfois la main, ce qui est exceptionnel à l’époque, se fait représenter en train d’écrire, en tête du volume. Cet art du manuscrit illustré, encore prestigieux à la Renaissance et à l’âge baroque comme en témoigne la Guirlande de Julie, se perd ensuite face au règne de l’imprimé. Mais à l’époque moderne, on voit parfois resurgir ce souci d’embellir un manuscrit par des images : Hugo fait ainsi relier de somptueux dessins de sa main dans le manuscrit des Travailleurs de la mer. Le cas des manuscrits de René Char, confiés par le poète à la libre inspiration de peintres (Vieira da Silva, mais aussi Picasso, Léger, Braque…), pour faire dialoguer les deux langages, est tout à fait exceptionnel. On est là plus dans le modèle moderne du livre d’artiste que dans la tradition médiévale. Enfin, certains écrivains (Vian, Ionesco, Beckett) meublent les marges ou les versos de leurs manuscrits de petits dessins, souvent anecdotiques, parfois troublants.
Dans les textes qui commentent chaque manuscrit, on apprend leur origine et leur histoire, leur trajectoire avant d’être acquis par la Bibliothèque nationale. Il arrive que les versions successives, d’une même œuvre, ne sont pas conservées dans la même institution. Serait-il envisageable de réunir en un seul lieu de conservation les différentes étapes manuscrites d’un même roman ? [Je pense, par exemple, à l’Éducation sentimentale de Flaubert]
T.C. Matériellement, non : chaque bibliothèque patrimoniale a son histoire, dont les collections sont le reflet, et qu’il est essentiel de respecter. On ne se poserait même pas la question pour les musées ! Mais le numérique permet de réaliser virtuellement cette réunion, ce qui est évidemment beaucoup plus pratique pour les chercheurs. Dans le cas de Flaubert, on a ainsi créé dans la bibliothèque numérique Gallica un portail unique qui donne accès à tous les manuscrits, quel que soit leur lieu de conservation (bibliothèque municipale de Rouen, Bibliothèque historique de la ville de Paris, BnF). Un exemple à suivre pour d’autres auteurs.
Quel document parmi ceux qui figurent dans cet ouvrage vous a particulièrement intéressé, ému ?
T.C. Le manuscrit des Pensées de Pascal a pour moi une place particulière : parce que c’est un texte essentiel, parce que ce manuscrit aurait très bien pu disparaître avant la publication posthume du texte, et parce que c’est un manuscrit encore « vivant », instable, énigmatique : il est constitué de fragments qui ont été collés et reliés arbitrairement, mais dont personne ne sait ce que Pascal en aurait finalement fait, lesquels il aurait gardés, dans quel ordre il les aurait rangés.
Je trouve aussi très émouvant de voir naître presque en direct, au fil des versions successives d’un poème, certains vers fulgurants entrés dans notre mémoire collective, comme le « Soleil cou coupé » d’Apollinaire ou « La mer, la mer toujours recommencée » de Valéry.