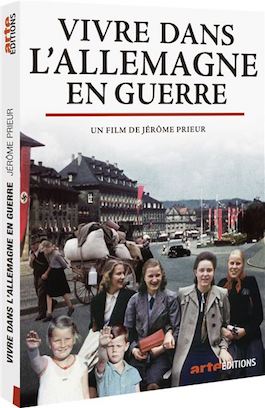Jérôme Prieur est écrivain et cinéaste. Il est l'auteur d'une vingtaine d'essais, notamment Nuits blanches (Gallimard, 1980), Jésus contre Jésus (avec Gérard Mordillat, Seuil,1999), Proust fantôme (Le Promeneur, 2001), Roman noir (essai sur la littérature gothique, Seuil, 2006, médaille d'argent du Prix Louis Barthou, remis par l'Académie française), Rendez-vous dans une autre vie (Seuil, 2010), La moustache du soldat inconnu (Seuil, 2018, Sélection Prix Medicis essai et Prix Femina essai), Lanterne magique, Avant le cinéma (Fario, 2021), d'un roman, Une femme dangereuse (Le Passage, 2013) et de nombreux films documentaires, pour la plupart en rapport avec l'histoire. Il a reçu en 2014 le prix du documentaire décerné par l'Association française des critiques de cinéma et de télévision. Il est l'auteur de la célèbre série Corpus Christi avec Gérard Mordillat (ils ont enquêté pendant sept ans avant de réaliser cette série), diffusée sur Arte, et qui a connu un très grand succès.
Filmographie complète
Vivre dans l'Allemagne en guerre (2020) sort en DVD chez Arte Éditions le 4 mai 2021 et sera diffusé le 9 mai sur France 5 à 20h45.
Le film sera aussi diffusé le dimanche 16 mai pour la première partie et le dimanche 23 mai pour la deuxième, dans la case histoire de 17h.
Vivre dans l’Allemagne en guerre
France | 2020 | 104 minutes
AUTEUR : Jérôme Prieur
IMAGE : Renaud Personnaz
MONTAGE : Isabelle Poudevigne
MUSIQUE ORIGINALE : Marc-Olivier Dupin
PRODUCTION / DIFFUSION : Roche Productions
Avec le soutien de la Fondation La Poste
Ma Vie dans l'Allemagne d'Hitler, diffusé en janvier 2019 sur Arte, était réalisé à partir de films d’amateurs et d’un corpus de textes : des témoignages d’Allemands ayant fui leur pays avant ou après l’accession d’Adolf Hitler au pouvoir en janvier 1933. Des témoignages, pour la plupart jamais publiés, issus d’un concours initié en 1939 par trois professeurs de l’université de Harvard. Le 9 mai prochain, sur France 5, sera diffusé Vivre dans l’Allemagne en guerre réalisé aussi à partir de témoignages, mais cette fois-ci, issus de correspondances, de carnets et journaux personnels écrits entre 1938 et 1945. Comment est né ce projet ?
Jérôme Prieur Après avoir terminé Ma Vie dans l’Allemagne d’Hitler que j’étais allé montrer au festival de Bologne, je suis tombé sur des articles de presse qui annonçaient un livre édité par la Librairie Vuibert, traduit par Aude de Saint-Loup et mon ami Pierre-Emmanuel Dauzat : La Guerre allemande de Nicholas Stargardt. Ce livre m’a intrigué aussitôt parce que j’y ai vu une parenté avec mon film qui adoptait le point de vue des exilés ayant fui le régime pour des raisons raciales, politiques ou religieuses. À la lecture des articles, je me suis rendu compte que le livre de Nicholas Stargardt essayait de faire entendre la voix de ceux qui étaient en Allemagne pendant les années 1939-45. J’ai envoyé un des articles à ma productrice, Dominique Tibi, juste pour l’en informer, histoire de montrer que le film provoquait d’autres échos. C’est elle, ensuite, qui a envisagé la possibilité de tirer matière de cet ouvrage pour un nouveau film et elle a su transformer mon impression de lecteur. Car entre temps, j’avais lu ce volume de 800 pages qui brasse un nombre incroyable de situations, de personnages, mais je ne songeais pas à une éventuelle adaptation, d’autant plus que je n’avais pas envie de continuer à « vivre » en Allemagne nazie et qu’une adaptation aurait d’ailleurs été impossible. Parce que 800 pages, c’est très loin de ce qu’on peut raconter en deux ou trois heures. Aussi, j’ai constaté très vite que la manière de procéder de Nicholas Stargardt était de novéliser, de raconter ce qu’il avait pu glaner dans ses sources, de mettre en récit les témoignages qu’il avait recensés, au style direct et surtout indirect. Il n’était pas possible pour moi de travailler ainsi. Il fallait que je revienne aux sources elles-mêmes, comme je l’avais fait pour Ma Vie dans l’Allemagne d’Hitler à partir de cette enquête de Harvard.
Comment avez-vous procédé au choix des personnages ?
J.P. Une multitude de personnages figurent dans le livre de Stargardt, et parmi eux, une trentaine de protagonistes. J’ai exclu tous ceux qui étaient des militaires car les images de guerre ont tellement été montrées qu’on ne peut plus les voir. Mon objectif était de me concentrer sur le point de vue des Allemands restés dans leur pays, ou plus exactement des Allemandes, fatalement. J’ai sélectionné six femmes, de tous âges. Puis, je me suis rendu compte qu’il me manquait un personnage. J’ai pensé utiliser, comme dans le livre de Nicholas Stargardt, le point de vue de Victor Klemperer. Il a écrit son journal tout au long de la guerre, enfermé dans son appartement à Dresde. Cependant, choisir cet écrivain risquait de tout déséquilibrer, parce que son journal pourrait, à lui seul, faire l’objet d’un film ou même de plusieurs. Le personnage de Klemperer avait de surcroît un inconvénient presque dramaturgique : c’était un Allemand persécuté. Contrairement au film précédent qui donnait la parole aux exilés, aux persécutés ou à ceux qui avaient décidé de fuir et, à leur manière, de résister, je voulais que le point commun entre les différents personnages, quels qu’ils soient, soit de s’accoutumer à la situation qu’ils vivent, aux événements auxquels ils sont confrontés : peu importe leur adhésion ou leur hostilité au nazisme, ils continuent à vivre dans leur pays sans être a priori en danger. En conséquence, je me suis dit qu’il fallait ajouter à mes personnages féminins, le luthérien fervent et auteur à succès, Jochen Klepper. Son roman, Der Vater, publié en 1937 est un best-seller dont la prose est sans doute un peu indigeste, mais ses carnets sont absolument bouleversants. Jochen Klepper est prussien, aryen selon les catégories nazies, sauf qu’il est marié à Johanna Stein, une juive Allemande, veuve et mère de Renate qui devient sa belle-fille. Dans son journal, il est question de ces deux femmes, de ses efforts pour les sauver et de ses cas de conscience théologiques. Parmi les personnages féminins que j’ai choisis pour le film, deux entretiennent une correspondance avec leur fiancé et futur mari : la fleuriste Irène Reitz et la photographe Liselotte Purper. Ce qui est un moyen de faire exister le point de vue masculin. Par principe, je tenais absolument à ce que le film livre la perception de quelques Allemands restés en Allemagne, d’où ce nombre assez restreint de personnages. Ce n’est pas un échantillon scientifique, c’est mon choix.
D’ailleurs je ne souhaite pas que les six ou sept comédiens ou comédiennes de Vivre dans l’Allemagne en guerre (alors que je n’avais pris qu’une seule actrice, Ute Lemper, pour Ma vie dans l’Allemagne d’Hitler), soient de simples lecteurs, mais des interprètes. Je veux créer l’impression que les personnages, qui ne sont jamais à l’image (sauf peut-être en photo), soient présents quasi physiquement dans le film.
Est-ce que tous les textes cités dans le film proviennent de ce livre, La Guerre allemande, Portrait d’un peuple en guerre 1939-1945 de Nicholas Stargardt ?
J.P. Ces textes sont très courts dans le livre, ce sont des citations de quatre ou cinq lignes grand maximum. J’ai donc fait rechercher les originaux. En France, par chance, il y avait deux traductions publiées en 1962 (mais jamais rééditées depuis) auxquelles j’ai pu accéder. Pour les autres, publiés ou restés inédits, nous avons récupéré des copies en Allemagne et j’ai demandé à mon assistante qui est germaniste, Fanny Bouquet, de me faire des fiches de lecture très détaillées sur chacun de ces textes. Ses fiches de lecture me permettaient de chercher à en savoir davantage sur tel ou tel passage, telle époque, tel événement… Grâce à l’aide précieuse de Fanny Bouquet, j’ai pu en comprendre la substance. Elle m’a fait une première traduction. Puis, j’ai construit la continuité narrative du documentaire à partir de ma sélection de journaux intimes ou de lettres. Il faut dire qu’au fur et à mesure du montage, je n’ai cessé d’adapter les traductions, de les ajuster, car traduire est un exercice littéraire qui demande une immense finesse. Après avoir bien avancé le montage du film, je suis allé en Allemagne pour filmer les manuscrits, les photos, les documents…
À Marbach, où il se trouve un extraordinaire Centre d’archives littéraires, j’ai pu filmer les carnets de Jochen Klepper. C’est d’une tout autre nature que les éditions imprimées. À Munich, le documentaliste qui travaille avec moi a retrouvé les carnets d’Ursula von Kardorff, plein de photographies merveilleuses, et j’ai même découvert que cette femme, issue de l’aristocratie allemande, était une grande francophile et sans doute francophone. J’ai passé toute une journée chez la fille de Liselotte Purper, la jeune photographe pour les organismes officiels du IIIe Reich. Elle n’est pas la descendante du couple que Liselotte formait avec Kurt Orgel, lieutenant dans un régiment d’artillerie mort pendant la guerre, elle est née d’un second mariage. Elle m’a reçu chez elle très généreusement, m’a ouvert ses albums de famille, sans d’ailleurs beaucoup de distance par rapport à ce passé qui est pour nous un peu brûlant. J’ai pu consulter les lettres d’Irène Reitz et Ernst Guicking (sous-officier de carrière dans la Wehrmacht) dans les archives du musée de la Poste de Berlin où elles ont été déposées, après qu’une anthologie ait été publiée il y a quelques années en Allemagne.
Il y a un personnage auquel je suis très attaché, c’est la journaliste Ruth Andreas-Friedrich, non seulement parce que c’était une très belle femme, mais aussi parce qu’elle avait une forte conscience politique. Malheureusement, ses archives étaient inaccessibles quand j’étais en Allemagne car sa fille venait de mourir. Je n’ai pu trouver que quelques photographies que je ne connaissais pas. Ses manuscrits ne sont donc pas dans le film. Ce que je regrette car les autographes originaux permettent de sentir la main qui a tenu le stylo. Quant à Mathilde Wolff, elle écrit à ses enfants exilés hors d’Allemagne, des lettres qu’elle ne pouvait envoyer. Elle se sert de la forme épistolaire pour témoigner, « pour qu’ils sachent plus tard ce que nous avons vraiment vécu », dit-elle. Je ne sais pas comment elle les a cachées. Écrire des lettres et même des journaux intimes dans lesquels on remettait en question l’Allemagne nazie, pouvait être très dangereux et vous coûter la vie. Il y a aussi Lisa de Boor, auteure de contes pour enfants et de poèmes. Elle note dans ses carnets des phrases lapidaires et laconiques sur les événements marquants. Mathilde Wolff et Lisa de Boor sont presque des jumelles pour moi, il n’y a pas beaucoup de différences entre elles deux. D’ailleurs, petit secret de fabrication, c’est la même comédienne qui les interprète. Le point commun entre tous ces personnages, c’est d’être des Allemandes et Allemands qui ne se battent pas, qui intériorisent la guerre. Ils relatent, soit pour eux-mêmes, soit par le biais de l’échange épistolaire, la façon dont ils vivent la situation au quotidien. Ils n’ont donc pas nécessairement un point de vue critique sur la réalité, mais une vision partielle. Je n’ai pas cherché à faire en sorte qu’il y ait des personnages qui soutiennent le régime nazi contre d’autres qui, au contraire, le contestent. Toute l’époque est nazifiée, intoxiquée par le nazisme. Ce qui m’intéresse c’est de voir comment des êtres humains ordinaires s’en sortent ou pas, gardent un peu de lucidité ou demeurent dans un total aveuglement, ou encore changent de position. Ursula von Kardorff, par exemple, évolue ; elle écrit cette phrase extraordinaire : « Est-ce qu’on peut souhaiter la défaite de son propre pays ? »
Irène Reitz, Liselotte Purper et leurs fiancés représentent la masse d’Allemands pour qui la propagande nazie a très bien fonctionné. Certaines phrases d’Irène Reitz, par exemple, témoignent d’une grande naïveté, d’un aveuglement et d’une adhésion à toute épreuve, quand elle écrit à son fiancé en 1941 : « N’est-ce pas le projet du Führer de s’unir avec toute l’Europe ? Il en est capable si on lui en donne le temps et les moyens. » Ou encore, elle commence par écrire dans une lettre qu’un seul verre a été cassé dans sa cuisine après un raid aérien, que tous les meubles sont intacts, puis à la toute fin, elle note sans s’attarder que 2500 personnes sont mortes à la mairie…
J.P. « Et ça fait de la peine quand on connaît des gens », ajoute-t-elle ! Ce qui m’étonne le plus dans sa correspondance, c’est qu’en 1944, elle parle d’avenir à son mari comme s’il paraît évident pour elle qu’il va revenir de la guerre. En ce sens, il y a le destin de la grande Allemagne, entièrement sous la coupe de l’idéologie nazie à laquelle ils adhèrent tous deux naïvement, la femme proposant à son mari de lui découper tel article de journal relatant un discours de Goering ou de Goebbels. Ils font des projets d’avenir comme si de rien n’était : Irène s’interroge sur ce qu’ils vont faire après la guerre. Elle envisage d’acheter une petite boutique pour qu’ils soient fleuristes à leur compte. Ce qu’ils ont été ! J’ai vu des photos d’Irène et Ernst, âgés. Pour eux, la vie continue. Ils sont nazis, mais ce ne sont pas des militants. Bien qu’en adéquation totale, Irène n’appartient pas à une organisation du Parti. Elle est dans un complet aveuglement et en effet, représentative de beaucoup de gens rendus stupides par la propagande, méchants par bêtise, sans aucun esprit critique : mesquinerie, sens de la délation, aucune compassion ni générosité… Son fiancé lui explique même qu’il ne faut pas qu’ils se marient tout de suite car il préfère qu’elle attende qu’il soit gradé ! Évidemment, j’ai choisi tous ces passages.
Je trouve néanmoins que psychologiquement, dramatiquement, Liselotte Purper est un personnage plus intéressant qu’Irène. C’est une jeune femme – elle n’a que 22 ans – à qui le Reich donne l’occasion de travailler, d’exercer un métier d’homme. Il y a une sorte de reconnaissance pour le rôle de la femme à accomplir.
On peut se demander pourquoi certains Allemands avaient conscience de mener une guerre génocidaire alors que la plupart restaient sous l’emprise de la propagande nazie… Lisa de Boor écrit dans son journal en 1941 : « La nuit, je fais un rêve : Hitler et Goebbels sont dans un tribunal, sur le banc des accusés. Je leur dis qu’il leur faut bien du courage pour endosser leurs crimes ». Ruth Andreas-Friedrich écrit au même moment : « On déporte les Juifs vers une destination inconnue, dans des camps en Pologne disent ceux qui s’en félicitent, vers une mort certaine, prophétisent les autres. »…
J.P. Ce qui prouve que si on voulait savoir, on savait. En France aussi, nombreux sont ceux qui n’ont pas voulu savoir car évidemment, c’est plus rassurant, et l’horreur des crimes est tellement impensable qu’il est possible de ne pas l’accepter. Ruth Andreas-Friedrich est journaliste, comme Ursula von Kardorff. Elles sont à des postes où logiquement, on est au cœur de l’information. Mais ce n’est pas si facile car la presse est aux mains de l’appareil d’État. Ursula écrit dans son carnet que célébrer les exploits de la Wehrmacht ne l’amuse pas du tout, mais elle est obligée de le faire. Elle raconte qu’elle s’enferme dans les toilettes pour lire Le Journal de Genève et découvre ce que disent les Suisses sur la manière dont on fait disparaître en masse les Juifs. Contrairement à tous les autres personnages, Ruth Andreas-Friedrich fait partie d’un groupuscule clandestin de secours aux Juifs, aux opposants et aux persécutés. Mathilde Wolff, Lisa de Boor, Ursula von Kardorff n’appartiennent à aucune organisation politique mais on les voit qui réfléchissent, s’interrogent, tentent d’être lucides. On peut dire qu’Irène, la fleuriste écervelée, est politisée dans le sens où elle lit le journal, écoute la radio, les discours de Goebbels. Elle a l’impression de penser mais elle ne fait qu’acquiescer, elle répète ce qu’on lui dit de penser. Quant à Jochen Klepper, bien qu’intelligent, il me semble que son aveuglement est le symétrique de celui d’Irène Reitz. Au lieu de faire partir sa belle-fille dès que possible, de fuir à l’étranger, il attend, il espère. C’est un Allemand, il tient à être mobilisé dans l’armée. « Non juif », il n’est pas menacé, rien ne lui interdit de vivre, mais il est broyé quand il comprend que son épouse et sa belle-fille sont vouées à la mort. Le débat théologique qu’il a avec elles deux, comme avec lui-même (« est-ce que Dieu va accepter que nous nous tuions ? »), l’occupe tellement qu’il l’empêche d’être complètement épouvanté par ce qui leur arrive. Ce combat avec l’ange rend la mort moins inquiétante. Ce qui est une forme de folie, mais une folie nécessaire pour lui permettre d’accepter cette situation effroyable.
La lucidité vient surtout des femmes mais peut-être parce que vous avez choisi davantage de personnages féminins…
J.P. Le point de vue des femmes m’intéressait davantage en effet, parce que ce sont des personnages pris socialement, sociologiquement par des activités de la vie ordinaire. Ce n’est pas parce qu’on est dans l’Allemagne nazie ou en période de guerre que la vie quotidienne ne continue pas. Victor Klemperer, que j’ai cité à l’instant, a de bonnes raisons d’être lucide puisqu’il est persécuté. Quand on ne l’est pas, je pense que c’est encore plus difficile d’être clairvoyant. Et quand on est persécuté, ce n’est pas évident non plus d’être lucide. À la fin de Ma vie dans l’Allemagne d’Hitler, un personnage dit : « Après avoir réussi à quitter l’Allemagne, il est difficile de comprendre son propre comportement face à ces monstruosités. Mais tant que j’y vivais, je me sentais comme les autres. À chaque nouvelle mesure, j’éprouvais de l’horreur et me disais que cela ne pouvait plus continuer. Et puis la vie quotidienne m’absorbait de nouveau. (…) J’étais tenté d’occulter toujours davantage la réalité. Cette attitude fut portée à son comble par un de mes vieux parents. À chaque nouvelle loi, il réagissait, stoïque, par la même phrase qui était sensée l’apaiser lui et les autres. Ils feront des exceptions, disait-il. Nous nous bercions d’illusions. Il n’y eut plus d’exception. »
Quand une situation est terrifiante, il est probablement difficile de croire qu’elle va encore empirer.
Vivre dans l’Allemagne en guerre est constitué de films d’amateurs en noir et blanc, et en couleurs, de photographies, de lettres et de carnets originaux que vous avez filmés, ponctués de quelques extraits de films de propagande et de discours radio. Comment composer un film, choisir certaines archives, certaines images et en exclure d’autres ? Comment s’élabore le montage d’un tel documentaire ?
J.P. Les films d’Histoire que je réalise obéissent à un principe d’immersion. Je m’attache à montrer des gens qui ne sont pas surdéterminés, qui continuent à exister, à se livrer à leurs activités quotidiennes, à élever leurs enfants, à fêter Noël, à partir en vacances… Ma façon de travailler est peut-être polémique par rapport à ce qui se fait dans les documentaires historiques principalement pour la télévision, où j’ai l’impression que le spectateur est placé derrière une vitre, à l’abri du souffle souvent malsain de l’Histoire. Le spectateur d’aujourd’hui peut contempler l’ignorance, l’aveuglement, la bêtise, la lâcheté, la méchanceté de ceux qui appartiennent au passé. Mais je pense que l’Histoire est semblable à notre vie : on ne s’arrange pas si facilement avec le bon ou le mauvais côté. Se retrouver en Allemagne, au pays des nazis, c’est plus compliqué que ce que nous dictent les images de propagande dont on se sert trop souvent en pensant qu’il suffit de supprimer le commentaire et la musique pour leur faire dire l’Histoire brute. Nettoyées ou pas, ces images sont tellement construites, elles nous ont tellement intoxiqués qu’en fait nous ne pouvons plus les voir. Les foules avides levant le bras, Hitler à l’horizon, etc. etc., ce sont des clichés. Combien de fois les Allemands en Allemagne ont-ils vu Hitler ? Sans doute, pour la plupart, jamais. Sauf au cinéma. C’est pourquoi j’ai tenu à ce qu’il y ait des moments de pure propagande dans le film qui viennent des Actualités filmées ou de la radio de l’époque, et que ces images forment des blocs isolés du reste, séparés. D’ailleurs, si le spectateur regarde vraiment ces Actualités, en oubliant l’effroi qu’elles génèrent en lui, il y verra leur aspect dérisoire, lamentable, grotesque. Tel le petit sapin de Noël jeté d’un train dans la steppe soviétique pour un gardien isolé. Chaque séquence de propagande est tellement énorme, stupide, qu’il faut en rire. J’ai voulu que mon film permette de décrypter ces images. Mais je tenais à utiliser, dans ce film comme dans les précédents, les moments ordinaires, anodins, qui proviennent des films des cinéastes amateurs : les plus intéressants d’entre eux prennent le temps d’observer et de composer un plan. C’est fascinant.
Il est surprenant de voir qu’il y a autant de cinéastes amateurs. Qui sont-ils ? Et où sont conservés tous ces films ?
J.P. On ne sait pas toujours qui ils sont. J’ai trouvé la plupart de ces films dans d’autres lieux que les Archives officielles. Les Allemands ont une culture technique plus développée que les Français. Dès les années 1930, ils ont utilisé des petites caméras amateurs, tourné des films en noir et blanc et même en couleur. Bien avant les Français. Quelques cinémathèques privées en Allemagne ont compris que c’était un matériau à préserver. Elles les ont conservés, indexés, identifiés autant que possible. Ces films ne sont pas souvent utilisés, car pourquoi se servir d’images d’enfants qui jouent à se bagarrer ? Ou encore d’images de piscine, de courses de natation, etc. ? Sauf si c’est pour les insérer dans un projet de récit. À ce moment-là, elles prennent du sens, elles permettent de toucher quelque chose du passé, de le rendre vivant, ne serait-ce qu’un instant.
On voit des enfants dans des petits tanks…
J.P. Oui. À partir du moment où je ne veux pas montrer la guerre contre l’Union soviétique, parce que les images sont suffisamment connues et que je ne ferais que restituer la propagande, comment faire si ce n’est en révélant l’effet qu’elle a produit chez les jeunes enfants ? Les voir se battre, jouer à la guerre, être à l’intérieur de tanks conçus pour eux, porter des casques, cela nous montre de façon presque aveuglante comment la guerre est rentrée dans le foyer, la famille, l’intimité…
Les voix de ces civils allemands parlent d’elles-mêmes, pas de commentaire en voix-off, si ce n’est pour donner quelques précisions et indications biographiques, et le récit que livrent ces témoins est donc appuyé par des images à propos tout en étant à l’écart. Cette mise en rapport avec le texte, ce traitement des images où pointent une certaine ironie, un double sens, convoque l’imaginaire ou un regard critique, évoque un passé qui devient présent. Cette association témoignages textuels et images d’archives montre aussi l’absurdité de l’Histoire et de l’information mensongère… Comment travaillez-vous ?
J.P. Un moment de la vie ordinaire, par exemple une femme en train de préparer des pâtisseries (c’est extraordinaire que le mari ait songé à la filmer), fait regarder la réalité tout autrement que si nous était montré un discours ou un défilé. Ce que j’ai tenté, comme dans d’autres films, c’est de fuir la pure et simple illustration. Je suis boulimique d’images, de textes également. Je demande à mon documentaliste de m’en procurer une grande quantité. Je les visionne avec Isabelle Poudevigne, la fidèle monteuse de beaucoup de mes films, et je mets de côté celles qui me frappent cinématographiquement, qui me racontent quelque chose, me donnent la sensation du Temps. Ensuite, j’essaie de voir musicalement comment le texte peut se marier à l’image et pour qu’il en soit ainsi, il faut toujours qu’il y ait dans l’image un point de contact qui résonne avec le texte. À partir du moment où ce point de contact est trouvé, tout est permis, tout est possible et, à mon avis, cela décuple l’attention du spectateur qui entend quelque chose et voit autre chose. Ses sensations, ses émotions, sa perception, son intelligence de l’Histoire sont démultipliées. Je suis souvent déçu par les documentaires historiques où j’ai l’impression que l’on veut me montrer l’image qui correspond à ce qui est dit. On empêche le spectateur de penser, on l’empêche d’être troublé. Afin de révéler l’endoctrinement des enfants ou leur asservissement, je trouve que c’est beaucoup plus pertinent de montrer des jeux, des fêtes, des moments qui ont l’air d’être détachés de toute obligation sociale, plutôt que des films dans lesquels on a utilisé les enfants comme outil de la propagande au service de la jeunesse du Reich.
Parlez-nous du travail du son, des musiques que compose Marc-Olivier Dupin qui sont « comme un regard supplémentaire »…
J.P. Je travaille depuis plusieurs années avec le compositeur Marc-Olivier Dupin qui apporte à chacun de mes films un autre regard. Je lui laisse une grande liberté. Il voit le film bien avant qu’il soit terminé, avant même les producteurs, très souvent dès le tout début du montage. Il est inspiré par ce que je cherche et il travaille en parallèle. Il compose, pense à des emplacements, et finalement, j’utilise la musique autrement que ce qu’il avait prévu ! C’est le jeu entre nous. Il ne fait pas de l’illustration sonore. Il apporte, musicalement, un regard critique ou un autre regard sur ce que je raconte. Dans un film précédent, Occuper l’Allemagne, qui était sur l’occupation de la Rhénanie et de la Ruhr de 1918 à 1930, nous avions choisi comme principe d’utiliser uniquement l’orgue. Pourquoi cet instrument ? Parce que c’est une musique corporelle. La seule consigne que je lui avais donnée était d’éviter absolument que l’orgue ait la connotation religieuse qu’il a fatalement depuis Bach. Excepté un passage qui ressemble à une messe funèbre, la contrainte a été respectée. Mais surtout elle apporte une puissance, une étrangeté extraordinaire au film. Sa musique s’entend, contrairement à l’illustration sonore de beaucoup de films qui consiste paradoxalement à se faire oublier. Il y a un côté déroutant dans la musique de Marc-Olivier Dupin, et au lieu de nous bercer, elle nous force à regarder, nous réveille et nous éveille. C’est un vrai cadeau pour mon travail.
Avez-vous reçu des courriers de spectateurs après avoir réalisé le documentaire Ma vie dans l’Allemagne d’Hitler ?
J.P. Des amis m’ont écrit longuement, Marcel Cohen par exemple, ou Alain Cavalier. Anne Weber aussi, qui a reçu l’automne dernier le Prix du Livre allemand. Mais les spectateurs anonymes qui osent écrire sont rares, c’est tout l’intérêt pour moi des projections en salle car on y rencontre le public. Une fois, j’ai reçu le courrier d’une femme qui avait reconnu ses grands-parents dans une scène de mariage en couleur de Ma vie dans l’Allemagne d’Hitler. Cette séquence est un peu effrayante, c’est la Belle et la Bête : la jeune épouse est très belle, tout de blanc vêtue et le mari, qu’on ne voit pas tout de suite, est un SS au visage balafré dans son uniforme noir. Cette spectatrice était très émue d’apercevoir ses grands-parents et voulait savoir d’où venaient les images. C’est extraordinaire, à sa place j’aurais été consterné ! Ce qui est passionnant pour moi c’est d’être invité à montrer les films en Allemagne, parce que l’effet qu’ils produisent sur un public allemand est très fort. J’ai montré Ma vie dans l’Allemagne d’Hitler à Mayence, dans le cadre d’une association entre le cinéma de la ville et l’université. L’un des universitaires, qui parrainait cette soirée, m’a expliqué après la projection, qu’il était venu à reculons, forcé par ses obligations, mais qu’il ne regrettait pas car il avait été stupéfait : il avait vu l’Histoire comme on ne la montre jamais. Il espérait que beaucoup puissent voir ce film car il permettait d’apercevoir l’inquiétante étrangeté dans laquelle avaient vécu ses aïeux. C’est un immense compliment.
Parlez-nous de votre parcours de documentariste avec les portraits d’écrivain, les séries sur le christianisme, le journal d’Hélène Berr (Hélène Berr, une jeune fille dans Paris occupé, 2013), les films sur l’Allemagne nazie… Comment choisissez-vous un sujet ou une question, une époque, une histoire à raconter ?
J.P. Parfois, je prévois de faire un film et je mets dix ans à le réaliser, pensant que je n’y arriverai pas ; d’autres fois, c’est un concours de circonstances, le hasard qui décide, ce sont des découvertes suscitées par le travail lui-même. Par exemple, je n’aurais jamais pensé réaliser un film documentaire sur Antonin Artaud (La véritable histoire d’Artaud le Mômo (1993) co-réalisé avec Gérard Mordillat). De toute façon, il est toujours indispensable que je me sente très concerné, car c’est un travail de longue haleine qu’il faut mener. Il faut sortir des sentiers battus, des lieux communs, se poser des questions, faire une enquête, des recherches. Pour des programmateurs, présenter le projet de plusieurs heures de télévision à partir de quelques versets d’un évangile – tel a été le cas à la source de la trilogie documentaire sur les origines du christianisme, Corpus Christi et les autres séries – apparaît comme une idée saugrenue. Qui va s’y intéresser ? Il s’avère que ces séries ont eu un immense succès, que l’on m’en parle encore chaque semaine, très longtemps après ! Mais en règle générale, pour réussir à réaliser les films que je veux faire, qui sont une nécessité pour moi, il me faut être très tenace, même si je suis épaulé par des producteurs. Je pense que petit à petit, ces films documentaires dessinent une espèce de constellation. J’essaie, au gré des circonstances, des occasions, de creuser ce qui m’intéresse. Pour moi, la question capitale est celle de la représentation et du point de vue. Le point de vue de l’histoire à raconter et de la manière dont il est possible de la raconter. Donner à entendre la voix de ceux qui sont morts, de ceux qui étaient en Allemagne pendant la guerre, donner à voir ce que leurs yeux ont vu, ce que les yeux d’Hélène Berr ont vu (dans le film que j’ai réalisé à partir du journal de cette jeune femme), ce sont des projets qui me mettent en mouvement, car ils sont potentiellement cinématographiques. Un moment ou une époque à explorer m’intéresse bien plus qu’un « sujet » qu’on me demanderait de traiter : je m’interroge d’emblée sur ce que je vais pouvoir montrer, sinon cela ne me parle pas.
Il y a un constant va-et-vient entre ce que j’écris, entre mes livres et ce que je filme. Par exemple, mon dernier livre, édité au Seuil en 2018 dans la collection de Maurice Olender « La librairie du XXIe siècle » et intitulé La Moustache du soldat inconnu, m’occupait en réalité depuis mon adolescence. Je voulais écrire sur la Première Guerre mondiale, sur la vie quotidienne des Poilus. Évidemment, ce projet a beaucoup évolué au fil du temps sans s’inscrire dans le cadre de la commémoration du centenaire qui m’a presque dépassé… Alors même que j’étais en train de l’écrire, le projet a pris une tournure tout à fait autre de ce que j’imaginais, quand j’ai découvert un petit film amateur de 15 minutes tourné en 1915 par un sous-officier au front, juste à l’arrière des tranchées. Ce petit film montre des choses assez dures à regarder, qui font partie de l’ordinaire de la vie d’un combattant. J’ai été tellement fasciné, comme lorsqu’on découvre un fossile, que je me suis mis à chercher qui avait pu tourner ce film, comment celui-ci était arrivé jusqu’à nous, etc. J’ai voulu aller jusqu’à identifier tous les visages, ces soldats inconnus qu’on voyait à l’image, les vivants, et même les morts… J’ai été poussé par cette envie irrésistible de me livrer à cette entreprise de résurrection, et j’ai réussi je crois à trouver un certain nombre de réponses. Les moments arrachés au passé me touchent intimement. Le passé est vivant pour moi et il ne me captive que dans la mesure où il n’est pas mort. En tant que cinéaste, montrer des gens qui ne savent pas ce que le lendemain va être – le Reich aurait pu durer plusieurs décennies, le nazisme aurait pu gagner –, les voir dans cette incertitude, dans laquelle le spectateur peut aussi se plonger en oubliant un peu comment l’histoire va se terminer, m’intéresse beaucoup. Mais bien sûr, il est important de donner des éléments de compréhension du passé pour ne pas s’adresser qu’à des initiés.
Quel film préparez-vous actuellement ?
J.P. Je prépare un film, Les Suppliques, qui est un peu dans cette lignée mais qui formellement sera différent. Il est construit à partir d’un gisement de correspondances, exhumées massivement par l’historien Laurent Joly, spécialiste de la persécution des Juifs de France. Les suppliques sont les courriers adressés à Pétain, à l’ambassadeur Fernand de Brinon, et surtout au Commissariat général aux question juives. Ce sont des correspondances qui s’échelonnent entre 1941 et 1944. Des Français ou des étrangers, Juifs ou pas, écrivent à l’administration pour dire que ce qui se passe est totalement invraisemblable. Ils demandent à l’administration, à l’État d’intervenir pour venir à leur secours… alors que l’État français est l’agent ou le relai de la persécution. Cette réalité leur parait inimaginable. Certains expéditeurs sont les voisins des victimes, les collègues de bureau, le maire du village, des camarades de régiment qui plaident la cause de telle ou telle personne en disant : « On n’aime pas beaucoup les Juifs mais la famille Schwartz, ce sont des gens formidables, alors faites quelque chose pour eux. » C’est fascinant aujourd’hui de voir comment la persécution s’effectue à bas bruit, quotidiennement, dans l’ordinaire, dans la stupeur de ceux qui sont soudain concernés et qui se retrouvent devant une situation littéralement impensable. C’est un travail difficile évidemment de préparer ce film, mais passionnant et nécessaire.
Jérôme Prieur : Filmographie complète - Film-documentaire.fr
Jérôme Prieur – France Culture
Jérôme Prieur – Éditions du Seuil