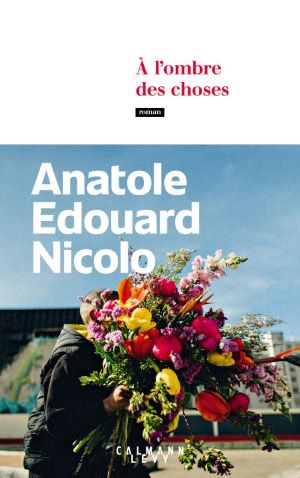Anatole Édouard Nicolo est né en 1996. Après avoir évolué dans le domaine du sport, il se consacre désormais à l’écriture de scénarios. À l’ombre des choses, pour lequel il a reçu le prix « Envoyé par la Poste » 2024 est son premier roman.
Le jury de la 10e édition du prix « Envoyé par la Poste » a couronné votre roman, À l’ombre des choses, publié chez Calmann-Lévy. Que ressentez-vous en recevant cette distinction littéraire ?
Anatole Édouard Nicolo : Lorsque Philippe Robinet (Directeur des éditions Calmann-Lévy) me l’a annoncé, j’étais en vacances, loin de la vie parisienne et de la sortie du livre. J’ai crié de joie ! J’étais heureux. C’est pour moi un formidable accomplissement. J’ai toujours vu le monde littéraire comme étant mystérieux, lointain, et aujourd’hui, en recevant ce prix, je me sens dans le présent. J’éprouve un sentiment de légitimité.
On comprend qu’il s’agit d’un roman autobiographique, que cette famille est la vôtre. Qu’est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre ?
A.E.N : Ce texte est avant tout un roman, pas une autobiographie. À travers l’histoire du narrateur et de ses rencontres, j’ai voulu m’adresser à toutes les personnes qui se sentent invisibles, qu’on ne voit pas, qui sont dans l’ombre. Dans l’ombre de quelqu’un, d’une famille, de la société... Écrire une histoire où l’on parle de ces gens s’est imposé à moi... Lorsque j’ai découvert l’écriture, j’ai ressenti une forme de liberté que je n’avais jamais connue auparavant. La littérature m’a sauvé la vie. J’avais un quotidien moyen, gris, sans intérêt, et j’ai découvert une passion.
Les premiers souvenirs du narrateur sont ceux du foyer social à la différence de son grand-frère…
A.E.N : Mon grand-frère a compris ce déclassement social, sa violence, car il se souvenait des jours heureux en famille dans une belle et grande maison, avant le divorce de nos parents. Alors que moi j’étais trop petit pour pouvoir faire des comparaisons. Mes souvenirs commencent avec le foyer social, un milieu très dur, précaire, dans lequel j’ai grandi, avec une certaine naïveté d’ailleurs. Et quand nous logions chez notre père, c’était dans un squat. Dans le roman, G., le grand-frère, est vindicatif, colérique, mais sa colère est un moteur qui lui permet de s’en sortir, d’avancer dans le domaine musical. Anatole, le narrateur, est, quant à lui, dans une quête d’amour constante, une quête de reconnaissance. Le foyer social est un environnement où l’amour n’a pas vraiment sa place. Il faut d’abord être fort avant d’être tendre. Il aura plus de difficultés à s’épanouir.
Il y a quand même de jolies rencontres dans ce foyer social…
A.E.N : Il y a eu de jolies rencontres en effet et c’est pour cette raison que les personnages du roman font preuve de vulnérabilité. J’ai voulu insuffler une fragilité dans chacun d’eux car les rencontres tiennent toujours à un fil. Ce qui m’intéresse dans l’humain c’est avant tout la fragilité.
Est-ce que le « je » du narrateur est venu tout de suite ou avez-vous d’abord essayé d’autres dispositifs qui auraient mis davantage de distance ?
A.E.N : Le « je » est venu immédiatement car écrire ce roman a été un besoin. J’ai d’abord déversé tout ce que j’avais dans le ventre et j’ai parlé en mon nom propre. Puis, lorsque j’ai compris que ces écrits devenaient sérieux, je me suis demandé si j’allais conserver le prénom « Anatole » et le pronom « je ». Je craignais que ce soit trop personnel, qu’on le prenne comme un ego trip. Finalement, j’ai opté pour la sincérité et j’ai gardé le dispositif premier. Je voulais que ce soit un roman sincère, généreux et ouvert aux autres.
Parlez-nous de ce titre : À l’ombre des choses… Vous écrivez : « Son succès projetait une ombre sur tout ce que j’étais mais c’était précisément cette ombre qui me poussait toujours plus loin… »
A.E.N : L’idée de l’ombre se développe en trois stades. Le roman, dans lequel on suit la trajectoire d’un enfant jusqu’à l’adolescence, débute avec la description du foyer social, bâtiment que l’État mettait à disposition des familles démunies. Il était proche d’une église, à proximité des maisons bourgeoises, des familles respectables. Une fois rentré chez soi, les portes et les stores se fermaient rapidement pour cacher la misère. On ne recevait personne, pas même pour les anniversaires des enfants. C’était une ombre dans la société, une honte aussi. Ensuite, le frère du narrateur, G., devient une personnalité dans la musique. Il attire toute la lumière à lui et Anatole va être plongé dans l’ombre. Puis, ce dernier se met à distribuer des flyers et ce métier précaire lui fait prendre conscience de son invisibilité. Personne ne s’intéresse à lui. Le fil rouge du texte est l’ambivalence de cette quête existentielle. Le narrateur aime son frère, il en est fier, et en même temps, sa propre construction est mise à mal par la place qu’occupe ce frère. Comment trouver sa place au sein de la famille est une question que tout le monde peut se poser.
Avec le roman, les « choses de la vie » sont modifiées, nuancées, et ces nuances les rendent importantes pour d’autres que soi…
A.E.N : Ce que j’aime dans la littérature c’est de pouvoir rêver, me projeter, visualiser. Je suis tombé amoureux de la littérature parce que je me suis reconnu dans une phrase de Rilke qui m’a bouleversé : « Un lieu n’est jamais pauvre pour la création. »* (Lettre à un jeune poète). Je me suis dit que je grandissais, en effet, dans un environnement éloigné de la littérature, où l’on traîne toujours sur le même banc, désœuvré, à regarder les mêmes passants, mais que si j’arrivais à trouver de la poésie dans ces moments-là, je pouvais créer. C’est ce que j’ai voulu faire en écrivant ce roman.
Est-ce que vous travaillez beaucoup la forme du texte avant d’en être satisfait ?
A.E.N : Oui, je travaille énormément le texte. Je pense que toutes les histoires sont belles, tout dépend de la façon dont on les raconte. Dans mon roman, la langue est simple, accessible, assez moderne et brute. J’ai baigné dans l’environnement de la musique avec ma famille et j’ai cultivé cet art de la punchline. C’était important pour moi de transmettre des émotions avec des phrases simples et efficaces.
Les phrases en italique sont réellement celles de mon frère Georgio. Je les ai citées parce que je trouvais intéressant de lui répondre, non pas dans l’idée d’une opposition entre le rap et la littérature, mais d’un dialogue.
A-t-il lu votre roman ?
A.E.N : Oui, bien sûr. J’ai d’abord envoyé mon manuscrit à ma famille. Le premier retour que mon frère a fait était presque celui d’un éditeur ! C’était technique. Ma famille est très pudique, on ne montre pas ses émotions. Mais je crois que tout le monde a été touché. C’était une deuxième naissance pour moi. Mes parents et mon frère m’ont vu autrement et moi je me suis découvert en écrivant. Tout ce que je dis dans le roman, je ne l’avais jamais évoqué auparavant.
Comment avez-vous procédé pour construire le roman ? Est-ce que le livre que vous venez de publier est fidèle à l’idée que vous en aviez ?
A.E.N : J’ai déversé un flot de paroles dans un premier temps, comme dans une conversation avec un ami, en étant le plus franc possible. Ce qui m’a provoqué véritablement des sensations dans le corps : parfois, j’ai eu des nœuds dans l’estomac, j’ai ri, j’ai eu les larmes aux yeux. Puis, il y a eu une deuxième étape dans l’écriture, au moment où j’ai voulu que ce soit poétique et que le texte puisse être partagé. J’ai donc retravaillé les phrases, j’ai fait en sorte qu’on ait envie de tourner la page. J’ai voulu procurer des émotions aux autres et pas seulement à moi-même.
J’ai mis un an et demi à écrire ce livre. Un jour, j’étais Place de la République à Paris et j’ai commencé à prendre des notes, à décrire tout ce qui se passait autour de moi. Ces notes sont devenues des petits paragraphes. Ensuite, j’ai assemblé les morceaux, comme une sorte de puzzle, pour construire une narration.
Il faut dire aussi que je suis parti au Congo, où mon père habitait, pour réaliser un documentaire sur le sentiment de liberté dans un pays sous dictature. Lorsque rentré en France, j’ai montré ce film à ma famille, j’ai vu mon frère pleurer pour la première fois. Ça m’a tellement bouleversé que je me suis dit que j’allais raconter notre histoire pour en tirer quelque chose de beau, sans misérabilisme, et sans en avoir honte non plus.
Quelle place a l’écriture dans votre vie ? Le narrateur dit : « Quand il [mon père] est parti, je n’avais pour passion que le football et, aujourd’hui, je ne vivais que pour l’écriture. »
A.E.N : C’est vraiment une passion. Je m’étais promis de faire une pause pour la sortie de ce premier roman afin de vivre pleinement l’aventure, mais au bout de deux jours, je me suis remis à écrire. L’écriture, c’est la liberté, c’est un endroit où je peux être moi-même, où je peux mentir aussi, jouer avec les dialogues, réinventer une histoire, fantasmer une réalité.
Quels sont les écrivains dont vous vous sentez proches ? « Je lisais des auteurs du monde entier », écrivez-vous à propos de cette époque où Kamille vous hébergeait.
A.E.N : Le personnage de Kamille est intéressant car il m’a permis d’aller et venir entre plusieurs mondes. Je n’ai cessé de m’adapter en côtoyant des milieux différents : précaires, bourgeois, intellectuels. Kamille a vraiment existé et cette rencontre avec lui a été pour moi d’une grande richesse.
Quant aux écrivains dont je me sens proche, il y a, parmi les contemporains, Kae Tempest, une poétesse anglaise née en 1985. Elle a écrit une fable contemporaine qui m’a énormément inspiré. Et Anne Pauly, dont j’aime beaucoup le roman, Avant que j’oublie (Verdier, 2019). Je perçois dans son écriture une vulnérabilité. J’aime les romans où l’on sent une fragilité et une passion. Je pense que je suis entré en littérature grâce à La vie devant soi de Romain Gary. Il y a aussi Martin Eden de Jack London, Rainer Maria Rilke, Albert Camus et Zola, pour sa capacité à écrire sur la misère.
.......................................................................................................