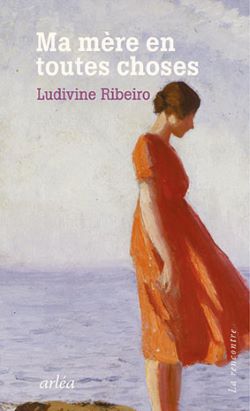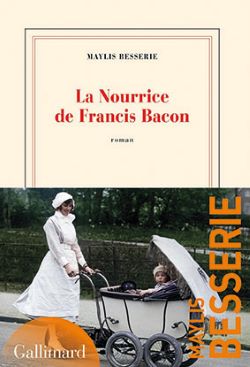Récits
Pascal Dibie, California Dream. Voyage chez les rêveurs d’avenir. En avril 1980, Pascal Dibie part en Californie avec le projet de parcourir la côte de San Francisco au Mexique, et de consulter les fonds des bibliothèques de Santa Cruz et de Berkeley pour l’écriture d’un livre sur l’« écologie humaine ». Au fil de ses rencontres, il va s’immerger dans le mouvement communautaire californien qui prône un autre modèle sociétal, s’imprégner des recherches sur l’esprit humain menées dans les universités et un peu partout ailleurs. Pour retracer cette aventure inoubliable, l’ethnologue s’est replongé dans ses carnets de l’époque et fait résonner ses observations d’alors avec les enjeux actuels. « Logiquement, ce qui était neuf en 1980 aurait dû être vieux quarante-deux ans plus tard, or c’est l’exact contraire : ce que nous disions, vivions et constations est de plus en plus vrai dans notre actualité contemporaine de fin du monde. Reste à savoir pourquoi personne ne nous a crus plus tôt ? » À la fin des années 1960, un vent de contestation souffle sur l’Amérique : lutte pour les droits civiques, libération des femmes, opposition à la guerre du Viêtnam. En Californie, des communautés et des idées nouvelles éclosent, porteuses d’une volonté « de repenser et de réoccuper la société » et d’une prise de conscience écologique. L’objectif est de rompre avec la société de consommation, avec l’aliénation capitaliste, « d’inventer une culture nouvelle qui soit autant en adéquation avec l’humanité qu’avec la nature ». Le rapport au temps et à la nature est au cœur du cette réflexion. Ébloui par les falaises vertigineuses, les forêts de séquoias, nourri par les écrits de Henry David Thoreau et d’Henry Miller, Pascal Dibie aiguise sa perception des liens qui unissent l’homme à la nature. En partageant le quotidien d’une communauté hippie de Big Sur, établie dans la forêt, il participe à ce grand laboratoire humain et expérimente un mode de vie plus spirituel, plus libre, plus égalitaire, recentré sur les besoins essentiels. « Nul doute que ce nouveau regard sur le monde était séminal : plus que survivre on voulait vivre et on le voulait au sein d’une vraie convivialité d’où nous pourrions réenchanter le monde (…) ». Éd. Métailié, 208 p., 18 €. Élisabeth Miso
Ludivine Ribeiro, Ma mère en toutes choses. « Je n’arrive pas à croire que c’est arrivé, ma mère du monde effacée. » À la mort de sa mère, Ludivine Ribeiro est prise de panique. Comment vivre sans elle, sans son amour inconditionnel ? « Du jour où elle a disparu, l’espace s’est dilaté. Tout est devenu trop grand, le ciel surtout, mais aussi les arbres, les nuages, les paysages étirés à l’infini, enflés et mouvants, comme dans un miroir déformant ou un cauchemar. » Que reste-t-il d’un être cher après sa mort ? Craignant que ses souvenirs ne s’estompent, l’autrice se livre à un inventaire des objets de la défunte, sondant leur pouvoir évocateur, la mémoire qu’ils renferment. Contre toute attente, vider l’appartement maternel n’est pas l’épreuve tant redoutée. Tous les objets choisis ou conservés par elle, sont autant de traces de sa présence encore palpable. Les chandeliers argentés qu’elle chinait de-ci de-là, ses recettes de cuisine, ses chaussures dorées, ses saris, les iris qui lui venaient de sa grand-mère et dont elle a transmis quelques ryzhomes à sa fille, reflètent quelques éclats de sa personnalité et de son existence. Chacun de ses gestes traduisait son appétit pour la vie, son don pour générer du bonheur et de la beauté autour d’elle. Elle aimait les petites figues vertes, Piero della Francesca, Billie Holiday, Venise et les forêts comme celles de son enfance en Forêt-Noire. Elle n’était qu’intrépidité, joie et douceur. Pour ses quatre enfants et son mari, un Indien de Goa, elle était un astre. Ludivine Ribeiro, se remémore leur plaisir infini à être ensemble, leur complicité d’adultes tout comme son amour débordant de petite-fille, quand elle cueillait pour elle des quantités de cyclamens, au pied de leur immeuble à Beyrouth. D’une chose à l’autre, d’un souvenir à l’autre, elle dessine, par petites touches, un portrait de cette mère adorée, laissant filtrer avec délicatesse les joies et les drames d’une histoire familiale. Éd. Arléa, La rencontre. 260 p., 20 €. Élisabeth Miso
Romans
Maylis Besserie, La Nourrice de Francis Bacon. Après s’être penchée sur les figures de Beckett et de Yeats, Maylis Besserie s’est intéressée à Francis Bacon, à travers le prisme de l’amour indéfectible que lui vouait sa nourrice. En se glissant dans la peau de Jessie Lightfoot, elle dévoile le rôle central qu’elle a joué auprès de lui, la manière dont elle l’a toujours soutenu et préservé de ses pires démons. Originaire de Cornouailles, elle arrive en 1911 à Cannycourt House, la demeure cossue de la famille Bacon au nord de Dublin, et comprend vite que les enfants manquent cruellement d’affection. La mère est happée par sa vie mondaine. Le père, un capitaine à la retraite, qui élève des chevaux, a tout d’un véritable despote. C’est un homme haineux, amer, qui ne supporte ni la délicatesse, ni la fragilité de son fils maladif et asthmatique. Il ne manque jamais une occasion de martyriser Francis, lui inflige de fréquents châtiments corporels et finit par le chasser l’année de ses seize ans, ulcéré par son homosexualité. La jeunesse de l’artiste a été marquée par la violence domestique et par celle qui secouait l’Irlande, en lutte contre l’occupant anglais. Jessie Lightfoot et sa grand-mère maternelle ont été les seules sources de joie et de tendresse durant ces années terrifiantes. Son protégé parti, la nourrice veille à distance, connaît tout de ses aspirations artistiques, de sa découverte de la luxure, de ses rencontres décisives et le rejoint à Londres en 1929, pour ne plus le quitter jusqu’à sa mort en 1951. Elle est la confidente, le témoin de toutes ses frasques, de ses amours tourmentées, de son sadomasochisme, de son addiction à l’alcool, de ses accès dépressifs, de ses doutes ou de son génie créatif, de son pouvoir d’attraction et de la déflagration de sa peinture. « Lui, il a besoin d’être libre, c’est comme ça. Ce qu’il aime, c’est que la vie l’emporte comme une rivière, qu’elle mette de la beauté sur son chemin, devant ses yeux ». À travers la voix de Jessie Lightfoot, et celle de Francis Bacon, aux prises avec certaines de ses toiles (Peinture 1946, Trois études pour une crucifixion…), on entre dans l’intimité et l’intensité créative d’un des plus grands peintres du XXe siècle. Éd. Gallimard, 256 p., 20 €. Élisabeth Miso
Neige Sinno, Triste tigre. Au-delà de la tragédie personnelle, c’est un récit sur l’énigme du mal, sur la littérature, un prodigieux roman autobiographique au titre hypnotique écrit par une écrivaine française aujourd’hui exilée au Mexique. Elle aime écrire, la fiction elle est douée pour cela, elle aimerait pouvoir écrire un livre qui parlerait d’autre chose et surtout pas de ça, écrire avec plus de distance : être simplement quelqu’un qui a vu quelque chose, qui aurait été disons touchée par ses répercussions, mais ce n’est pas la position sur l’échiquier qui lui a été attribuée. Alors, après avoir été si longtemps incapable d’écrire, elle choisit la non-fiction, l’exercice le plus âpre, le plus ardu qui soit, même si elle sait que la littérature ne sauve pas, ne l’a pas sauvée. Voilà pourquoi elle revient si souvent sur la difficulté d’écrire son livre, au-delà des épisodes traumatisants, parce que « (Une personne qui a été abusée dans son enfance n’a pas besoin d’un livre pour se rappeler des épisodes douloureux, elle se lève chaque matin avec son paquet tout prêt), mais parce que cette réalisation, dans laquelle celle qui écrit met tout son effort, sa bonne volonté, ses années de lecture, son cœur et son âme, c’est encore un projet de l’agresseur ». Dès la première page, Triste tigre suffoque – quoi encore un livre sur l’inceste ? – et plus on avance dans la lecture plus on est saisi par le propos, sa construction, ses tremblements, la maîtrise de sa concentration. À la fois, récit et essai parcouru de références littéraires tels des dialogues noués avec d’autres romans – à commencer par Lolita de Nabokov – l’auteure évoque les viols répétés de son beau-père de ses 7 à ses 14 ans, et s’interroge sur cette enfance dont elle a été éjectée, confinée dans l’horreur du secret et la solitude. Jusqu’à ce qu’elle réclame justice et porte plainte avec sa mère, jusqu’à ce qu’elle sache son agresseur en prison – les prédateurs sont de tristes tigres - et trouve une voie dans l’exil. Éd. POL, 284 p., 20 €. Corinne Amar
Tom Crewe, La Vie Nouvelle. Traduit de l’anglais par Étienne Gomez. Dans l’Angleterre victorienne, entre 1894 et 1896, dans une société des plus corsetées où l’homosexualité est un délit pénal, deux hommes de la bonne société londonienne pris dans les contradictions de leur vie intime, de leur mariage, entre l’ordre moral et leur besoin de liberté. Henry Ellis, jeune médecin et critique littéraire vient d'épouser une femme brillante, Edith, membre comme lui d'une société de libres penseurs, appelée la Vie Nouvelle. Ils ont des affinités intellectuelles et affectives, et se promettent de construire un couple moderne, loin des rigidités sociales. John Addington lui, grand bourgeois respecté par la bonne société londonienne, marié et père de trois jeunes filles, tourmenté par son homosexualité, finit par passer à l’acte, pris de passion pour un jeune homme sans le sou rencontré à Hyde Park qu’il installe chez lui comme secrétaire particulier, et compromet dangereusement son mariage. Les deux intellectuels entrent en contact et décident d’écrire à quatre mains une étude historique de l’homosexualité depuis la Grèce antique. Henry aimerait consommer son mariage avec sa femme, mais n’y parvient pas, d’autant plus qu’il découvre que celle-ci est amoureuse d’une autre femme. Alors que pris dans les tourments de leur vie intime, ils terminent l’écriture de leur essai et ont pu trouver – sinon un éditeur – un libraire hardi prêt à l’éditer, le procès d’Oscar Wilde fait la une des journaux anglais, le voilà enfermé à la geôle de Reading et perdu à jamais. C’est un premier roman prodigieux de maitrise à la fois littéraire et historique et magnifiquement traduit. L’auteur qui s’est servi de faits réels et de personnages qui ont existé, relate avec talent cette Angleterre victorienne où les homosexuels étaient considérés comme des invertis, n’avaient aucun droit, étaient contraints de se cacher, jusqu’à l’émancipation progressive des interdits sexuels et des mentalités. Éd. Bourgois, 468 p., 24 €. Corinne Amar.