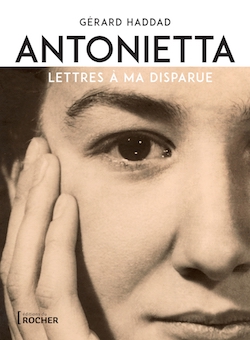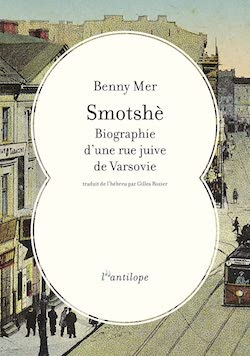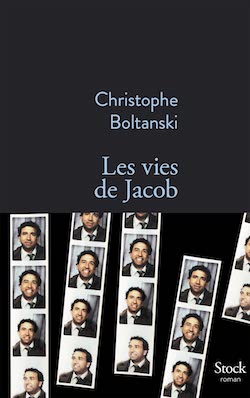RÉCITS BIOGRAPHIQUES ET AUTOBIOGRAPHIQUES
Natasha Trethewey, Memorial Drive. Traduction de l’anglais (États-Unis) Céline Leroy. Trente ans après la mort de sa mère, Gwendolyn Ann Turnbough, assassinée le 5 juin 1985 par son ex-mari, Natasha Trethewey est revenue à Atlanta, la ville où son existence a basculé à l’âge de dix-neuf ans. « Quand j’ai quitté Atlanta en me faisant le serment de ne jamais y revenir, j’ai emporté ce que j’avais cultivé durant toutes ces années : l’évitement muet de mon passé, le silence et l’amnésie choisie, enfouis comme une racine au plus profond de moi. » Il lui fallait se confronter à son douloureux passé, laisser resurgir tout ce qu’elle avait volontairement tenu à distance, « comprendre la trajectoire tragique qu’a suivie la vie de (sa) mère et la façon dont (sa) propre vie a été façonnée par cet héritage. » Elle a vu le jour en 1966, dans le Mississipi, d’un père blanc et d’une mère noire, à une époque où les mariages interraciaux étaient interdits dans vingt et un États, où le Ku Klux Klan menaçait toujours et où la lutte pour les droits civiques s’amplifiait. Malgré les intimidations raciales quotidiennes, elle se savait protégée par le rempart d’affection que formaient autour d’elle ses parents, sa grand-mère maternelle, sa grand-tante Sugar, son grand-oncle Son et sa femme Lizzie. Après le divorce de ses parents, elle a déménagé à Atlanta avec sa mère. L’année 1973 a sonné la fin de son enfance heureuse. Joel, un vétéran du Vietnam qu’elle a baptisé d’emblée « Big Joe », a fait son apparition. Son journal se remplissait de sa détestation pour ce beau-père manipulateur et cruel, de son désarroi quand elle a appris qu’il battait sa mère, de son impuissance d’enfant. En 2005, elle a reçu des mains d’un procureur adjoint le dossier de l’affaire et découvert les dernières conversations téléphoniques effrayantes entre « Big Joe » et son ex-femme. Sept années éprouvantes ont été nécessaires à Natasha Trethewey pour composer ce splendide et bouleversant récit intime, nourri de violence domestique et raciale. L’écrivaine et poétesse américaine, lauréate du prix Pulitzer en 2006, a enfin mis des mots sur son « chagrin insupportable » et pu déclarer à sa mère tout l’amour qu’elle lui porte. « C’est long, trois décennies, pour apprendre à reconnaître les contours de la perte, pour arriver à créer une intimité avec son propre chagrin. On s’y habitue. La plupart du temps, il reste distant, toujours à l’horizon, voguant vers moi avec sa pesante cargaison. » Éd. de l’Olivier, 224 p., 21,50 €. Élisabeth Miso
Kaoutar Harchi, Comme nous existons. « Il fallait écrire, rendre compte de tout ce qui avait été vécu, dit, entendu, éprouvé car ce n’est que pour cela que tout était arrivé : pour que j’en fasse état, un jour. Et que jamais rien de nous, comme nous existons, ne disparaisse. » Dans ce très beau récit autobiographique, Kaoutar Harchi revisite ses souvenirs d’enfant, d’adolescente et d’étudiante à la lumière de la chercheuse en sociologie qu’elle est devenue. Tout à la fois objet littéraire et subtile étude sociale, l’ouvrage insère son parcours intime dans une histoire plus large de l’immigration postcoloniale, du racisme, des rapports dominants-dominés. L’écrivaine y fait entendre son profond attachement aux siens et son expérience commune à bien d’autres de la violence sociale. Née en 1987, elle a grandi dans le quartier de l’Elsau à Strasbourg, dans une famille d’immigrés marocains. Petite-fille, elle était fascinée par le film du mariage de ses parents à Casablanca, par cet ailleurs synonyme de joie et de nostalgie pour ses parents. En France, l’existence de Hania et de Mohamed, invisibles agents de ménage, est une lutte constante. Tous leurs espoirs et leurs efforts se concentrent sur l’avenir de leur fille, sur la place qu’elle aura dans ce monde. Par peur des mauvaises influences, sa mère se démène pour qu’elle intègre un collège privé catholique. Kaoutar Harchi va alors être confrontée au racisme, aux humiliations, à la honte, sans encore en comprendre tous les ressorts. À dix-sept ans, elle découvre La Double Absence. Des illusions de l’émigré aux souffrances de l’immigré du sociologue algérien, Abdelmalek Sayad, lecture fondatrice à l’origine de sa formation en sciences sociales. Ce livre « (…) donna sens, un sens inespéré, longtemps introuvable, à ce sentiment ambivalent de vivre et de ne pas vivre. Ce livre a projeté ses lumières sur mes hantises, mes doutes, mes soupçons. Il fut, entre mes mains, telle une cartographie de notre vie. La carte grâce à laquelle je pus partir à notre recherche. » Éd. Actes Sud, 144 p., 17 €. Élisabeth Miso
Gérard Haddad, Antonietta, Lettres à ma disparue. Il écrit à celle qu’il aime, qui a partagé cinquante ans de sa vie, qui vient de mourir d’une maladie longue, douloureuse, dégénérative. Comment continuer de vivre, comment la faire revivre, comment raconter au plus près du souvenir ? « – Va-t’en ! Va-t’en ! Et ne remets plus les pieds ici ! C’est fini ! Je ne veux plus te revoir ! » lui crie-t-elle à la figure, alors qu’il venait de la quitter après une visite chez le médecin, pour aller acheter des médicaments à la pharmacie. Désormais, le mal progressera inexorablement, et il vient d’en faire apparaître les tout premiers symptômes. Bientôt, il saura mettre un nom sur cette maladie d’Alzheimer. « Je m’absente progressivement à moi-même », finit-elle par dire, lucide sur ce qui lui arrive. « C’est l’histoire de ta maladie, ou plutôt en cet être nouveau que tu es devenue, si impressionnant dans sa dignité, sa gentillesse sans faille, sans mots, puisque le langage t’a progressivement abandonnée. » Est violent, ce décalage entre la malade, attentive à ce qui lui arrive, et le mari, pressé par d’autres tâches, agacé, et dans un absolu et attendu déni. Lui, le médecin, psychiatre, psychanalyste lacanien réputé, essayiste, talmudiste, dont, dévouée, fervente, elle tapait les textes, telle une dactylographe émérite. Elle sait, il nie, avoue ses impatiences, ses moments d’éloignement, jusqu’à ce que lui apparaisse la vérité, jusqu’à ce qu’il comprenne qu’il aura même à assumer de la voir faire sous elle et être capable de nettoyer son corps avec le même indéfectible amour. De l’espoir vain de guérison en crises terribles, petit à petit, une même volonté de lutter contre le mal reprend le dessus. Pages très belles où l’auteur se remémore les premières années de leur rencontre et de leur immédiate vie commune : elle, magnifique Italienne joyeuse, lui sépharade de Tunisie, à des années-lumière de sa foi et de sa vertu… Éd. du Rocher, 216 p., 16,90 €. Corinne Amar
Benny Mer, Smotshè, Biographie d’une rue juive de Varsovie. Traduit de l’hébreu par Gilles Rozier. Voilà un projet merveilleusement atypique : la quête de Benny Mer d’une artère engloutie de la Pologne juive de l’entre-deux guerre. La rue Smotshè, jadis peuplée par une galaxie trop souvent réduite à l’appellation « yiddishland ». Or, celle-ci recouvrait des réalités socio-culturelles très disparates. On y trouvait toutes sortes de petites gens, des juifs pieux, mais également des révolutionnaires et des poètes dont son auteur reconstitue la généalogie grâce à un travail de recherche relevant quasiment de l’archéologie, tant ses traces sont profondément enfouies sous terre. À travers cette enquête se dessinent petit à petit les contours du rapport intime de son auteur avec le yiddish : « la rue Smotshè est pour la topographie ce que le yiddish est pour les langues ». La biographie est une chose et les qualités, ou les défauts, d’un homme que l’on voit apparaître à travers celle-ci en est une autre pour paraphraser Marcel Cohen. Lorsqu’on se penche sur celle de Benny Mer, nous apprenons qu’il a co-dirigé au mitan des années deux-mille une revue en hébreu consacrée à la culture yiddish et qu’il a traduit, toujours vers l’hébreu, les poètes de langue yiddish, Malka Locker et l’immense Avrom Sutzkever (dont l’œuvre poétique complète a récemment fait l’objet d’une publication aux Éditions de l'Éclat). On écrira désormais : Benny Mer (pseudonyme de Benjamin Majersdorf), né à Tel-Aviv en 1971, cartographe passionné d’un nulle part vertigineux. Éd. de l’Antilope, 384 p., 23,50 €. Mikaël Gómez Guthart. À paraître le 1er octobre.
Luc Chomarat, Le Fils du professeur. « En classe, je n’étais plus le chouchou de personne. Je n’avais pas encore eu le temps de me faire un copain dans cette classe où je ne connaissais personne, et pour tout le monde j’étais déjà le fils du professeur. C’était tout ce qu’ils savaient de moi, et ça leur suffisait. » Quand on est enfant, on peut raconter ce qu’on veut sur sa famille à ses copains, s’inventer des parents aux métiers prestigieux, sauf quand on a un père professeur d’histoire dans son nouveau collège. Journal d’une enfance vue à la hauteur des yeux d’un jeune narrateur dans les années 60, né, comme son auteur, en Algérie française à Tizi-Ouzou, puis arrivé en famille en France à l’âge où on apprend à lire et à compter. Du rapport à la langue aux relations amicales, sociales, et à ses manques, jusqu’aux émois propres à l’adolescence, surgissent une sensibilité au quotidien et au détail, à la solitude, née de la différence. Références culturelles, sociologiques, d’une époque avec ses rentrées des classes, ses parties de football, ses jeux de cowboys et d’indiens, ses séries télé, Les envahisseurs, Au nom de la loi… La voix de l’enfant nous fait assister à la transformation de ce moi en adulte. Il y a l’importance de l’école, les noms et les particularités des professeurs, ce monde peuplé à lui tout seul, cet univers dans lequel parfois il aimerait pouvoir nager, anonyme, mais pour un fils de professeur, c’est impossible. Sa mère est belle et ressemble à une héroïne de la Nouvelle Vague, il se rêve des vies mais ne peut les partager comme si elles étaient sa réalité ; l’Algérie traverse son imaginaire, ce pays qu’il a si peu connu mais dont il a des fantasmes, tel celui de la guerre, que les hommes de la famille évoquent. C’est un récit initiatique ou comment trouver sa juste place dans la cour de récréation, au milieu de questionnements existentiels, et à cet âge où commence l’inquiétude et la fascination pour l’autre sexe… Mélancolie du souvenir et sa légèreté, sa profondeur. Éd. La Manufacture de livres, 272 p., 19,90 €. Corinne Amar
ROMANS
Christophe Boltanski, Les Vies de Jacob. Après La Cache (2015) et Le Guetteur (2018), deux récits familiaux, Christophe Boltanski s’est laissé happer par l’histoire d’un anonyme, unique sujet d’un album de photos déniché aux Puces, confié par une productrice de cinéma. Sa mission initiale était d’en tirer matière à un synopsis de fiction ou de documentaire. Les 369 photomatons du même homme, multipliant les travestissements et les expressions, ont commencé à l’obséder. Quel secret renfermaient ce sourire figé ou ces regards mélancoliques ? « Comment ne pas percevoir la faille du personnage ? On sentait un trouble derrière sa joie forcée. Sa prolixité en tout trahissait un manque. Sa manie de collectionner son nom et son visage suscitait un étrange sentiment d’absence. » Le romancier a minutieusement examiné l’album, traquant le moindre détail susceptible de l’éclairer sur l’identité de cet inconnu. Sur la base de maigres éléments : des photos datant de 1973-1974, quelques annotations en hébreu, vingt-quatre lieux de résidence entre 1970 et 1974 et une étiquette mentionnant l’ambassade d’Israël ; il s’est lancé sur ses traces. « Au début, il ne s’agissait que d’un jeu de piste, de partir à la poursuite d’un inconnu, de reconstituer sa vie et, à défaut, de l’inventer. Pris dans son sens littéral, un album, c’est une page blanche. On peut y mettre ce qu’on veut. » Au fil d’une enquête qui l’a conduit en France, en Tunisie, en Suisse, en Italie et en Israël, il est parvenu à redonner forme à la trajectoire d’un certain Jacob B’chiri, révélant les ambitions contrariées et les cheminements complexes d’un être meurtri par l’exil et par une trahison familiale. Toujours inspiré par ce que l’écriture peut arracher à l’oubli et à l’effacement, Christophe Boltanski brosse ici le passionnant portrait d’« Un anonyme aux noms multiples, à la vie immense et minuscule. Un héros ordinaire, d’une singularité absolue, qui a connu un sort partagé par des millions d’autres. » Éd. Stock, 240 p., 19,50 €. Élisabeth Miso
Serge Airoldi. Si maintenant j’oublie mon île, Vies et mort de Mike Brant. On le sait, on l’a appris, peut-être même parfois mécaniquement psalmodié sans en prendre la véritable mesure, à la façon d’un catéchisme sans Dieu. Mais ce n’est la plupart du temps que pure théorie : un écrivain est avant tout une voix. Un timbre, une scansion secrète. Celle de Serge Airoldi chante une mélodie rare, délicate, quasiment d’ordre mystique et d’une extrême précision. Chaque mot, chaque phrase, ont été de toute évidence soupesés, mesurés, comme une longue méditation. Son sujet, le suicide du chanteur Mike Brant survenu au printemps 1975 à qui il s’adresse directement, comme une étrange prière est à bien y regarder la porte d’entrée – une brèche creusée par le silence, celui de Mike Brant, dont on apprend le mutisme jusqu’à l’âge de cinq ans – pour explorer les abîmes de sa biographie tragique et celle de ses parents, tous deux rescapés de l’horreur nazie. Ce roman, par-delà son élégance et sa pudeur strictement formelles, est une prodigieuse réflexion sur l’écriture, le rapport au sacré (pour lui qui « fréquente un autre livre que le Talmud et la Torah »), mais aussi sur la place de la parole et de son inévitable versant, le silence, loin des lieux communs cent fois, mille fois rebattus et des formules prêtes à l’emploi. En plus d’un exceptionnel musicien, Serge Airoldi est un très grand écrivain. Et son livre, un chef-d'œuvre. Éd. de l’Antilope, 160 p., 17 €. Mikaël Gómez Guthart.