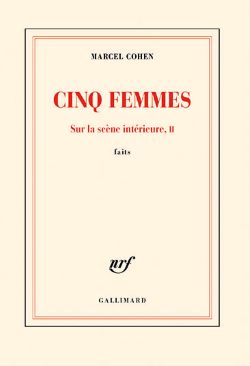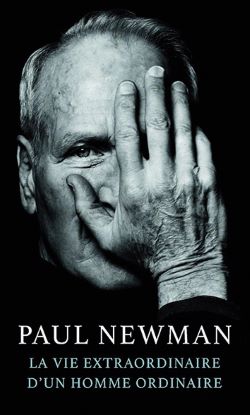Romans
Tove Ditlevsen, Enfance - La Trilogie de Copenhague I. Traduction du danois Christine Berlioz et Laila Flink Thullesen. « Sombre est l’enfance, elle gémit sans cesse comme un petit animal que l’on a enfermé dans la cave et oublié là. Elle sort de la bouche comme de la buée et elle est tantôt trop petite, trop grande. Elle n’est jamais à la bonne taille. » Dans ce premier volet de sa trilogie autofictionnelle, publié en 1967, Tove Ditlevsen (1918-1976) se retourne sur sa triste enfance à Copenhague. Au fil de ces trois volumes, la poétesse et romancière danoise expose toute la détermination qu’elle a dû déployer pour faire entendre sa voix d’écrivaine, malgré ses origines prolétariennes. Considérée comme la pionnière de l’écriture autobiographique, elle convoque ici ses premières années d’existence dans un monde qui lui apparaissait comme un cauchemar. Avec ses parents et son frère, elle partageait un petit deux-pièces dans le quartier ouvrier de Vesterbro. Elle cherchait désespérément à plaire à sa mère et à percer sa violence et ses silences. Son père, amateur de littérature et socialiste, perd son emploi quand elle a six ans, elle observe alors ses parents se débattre avec la honte de la pauvreté. Elle se sentait étrangère dans son foyer, différente des autres enfants, ne trouvait de réconfort que dans les livres et dans les mots qui « rampaient lentement autour de (s)on esprit en tissant une sorte de membrane protectrice. » Elle rêvait de devenir poète et de trouver une âme sur cette terre qui la comprendrait pleinement. Elle a côtoyé très tôt d’autres souffrances que la sienne, mesuré le lourd fardeau de naître fille, entrevu les obstacles à abattre pour se soustraire à un destin tout tracé. « Je pensais que mes poèmes recouvraient les zones trouées de mon enfance comme une nouvelle peau délicate se forme sous une blessure dont la croûte n’est pas encore entièrement tombée. Ma silhouette d’adulte pourrait-elle en émerger ? » Ce premier volume se clôt sur son angoisse d’adolescente face à la vie d’adulte qui l’attend. Trente ans après une première parution aux éditions Stock, les éditions Globe offrent une nouvelle traduction de ce chef-d’œuvre des lettres danoises. Éd. Globe, 160 p., 18 €. Elisabeth Miso
Autobiographies / Mémoires
Marcel Cohen, Cinq femmes, Sur la scène intérieure, II – Faits. Comment survit-on à la tragédie, quand on est un enfant juif de cinq ans en 1943 à Paris, et qu’on se retrouve du jour au lendemain sans parents, sans famille, à peine sorti des bras de sa mère, sans même sa petite sœur, Monique, âgée de six mois, tous emmenés et assassinés à Auschwitz ? L’enfant a grandi, a survécu, appris, comme il a pu, à apprivoiser le deuil inconsolable. Adulte, il rend hommage aux femmes qui lui ont tendu la main, sauvé la vie et lui ont – plus que les hommes n’ont pu le faire – transmis le goût de vivre et du savoir. Cinq portraits, fragments de mémoire sortis du plus profond, du plus douloureux de l’intime, intitulés Faits, et poignants : cinq héroïnes qui ne pensaient pas l’être, arrachées à l’anonymat. À commencer par Annette, au service de ses parents et grands-parents, depuis des années. « Le 14 août 1943, dans l’après-midi, Marie demande à Annette qu’elle veuille bien me mener au parc Monceau. Il y a un piano chez mes grands-parents. J’étais, paraît-il, déchaîné ce jour-là, et tout avait été tenté pour que je cesse de taper sur le clavier. Avec son étoile jaune, Marie n’est plus autorisée depuis longtemps à pénétrer dans un jardin public et je n’étais pas encore astreint au port de l’étoile puisque je n’avais pas six ans. » Lorsqu’ils reviennent du parc, la concierge les attend pour prévenir Annette de ne pas monter à l’appartement, que la police s’y trouve pour emmener tous les membres de la famille, parce que juifs. Destination qu’ils ignorent : les camps d’extermination. Annette se retrouve dehors avec le petit Marcel qu’elle prend sous son aile, prête à l’accueillir à Messac, en Bretagne, chez celui qu’elle vient d’épouser. Non juive, elle sait qu’elle peut être utile. Annette sauvera la vie du petit Marcel, comme après elle, Raymonde, Lily, Melle Gobain, Gabrielle… De ces femmes courageuses, Marcel Cohen restitue l’humanité, la dignité et la force de vie. Éd. Gallimard, 192 p., 19 €. Corinne Amar
Vera Brittain, Mémoires de jeunesse. La photographie de couverture comme les quelques portraits très beaux que l’on a d’elle la montrent en uniforme du Détachement d’Aide Volontaire, entre 1915 et 1919 ; autrement dit, les plus belles années de la vie, lorsqu’on est une jeune Anglaise, tout juste étudiante à Oxford College, issue d’une famille aisée de papetiers, qu’on a l’ambition résolue de faire des études de littérature, qu’on a un fiancé, un frère cadet adoré, des amis. Mais tous ces garçons (qui n’en reviendront pas) partent pour le front. Elle s’engage à son tour. « Lorsque la Grande Guerre éclata, je n’y vis pas une tragédie superlative mais plutôt l’interruption singulièrement exaspérante de mes projets personnels ». Ainsi, commence le Journal de Vera Brittain (1890-1970) qui, en quatre-vingt ans d’existence, n’allait plus pouvoir vivre une fête sans que toute joie ne fût assombrie par le souvenir et le deuil. Expérience traumatisante que celle de la Première Guerre mondiale, pour l’avoir vécue, pour avoir touché la mort ou l’horreur de si près, d’un hôpital à l’autre, pendant trois années, et dont elle revint avec l’intention de l’écrire et de la raconter. Vera Brittain fut tout à la fois infirmière, journaliste, poétesse, écrivaine, militante pour la paix et pour le droit des femmes. D’une tendresse bouleversante pour les uns et les autres, lorsqu’elle écrit ou reçoit des lettres, de son frère, de son fiancé (ils s’écrivaient beaucoup, s’échangeaient des poèmes, se livraient : il meurt trois jours avant leurs retrouvailles tant espérées) ; d’une prodigieuse lucidité, d’une intelligence si fine doublée d’humour, ses Mémoires de jeunesse donnent à lire le témoignage d’une existence profondément marquée par le fait que tout un pan d’une jeunesse avait été sacrifié, « génération perdue », brisée en plein élan, et le refus de l’oublier. Le tout, magnifiquement traduit. Traduction de l’anglais, Josée Kamoun et Guy Jamin. Éd. Viviane Hamy, 724 p., 26 €. Corinne Amar
Paul Newman, La vie extraordinaire d’un homme ordinaire. Traduction de l’anglais (États-Unis) Serge Chauvin. En 1986, l’année de son Oscar d’honneur, Paul Newman entame à soixante et un ans un projet d’autobiographie avec son ami le scénariste Stewart Stern. Ces entretiens, redécouverts en 2019 par ses filles, ont nourri ces Mémoires posthumes. La star hollywoodienne s’y dévoile avec une grande sincérité, ne cachant rien de sa vulnérabilité et de ses zones d’ombre. Qui pourrait imaginer, en voyant le charisme et le talent qu’il dégage à l’écran, que Paul Newman était habité par tant de doutes ? Né en 1925, il a grandi avec son frère Arthur à Shaker Heights (Ohio), entre un père juif, taiseux et alcoolique, et une mère catholique qui l’étouffait de son attention, mais était incapable d’aimer quiconque réellement. Stewart Stern explique « qu’il se sentait souvent comme anesthésié, au point de refouler presque toute son enfance – qui n’était plus qu’un trou noir. Il n’a cessé de chercher la réponse à l’énigme de sa personnalité (…) » Ne se reconnaissant aucune compétence particulière, il se lance dans le théâtre, la seule voie où il prend du plaisir. Il sait ce qu’il doit à son physique et s’est toujours interrogé, malgré le succès, sur sa capacité à restituer des émotions dont il n’avait pas conscience lui-même. Sa rencontre avec sa seconde femme, l’actrice Joanne Woodward, a été décisive. « Joanne avait fait éclore une créature sexuelle. Elle l’a éduquée, l’a encouragée, se délectant à tout essayer. J’étais en quête de jouissance. C’est elle qui m’a inventé. », confie-t-il. L’inoubliable interprète de Butch Cassidy et le Kid, de L’Arnaqueur ou du Plus sauvage d’entre tous, scrute sa trajectoire intime, ses relations avec ses six enfants, son rapport à son métier et à la célébrité, sa passion pour la course automobile, son goût du risque, son addiction à l’alcool, son engagement politique et philanthropique. Des témoignages de ses proches, d’acteurs et de prestigieux réalisateurs qui l’ont dirigé tels qu’Elia Kazan, John Huston ou Sidney Lumet se mêlent à son propre récit, éclairant les multiples facettes d’un homme complexe et d’un des acteurs les plus magnétiques du cinéma américain. Éd. La Table Ronde, 352 p., 24,50 €. Elisabeth Miso
Essais
Rosa Montero, Le danger de ne pas être folle. Traduction de l’espagnol Myriam Chirousse. « Je crois que nous autres romanciers avons presque tous l’intuition, le soupçon ou même la certitude que, si nous n’écrivions pas, nous deviendrions fous, ou que nos coutures lâcheraient, que nous tomberions en morceaux, que la multitude qui nous habite deviendrait ingouvernable. » Il y a vingt ans, dans son roman La folle du logis, Rosa Montero s’intéressait déjà à la relation entre création et folie. Cette fois-ci, à la frontière de l’essai et du récit introspectif, elle fait se rencontrer neurosciences, psychologie et littérature dans une subtile analyse de l’activité psychique de l'artiste ou de l'écrivain. Elle-même a « toujours su que quelque chose ne fonctionnait pas bien dans (s)a tête ». Elle a fait l’expérience d’épisodes hallucinatoires et ses crises de panique ont disparu à trente ans, à la parution de son premier livre. « Je fais partie de la statistique générale, de ces 25 % d’individus qui développeront un problème mental au cours de leur vie, et aussi, par conséquent, de la statistique particulière des écrivains cinglés. », décrit-elle avec humour. Les auteurs aux prises avec des accès de folie, des états dépressifs ou des addictions sont légion, comme elle le rappelle avec force références. Elle dresse la liste des caractéristiques propres aux écrivains : une immaturité cérébrale (observée chez les malades mentaux et les artistes), une hypersensibilité émotionnelle et sensorielle, une aptitude plus grande à la dissociation, une imagination foisonnante et parallèle… La célèbre chroniqueuse d’El País sonde ce besoin irrépressible d’écrire, de se projeter dans d’autres que soi pour tenter de « donner une apparence de causalité et de sens à une réalité qui n’est que fureur et bruit. » Elle déroule son admiration pour Emily Dickinson, Sylvia Plath, Janet Frame ou Emmanuel Carrère et comprend parfaitement les tourments intérieurs qu’ils couchent sur le papier. Bien qu’il questionne le déséquilibre mental chez l’artiste, le livre de Rosa Montero n’a rien de pesant. Il est au contraire une enthousiasmante et fascinante plongée dans le processus créatif, le fonctionnement de notre cerveau et la puissance de l’art. Éd. Métailié, 288 p., 20,80 €. Elisabeth Miso