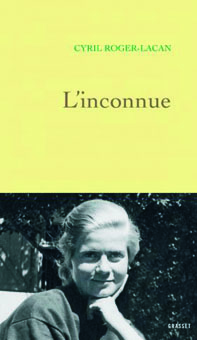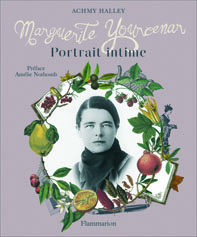ROMANS
Linn Ullmann, Le registre de l’inquiétude. Traduction du norvégien Céline Romand-Monnier. À la fin de sa vie, Ingmar Bergman aurait aimé écrire sur la vieillesse mais il ne s’en sentait plus la force. Avec sa fille Linn Ullmann, il penche alors pour un livre d’entretiens. Ils préparent leur projet pendant deux ans et commencent leurs séances de travail au printemps 2007. Pour cela, ils se retrouvent dans la maison de Hammars, sur l’île de Fårö, où le metteur en scène suédois a prévu de mourir « l’endroit dont il était tombé amoureux était une plage de galets déserte, quelques pins tortueux. Il s’y est aussitôt reconnu, ceci était son endroit, il correspondait à ses représentations intimes de la forme, de la proportion, de la couleur, de la lumière et de l’horizon. » Le père évoque ses premières émotions d’enfant à l’opéra, sa passion pour la musique qui lui procure « un sentiment d’élévation de la vie », « son intérêt colossal » pour les femmes, ses rêves ou la disparition de la sexualité. Mais très vite les conversations s’avèrent confuses du fait d’une mémoire et d’un rapport à la réalité défaillants. « Cet été-là, tout s’articulait autour de mourir, le dernier gros boulot, la mort s’appuyait contre la vie, la vie s’appuyait contre la mort, le matin il se réveillait et s’endormait le soir, et cependant il mourait chaque jour. Son cœur battait, mais son absence était écrasante. » Ingmar Bergman s’éteint le 30 juillet 2007. Sa fille a gardé le magnétophone trois ans dans son sac à main avant de le ranger dans un tiroir. Longtemps l’image du père sur son lit de mort a tout recouvert puis en 2014, les enregistrements et les souvenirs ont refait surface. Linn Ullmann, est née hors mariage en 1966, de l’histoire d’amour entre le célèbre cinéaste et l’actrice norvégienne Liv Ullmann, de vingt ans sa cadette. Elle a grandi avec sa mère à Oslo et aux États-Unis et retrouvait son père l’été à Hammars. Elle a souvent été confiée à sa grand-mère et à des bonnes d’enfant, sa mère voyageant beaucoup pour son métier. Elle ne désirait rien tant que sortir de l’enfance, quand ses parents voulaient eux y rester. Chacun à leur manière, ils ont été des pôles fascinants. Linn Ullmann explore avec subtilité et tendresse les questions de la mémoire, du deuil, du manque, de la transmission et de ce que l’enfance dépose en chacun de nous. « J’essaie ici de comprendre quelque chose sur l’amour, et sur mes parents, j’essaie de comprendre pourquoi la solitude joue un tel rôle dans leur vie, et pourquoi, plus que tout au monde, ils avaient si peur d’être abandonnés. » Éd. Actes Sud, 432 p., 23 €. Élisabeth Miso
Hélène GESTERN, L’eau qui dort. « Le week-end dernier, j’ai retrouvé une carte postale dans le chalet. Elle était coincée entre le lit et le mur et elle est tombée quand j’ai changé les draps. (...) Ni date, ni timbre, juste deux lignes inscrites au dos. » Un homme sort de chez lui un jour et ne revient pas. C’est l’histoire d’un homme qui s’est toujours senti minable, l’histoire d’un représentant de commerce brutalement licencié, au couple vacillant, humilié par sa femme qui, réveillé un matin avec une crise d’herpès, prend sa voiture et file sur la route, pour finir par se réfugier dans un hôtel médiocre d’une petite ville de province. Là, le souvenir afflue, notamment celui de la disparition d’Irina, son grand amour de jeunesse, partie un matin, au saut du lit, vingt ans plus tôt, sans une explication. Il n’aura de cesse de la retrouver. Il change de nom, car changer de nom c’est changer de personne, c’est changer d’identité, c’est enfouir tout ce qu’on n’aime pas de soi, et croire et faire croire être un autre, trouve du travail comme ouvrier horticole dans le domaine d’une veuve qui a aménagé un parc pour visiteurs contemplatifs. C’est là, dans ce chalet qu’on lui prête, où il croit sentir le fantôme d’Irina rôder, qu’il trouvera cette carte postale, telle une énigme à déchiffrer, fondamentale à sa vie. Un sixième roman magnifique dans l’œuvre de Hélène Gestern, qui parvient, comme à chaque fois à capter l’attention de son lecteur par une écriture romanesque et pourtant érudite, méticuleusement documentée, par une énigme à résoudre, qui se développe par pans successifs, et aussi réussie que dans les enquêtes policières les plus envoûtantes. Un anti-héros à la recherche de l’histoire de son amour perdu ou comment s’arrange-t-on avec la disparition, avec le passé, avec la culpabilité, l’abandon. En questionnant les équilibres de sa propre vie, en démontant ses illusions, en trouvant en soi au fond, la réparation, l’apaisement... Éd. Arléa, 377 p., 22 €. Corinne Amar
JOURNAUX / CARNETS
Joan Didion, Sud & Ouest. Traduction de l’anglais (États-Unis) Valérie Malfoy. Sud & Ouest réunit deux carnets inédits de l’une des icônes des lettres américaines, deux carnets rédigés lors de deux voyages distincts, l’un dans le Sud des États-Unis à l’été 1970, l’autre à San Francisco en 1976. Quand Joan Didion parcourt la Louisiane, le Mississipi, l’Alabama avec son mari John Gregory Dunne, elle n’a pas de projet professionnel précis. Elle veut juste élucider comment cette partie de l’Amérique repliée sur son passé a pu représenter il y a des années « (...) l’avenir, la source secrète d’une énergie bonne et mauvaise, le centre psychique. », car elle pressent que cette immersion dans le « Sud profond » lui permettra de mieux comprendre son territoire à elle, la Californie. « À la Nouvelle-Orléans, en juin, l’air est lourd de sexe et de mort, pas la mort violente, mais la mort par déchéance, surmaturation, pourrissement, la mort par noyade, asphyxie, fièvre d’origine inconnue. » Elle voit une femme mourir au volant de sa voiture à la Nouvelle-Orléans, des maisons soufflées par l’ouragan de 1969 sur le golfe du Mexique. Partout dans les hôtels, les restaurants, les stations-service, au congrès des radiodiffuseurs du Mississipi, elle est témoin de mentalités arriérées gangrénées par l’idée de race et de classe. Partie initialement pour couvrir le procès de Patty Hearst à San Francisco pour Rolling Stone, Joan Didion dérive dans ses notes vers son enfance à Sacramento, vers son histoire familiale, une identité californienne dans laquelle elle se reconnaît pleinement. « Dans le Sud ils sont convaincus d’avoir ensanglanté leur pays avec l’histoire. Dans l’Ouest nous ne croyons pas que ce que nous faisons pourrait ensanglanter la terre, la changer, ou l’effleurer. Comment en est-on arrivé là ? Je m’efforce de situer ma place dans l’histoire. » On reconnaît la plume aiguisée de celle qui a ouvert avec Tom Wolfe la voie d’un « nouveau journalisme », sa capacité à sonder l’Amérique, à interroger sans détours les événements politiques, sociaux et culturels de son époque ou ses affres personnels comme l’ont révélé plus récemment L’Année de la pensée magique (2005) et Le Bleu de la nuit (2011), les deux très beaux essais qu’elle a consacrés à son mari et à sa fille Quintana disparus. Les éditions Grasset rééditent également son roman Mauvais joueurs. Éd. Grasset, 224 p., 19 €. Élisabeth Miso
Pippo Delbono, Le Don de soi. Il commence par raconter des histoires d’autrefois, de belles histoires émouvantes comme des contes philosophiques pour enfants le soir, ou bien, pour adultes insomniaques ou tristes, des contes qui ont une morale joyeuses, tirés d’un de ses spectacles. On le sait, c’est un révolté et un blessé, c’est un homme de théâtre qui aime le mot, la scène, le spectacle, la rencontre, tantôt violoniste tantôt acteur – mais l’acteur est un violoniste, nous dit-il – qui voyage à travers le monde, se bat avec la maladie, la dépression, frôle la folie, la tragédie, les retourne en chant. C’est un texte fait de confessions, de réflexions, de références, de souvenirs, de rencontres ; un Journal de bord fragmenté, recousu, de paroles et de vérité, traversé de cauchemars et de questionnements existentiels, parcouru de photographies intimes tels des frissons sur une peau... C’est l’histoire d’un créateur qui dit les affres de la création, dit sa découverte des techniques du théâtre oriental, le travail sur le corps, sur le souffle ; c’est un comédien, un acteur, un réalisateur, un metteur en scène dont la compagnie est une famille, qui nous raconte ses grands moments et ses grands maîtres, qui raconte, soi et le monde autour de soi ; un artiste enfin, pour qui l’art est la seule expérience qui permette de survivre, et qui fait, dans la continuité de ses précédentes autobiographies (Récits de juin (2008) et Regards (2010) une sorte de bilan de son travail et de son cheminement intérieur. Écrire, dire, se battre contre ce mental qui ment, guerroyer avec ses propres démons, ne pas perdre la foi, parler avec son cœur pas avec sa tête, autant de mantras que se répète ce cœur à vif, si sensible que tout entre en lui, tout le « perfore », mais qui dit merci à la vie, car toute chose quelle qu’elle soit est un don. Éd. Actes Sud, traduction de Federica Martucci, 90 p, 23 €. Corinne Amar
RÉCITS
Cyril Roger-Lacan, L’inconnue. « Ce nous, c’est le nom d’un trou de mémoire. De la clairière qui se formait entre tes bras mon sommeil lui-même a perdu le chemin : rien de nous deux ensemble ne s’y incarne plus. Seules y apparaissent, parfois, comme l’empreinte d’un corps sur un lit déserté, les formes vides de nos gestes. » Cyril Roger-Lacan a perdu sa mère quand il était enfant. La fille aînée du psychanalyste Jacques Lacan est morte renversée par une voiture à trente-six ans un jour de mai 1973. Ce livre bref est un poème vibrant adressé à celle dont l’absence « a fait du monde une cathédrale inhabitable », à cette inconnue dont il n’a cessé de sentir la présence dans chaque chose et de rechercher des traces au détour de conversations ou de photographies figées. L’auteur se souvient de l’annonce de la tragédie par son institutrice, des étreintes chargées de chagrin de Malou, sa grand-mère quand lui et son frère (le dramaturge Fabrice Roger-Lacan) lui rendaient visite. Il se revoit jeune homme localiser difficilement la tombe maternelle au cimetière Montparnasse. Il chérit les instants de douceur échappés de l’oubli : l’éclat du rouge des champs de coquelicots où sa mère l’emmenait au printemps, la caresse de ses mains sur son visage d’enfant. Il a avancé dans l’existence comme dédoublé, connecté en permanence à ce manque, prisonnier d’un deuil impossible. « Toute sa vie lui apparaît ainsi, comme une chambre d’hôtel laissée en désordre le matin du départ. » Éd. Grasset, 96 p., 12 €. Élisabeth Miso
CORRESPONDANCES
Philippe Annocque, Mon jeune grand-père. Philippe Annocque s’est appliqué à déchiffrer les cartes postales que son grand-père, Edmond, adressait à ses parents alors qu’il était prisonnier de guerre en Allemagne, de 1916 à 1918. Ses mots d’aujourd’hui — explications, réflexions, exclamations, questions — se mêlent à ceux écrits pour dire, 100 ans plus tôt, le rien des jours qui se succèdent indéfiniment et se ressemblent infiniment. Mais, le rien n’est pas anodin, et le prisonnier de guerre, contraint par la censure, occupe de son écriture resserrée jusqu’à l’illisible l’espace restreint des cartes, pour dire tout simplement qu’il est vivant. Dans Mon jeune grand-père, l’auteur superpose sa lecture à ce qu’il retranscrit, et cette lecture aussi il la donne à lire. (Présentation de l’éditeur).
« J’ai retrouvé les cartes postales de mon grand-père qui était prisonnier en Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, de mai 1916 jusqu’à la fin de la guerre. [...] Je présente aux [lecteurs] ma propre lecture au moment où je déchiffre la carte. Comme l’écriture est difficile à lire, je décris ce que je comprends et découvre. Je sais très peu de choses de mon grand-père car il est mort en 1928. De son retour de captivité à sa mort, il s’est écoulé dix ans pendant lesquels il a rencontré ma grand-mère et a eu deux enfants, dont mon père qui ne l’a presque pas connu. La correspondance de mon grand-père que j’appelle Mon jeune grand-père était adressée à ses parents, dont je n’ai pas les réponses. Les cartes ont été écrites au rythme autorisé, c’est-à-dire tous les 4 ou 5 jours. Le courrier mettait beaucoup de temps à arriver et mon grand-père répond parfois à des lettres déjà anciennes ou au contraire, il anticipe. Par exemple, il veut à tout prix souhaiter une bonne fête à ses parents et il leur écrit avec plus d’un mois d’avance pour être sûr que les cartes arrivent au bon moment. » Propos recueillis par Nathalie Jungerman, pour Florilettres (édition été 2015, n°195). Éd. Lunatique, 192 p., 20 €. 9 novembre 2018.
Ce livre fera l’objet d’un article dans le prochain numéro de FloriLettres (n°199, décembre 2018).
BIOGRAPHIES
Achmy Halley, Marguerite Yourcenar. Portrait intime. Préface d’Amélie Nothomb. Qui était Marguerite Yourcenar ? Derrière l’image de la grande écrivaine, première femme élue à l’Académie française en 1980, se cachait un être libre et passionné. Celle qui se considérait comme la « servante des oiseaux » et voyait la cuisine comme une alchimie, a pleinement vécu en accord avec ses convictions. Citoyenne du monde, pionnière de l’écologie, militante de la cause animale... Au travers de son art de vivre et d’une sélection de ses recettes de cuisine préférées, de nombreux documents d’archives parfois inédits et de ses écrits, se dessine le récit intime de sa vie. (Présentation de l’éditeur).
Ce livre fera l’objet d’un article dans le prochain numéro de FloriLettres (n°199, décembre 2018).
Achmy Halley est spécialiste de Marguerite Yourcenar à laquelle il a consacré de nombreux ouvrages. Ancien directeur de la Villa Marguerite-Yourcenar à Saint-Jans-Cappel, près de Lille, il lui a également consacré plusieurs expositions.
À lire, un entretien avec Achmy Halley à propos de son édition chez Gallimard de la Correspondance entre Marguerite Yourcenar et Silvia Baron Supervielle (FloriLettres janvier 2010, propos recueillis par Nathalie Jungerman) : https://www.fondationlaposte.org/florilettre/entretiens/entretien-avec-…