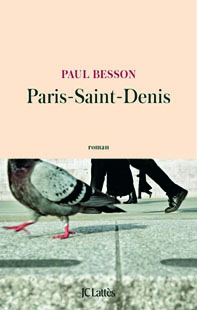Récits
Gwenaëlle Abolivier, Tu m’avais dit Ouessant. À l’automne 2015, Gwenaëlle Abolivier s’installe dans le sémaphore du Créac’h à Ouessant pour une résidence d’écrivain de trois mois. Cette voix de France Inter, qui a partagé pendant deux décennies ses pérégrinations à travers la planète, va faire sur la plus éloignée des îles du Ponant l’expérience d’une plongée en elle-même et dans l’écriture. « Je me suis dit : enfin coupée du monde ! Je suis arrivée sur cette île en naufragée volontaire avec une faim de solitude pour mieux renaître augmentée d’une nouvelle peau, celle de l’écriture. » De ce voyage intérieur dans ce bout de sa Bretagne natale et de ses rencontres avec les Ouessantins est né ce livre. Chaque jour, elle écrit dans la chambre de veille, cette pièce en arc de cercle qui lui offre une vue imprenable sur l’horizon, un éblouissement sans cesse renouvelé. « J’allais vivre dans l’haleine de la mer, captive de cette bulle océane, de ses variations et de ses couleurs, du flux des nuages et de la houle. » Les premiers temps il lui faut s’habituer au bruit du vent dans le sémaphore et aux faisceaux du grand phare la nuit. Loin de l’agitation du monde, elle s’abandonne à la contemplation, à la lenteur, et se sent « plus vivante et surtout plus en adéquation avec (ses) rêves d’enfant. » Dans sa solitude, Léonard de Vinci, Saint-Exupéry, Camus, Messiaen et Cendrars lui tiennent compagnie. La journaliste explore l’île, accueille fidèle à sa fascination de petite-fille la visite du grand phare du Créac’h comme un événement et apprivoise les habitants. À Ouessant chaque foyer abrite des histoires de marins au long cours, de pêcheurs ou de gardiens de phare, des récits de voyages extraordinaires ou de naufrages. « Dans ce lien intime avec l’océan s’entrelacent, sur cette île plus qu’ailleurs, la vie et la mort. » Sur cette île, plus qu’ailleurs, les femmes de génération en génération ont eu une réelle influence, les hommes partis de longs mois sur les mers. Une force de caractère toujours décelable chez les jeunes Ouessantines. Sur cette île jusque-là préservée, comme ailleurs, des bouleversements sont à l’œuvre. Éd. Le mot et le reste, 188 p., 17 € Élisabeth Miso
Sylvain Tesson, La panthère des neiges. Traquer la panthère des neiges sur les hauts plateaux tibétains, lui qui croyait le félin disparu, l’aventure ne pouvait que l’enthousiasmer. Sylvain Tesson a répondu à l’invitation du grand photographe animalier Vincent Munier de le suivre dans son périple entre le Chang Tang et la haute vallée du Mékong. Mais il était prévenu, l’animal risquait d’être invisible et il allait devoir se plier aux strictes règles de l’affût : attendre en silence. Un véritable défi pour ce bavard impénitent qui ne tient pas en place. L’écrivain voyageur apprend beaucoup au contact de Vincent Munier qu’il considère comme un artiste. Connu pour ses très poétiques images de loups de l’Arctique ou de grues du Japon, le photographe capture dans son objectif la beauté du monde des origines, la souveraineté animale. « Avec Munier, je commençais à saisir que la contemplation des bêtes vous projette devant votre reflet inversé. Les animaux incarnent la volupté, la liberté, l’autonomie : ce à quoi nous avons renoncé. » Chaque jour la petite troupe composée de l’auteur, du photographe, de sa compagne Marie, cinéaste animalière et de Léo, l’aide de camp philosophe, explore un territoire perché à quatre ou cinq mille mètres d’altitude, puis s’immobilise pour de longues heures de guet dans des endroits les plus propices au passage des animaux. Surgissent ainsi majestueux dans ces paysages de neige et de roche, des loups, des renards, des rapaces, des antilopes, des chèvres bleues, des chats de Pallas, des ânes sauvages, et ces impressionnants yacks sauvages tout droit sortis de la Préhistoire. « Rencontrer un animal est une jouvence. L’œil capte un scintillement. La bête est une clef, elle ouvre une porte. Derrière, l’incommunicable. » L’attente et le silence par -20°C ou -35°C favorisant les mouvements de la pensée, l’écrivain s’interroge sur la folie des hommes à se déconnecter de la nature. Il sonde aussi sa propre agitation, sa quête perpétuelle de mouvement, le point de bascule qu’a été son grave accident de 2014, l’absence de sa mère décédée peu avant sa chute d’un toit. Il sait aussi que dans chaque bête qu’il a croisée lors de ses voyages, il a cherché le visage d’une femme autrefois aimée et pressent que la vision de la panthère sera pour lui un « totem des êtres disparus ». Leur patience est enfin récompensée, la panthère des neiges s’offre à leur regard telle une apparition magique. « C’était le plus beau jour de ma vie depuis que j’étais mort. », écrit Sylvain Tesson dans cette ode au monde sauvage, cette leçon d’humilité, couronnée par le prix Renaudot 2019. Éd. Gallimard, 176 p., 18 €. Élisabeth Miso
Paul Besson, Paris-Saint-Denis. « C’est inquiétant la bohème. Je ne gagne jamais assez d’argent, tout en cavalant à longueur d’année, à chercher des plans, à travailler gratuitement, pour me faire connaître. De temps à autre, je me dis que c’est assez, qu’une activité non rémunérée n’est pas un métier mais un hobby, qu’il faut que je mette mon poing sur la table. » Le narrateur a vingt-neuf ans, est en master 2 de philosophie, cumule les petits boulots, vit chez sa copine, a des rêves d’appartement commun. Ensemble, ils visitent des logements à Paris, finissent pour des raisons économiques par atterrir à Saint-Denis. Elle est salariée, pas lui qui déambule dans la ville, fume trop, boit trop, travaille peu, observe le monde, a tout son temps. Il se rend compte à sa grande surprise qu’il ne détonne pas dans le paysage, que des comme lui – des bourgeois blancs –, on s’en moque. Il se prend d’intérêt pour cette ville, ses communautés, tous ces gens fragiles culturellement, économiquement, et invisibles, qu’il croise la nuit, dans ses errances. Il va au Monoko, le restaurant africain, où il est sûr de manger pas cher et de déguster un bon « mafé », le poulet tradi mijoté, servi à la sauce rouge de cacahuète, ou de goûter l’attiéké, leur semoule spéciale. Il y est le seul Blanc, jamais d’Arabes, presque que des Noirs. De la même façon qu’il remarque qu’il n’a « jamais vu de Noirs manger au couscous ». C’est le parcours initiatique d’un jeune homme, de Paris à Saint-Denis, avec l’acuité, l’humour, la tranquille désinvolture du rêveur, l’esprit de dérision de sa génération. C’est l’observation de la ville et de son mouvement quand on est sorti du poids, de la lumière crue, de sa journée. C’est toute la poésie de la phrase, de l’image, et le talent de son auteur qui publie son premier roman. Éd. JC Lattès, 175 p., 18 €. Corinne Amar
Biographies
Lelo Jimmy Batista, Robert Mitchum L’homme qui n’était pas là. Déjà enfant son regard pouvait déranger. On trouvait ses yeux durs et froids. « Aussi noirs et impénétrables que ceux d’un poisson. Les yeux de quelqu’un qui avait déjà longuement étudié la vie et qui était résolu à tout faire pour y échapper. » Robert Mitchum allait garder ce même regard détaché toute sa vie, indifférent aux mirages de Hollywood et de la starification. Il naît en 1917 à Bridgeport dans le Connecticut. Sa mère, restée veuve à vingt-cinq ans avec trois enfants, publie dans le journal local de Bridgeport ses poèmes. Cette première expérience de la célébrité à l’âge de huit ans l’incommode fortement. À quatorze ans, il quitte sa famille, sillonnant le pays comme d’autres milliers de vagabonds à la recherche d’un emploi après la crise de 1929 et récolte les travaux forcés. En 1934, il rejoint sa sœur en Californie qui l’encourage à intégrer sa troupe de théâtre. Mais monter sur les planches ne l’attire pas. Il préfère écrire des chansons, des pièces de théâtre et des scénarios et écumer les clubs de jazz de Los Angeles. En 1940 marié à Dorothy, son amour d’adolescence, et bientôt père, il s’épuise sur les chaînes de fabrication des usines d’armement et sympathise avec l’époux d’une certaine Norma Jean Baker. Ces deux-là, occupés à survivre, ne savent pas encore le destin qui les attend, et qu’ils partageront quelques années plus tard l’affiche de La Rivière sans retour (1954). Forcé pour des raisons de santé de gagner sa vie autrement, Mitchum tente alors sa chance dans le cinéma. Très vite, sa présence, la justesse et le naturel de son jeu, captent la lumière. Dès le début, il semble manifester peu d’intérêt pour ce métier et ne se laisse impressionner par personne. Excédé par les directives d’Otto Preminger sur le tournage d’Un si doux visage (1952) qui lui demande de malmener davantage sa partenaire Jean Simmons, il lui assène une gifle magistrale. Il n’a jamais cherché à s’exposer, encore moins à plaire. Il se moque bien d’être populaire ou non, il ne craint pas de prêter ses traits à des personnages terrifiants comme dans La Nuit du chasseur (1955) ou Les Nerfs à vif (1962). « Robert Mitchum voulait être un artiste. À la place, il est devenu célèbre. Il en a toujours voulu à Hollywood pour ça. Il aurait aimé être libre. » Lelo Jimmy Batista retrace de sa plume enlevée le parcours d’une légende du cinéma américain et livre le portrait attachant d’un immense acteur malgré lui. Éd. Capricci, 128 p., 11,50 €. Élisabeth Miso
Mémoires
Agnès b., Je crois en l’âme. C’est un recueil de souvenirs issu d’entretiens avec la journaliste Patricia Khenouna où la styliste, mécène, collectionneuse, Agnès b, évoque sa vie, et par-dessus tout, son rapport à la foi. De brefs chapitres initiés par des titres évocateurs : Versailles, la ville où elle a grandi à proximité du parc et du château ; le mot Beauté qui, dans la nature ou les œuvres d’art, la renvoie toujours à Dieu ; Au catéchisme, où elle allait, enfant, tous les dimanches à 10h30 à la Cathédrale Saint-Louis de Versailles chanter des cantiques en latin ; ses Premiers émois artistiques, ses Premiers pas de styliste... « À 17 ans, j’épousais l’éditeur Christian Bourgois, à 19 ans, je mettais au monde mes jumeaux et à 21 ans, je reprenais ma liberté. J’ai vécu avec mes enfants dans un minuscule appartement boulevard Saint-Michel, au cinquième étage sans ascenseur. C’était la galère mais je n’étais pas malheureuse. Tout au long de mon enfance, on m’a répété : Débrouille-toi. Je me suis débrouillée. » Dans la famille bourgeoise, de droite, chrétienne, dans laquelle elle a grandi, le divorce n’était pas bien vu, elle est seule mais a pour elle, une croyance en la foi. Il lui faut vivre, alors elle chine, s’habille aux puces, et son allure attire l’attention d’une rédactrice mode du journal Elle qui lui fait une proposition. La voilà qui dessine à l’aquarelle des fiches de vêtements modulables. Elle est engagée mais elle sait que c’est la création qui l’intéresse ; être « styliste », le mot lui parle. Plus tard, elle dira : Je n’aime pas la mode. J’aime les gens et les vêtements, c’est différent. Elle évoque ses engagements, son souci de l’environnement, s’exprime sur son amour de l’art, essentiel pour elle, dit son admiration pour le courage, les courageux, la figure de son père qu’elle vénérait... Des illustrations légendées égrainent le livre qui lui donnent la fraîcheur spontanée du Journal. Éd. Bayard, 108 p., 16,90 €. Corinne Amar