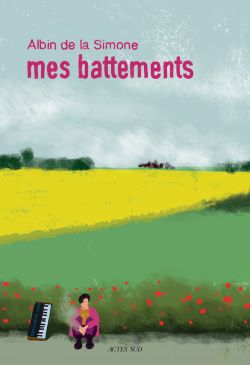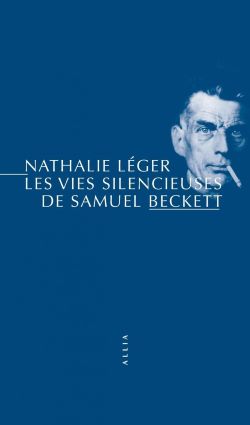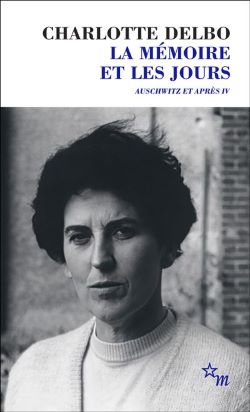Récits
Nona Fernández, Mémoire céleste. Traduit de l’espagnol (Chili) par Anne Plantagenet. À partir des évanouissements de sa mère et de ses pertes de mémoire, Nona Fernández développe une passionnante réflexion sur la mémoire intime et collective. L’autrice chilienne s’intéresse tout particulièrement à la manière dont les souvenirs et les récits que nous portons imprègnent nos vies. « Nous avons dans le corps des centaines de millions d’histoires qui viennent du passé, des messages qui circulent en nous, même si nous l’ignorons, des constellations qui nous guident et qui, en somme, constituent notre façon d’agir. Nous sommes les réceptacles de souvenirs génétiques. » Nourrissant son propos d’astronomie, d’astrologie, de neurosciences, de mythes et de fragments autobiographiques, elle démontre l’éclairage indispensable que le passé apporte au présent, l’importance de ne pas oublier. Quelles traces indélébiles ont laissé les années de dictature ? Quels récits, quels dénis la violence toujours à l’œuvre dans la société chilienne véhicule-t-elle ? Le 19 octobre 1973, quelques semaines à peine après le coup d’État d’Augusto Pinochet, la Caravane de la mort, l’effroyable escadron de l’armée, exécutait vingt-six prisonniers politiques dans le désert d’Atacama. « Vingt-six vies et vingt-six morts et vingt-six corps dissimulés dans un coin de l’Histoire, un angle mort où on ne peut plus rien chercher. » L’écrivaine s’est impliquée dans le projet de l’Union astronomique internationale de créer une nouvelle constellation dans le ciel en mémoire des vingt-six disparus. Face à la menace des idéologies autoritaires, racistes et sexistes, Nona Fernández nous rappelle qu’il serait bon de nous inspirer de Carl Sagan, l’astronome et vulgarisateur scientifique américain. « Il invitait à tout remettre en cause. À interpeller les vérités et à interroger constamment ce qui nous entourait. À ne pas se contenter des versions officielles, ni de l’ignorance totale, ni de la bêtise ou du mensonge. À regarder au-delà de notre petit territoire en utilisant toutes les possibilités dont est doté notre cerveau, qui a évolué pendant des millions d’années pour nous donner cette chance. » Éd. Globe, 176 p., 20 €. Élisabeth Miso
Albin de la Simone, Mes battements. « Depuis vingt ans, j’écris et chante des chansons. De courtes pièces où la musique et le texte se partagent le travail d’expression. Et je publie des disques qui en sont les recueils. Ce livre est lui aussi un recueil de petites pièces dans lesquelles le dessin et le texte collaborent pour vous raconter ce qui fait vibrer et rythme ma vie. Mes battements. » En tournée avec son huitième album Toi là-bas, Albin de la Simone publie également un récit autobiographique, son premier livre. Diplômé en arts plastiques, il n’a pas dessiné pendant trente ans, la musique ayant pris toute la place. Le plaisir du dessin retrouvé, il met en images et en mots des moments précis, des détails de son passé ou de son quotidien. Par petites touches légères et sensibles, il convoque des sensations, des bribes de son enfance et de son adolescence en Picardie et de sa vie d’artiste. Son regard se pose ainsi sur les branches des arbres, les couleurs vives, le papier peint de la chambre d’enfant de sa sœur dont il a reproduit le motif dans celle de sa fille, les châteaux d’eau, le lac d’Annecy, le village de Montigny-sur-l’Hallue où il a grandi ou encore sur les instruments qu’il chérit, comme Helmut, son synthétiseur préféré. Son nom à particule et les voitures de collection que restaurait son père, l’ont fait passer pour un privilégié, ce qui lui a valu quelques brimades au collège. Pourtant d’aristocrate, il n’a jamais eu que le nom. Il se souvient de toutes les filles qu’il a aimées, adolescent, sans jamais oser les aborder, de ce père singulier qui lui « glissait toujours entre les doigts ». Il a débuté comme musicien de jazz, a collaboré avec Alain Souchon, Salif Keita, Vanessa Paradis ou Miossec et a fait entendre sa propre voix en 2003. « Je chante parce que j’écris des paroles. Sans l’écriture, l’envie de chanter ne me serait pas venue, ne m’aurait pas détourné de la musique instrumentale que je pratiquais exclusivement depuis le début. » Auteur-compositeur-interprète, dessinateur, Albin de la Simone, se retourne sur son parcours et nous invite dans son monde poétique. Éd. Actes Sud, 144 p., 18 €. Élisabeth Miso
Christine Angot, La Nuit sur commande. Pour la collection « Ma nuit au musée » des éditions Stock, Christine Angot s’est vue proposer de passer une nuit dans le musée de son choix. Elle a d’abord pensé à la Wallace Collection à Londres pour Les Heureux hasards de l’escarpolette de Fragonard ou à l’église Santa Maria della Vittoria à Rome pour L’Extase de sainte Thérèse du Bernin, sculpture devant laquelle elle a pris toute la mesure de ce qu’écrire signifiait à ses yeux. « L’extase d’un autre monde. Qui existait. C’était ça et c’est toujours ça. C’est toujours ce que je ressens. J’ai toujours cette impression d’une histoire d’amour fou, d’une révélation, de quelque chose d’incroyable, qui est largement au‐dessus de moi. » La romancière a finalement tranché pour la Bourse de Commerce à Paris et a souhaité être accompagnée par sa fille Léonore, artiste. Elle s’est éclipsée à 1h15 du matin, consciente de ne pas avoir respecté le cadre habituel de l’exercice. Elle savait déjà qu’elle ne dirait rien des œuvres exposées, ne s’estimant pas légitime à le faire. Elle s’est donc emparée de cette commande en ne s’attachant qu’à ce qui l’intéresse vraiment : son personnage de narratrice, son engagement total dans l’acte d’écrire. De ses premiers pas de petite-fille à Châteauroux jusqu’à aujourd’hui, Christine Angot embrasse du regard l’itinéraire qui a été le sien. Elle raconte les années d’anxiété à redouter de ne pas percer comme écrivaine, cette existence singulière entre fiction et réalité, ses histoires sentimentales, son amour de mère, sa trajectoire sociale. De sa fréquentation du milieu de l’art, au début des années 2000, dans l’intimité de Sophie Calle ou de Catherine Millet, elle garde le sentiment de n’avoir jamais été à sa place dans cet univers de pouvoir et d’argent. Le livre sonde aussi cela, son rapport à toute forme de pouvoir, de contrainte, la manière dont l’inceste qu’elle a subi infuse toute son écriture. « Mon titre, La Nuit sur commande, je l’ai trouvé tout de suite. Il établissait un tel lien entre la commande éditoriale de passer une nuit au musée et la commande sexuelle à laquelle je pouvais être confrontée à tout moment de la nuit entre mes treize ans et mes seize ans... » Éd. Stock, 176 p., 19 €. Elisabeth Miso
Essais biographiques
Nathalie Léger, Les Vies silencieuses de Samuel Beckett. « Ces années-là, 1930-1937, il faut imaginer d’incessantes allées et venues, l’impossibilité de se fixer, la souffrance physique, un cri muet presque ininterrompu sous le regard implacable d’une mère aimante et torturante – un regard dont on sait qu’il était précisément pareil au sien, grandes mains mêmes yeux « bleu pâle aigu, l’effet est saisissant ». Ce n’est pas une biographie au sens chronologique du terme, ce sont des fragments d’une vie. Celle de l’écrivain, poète, dramaturge irlandais, Samuel Beckett (1906-1989) qui, en 1928, lecteur d'anglais, à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm à Paris, choisissait de vivre en France l'essentiel de sa vie d'adulte et d'écrire en français la majeure partie de ses oeuvres. L’auteure évoque les moments clés de son existence, ses doutes, ses errances innombrables, ses souffrances – tant morales que liées à sa santé – son refus de toute compromission, mais aussi la conscience qu'il a de sa propre valeur intellectuelle. D’un ton tantôt intimiste tantôt distancié, elle tisse un portrait intellectuel et psychologique ; elle évoque son isolement à l'origine d'une tendance dépressive, son rapport difficile sinon impossible avec sa mère, l'alcool qui va avec la mélancolie, l'Irlande, le théâtre. Elle rappelle son admiration pour Joyce (1882-1941), qu’il rencontre à Paris, qu’il fréquente, dont il imite même, pas seulement la langue, pas seulement le style, mais aussi les chaussures. Elle le suit sur le chemin de son œuvre, majeure. Une certaine austérité, un minimalisme volontaire. De lui, elle parvient à saisir ce quelque chose, ce je-ne-sais-quoi un trait, une qualité (un incident brillant de clarté formelle, dirait Beckett) qui touche et prend forme : un objet, une photographie, un détail on l'imagine chez lui, la cigarette aux lèvres, à sa table de travail : « Il médite sur la tâche infinie qui lui revient d'épuiser les mots et de continuer pourtant à les dire ». Éd. Allia, 124 p., 7,50 € Corinne Amar
Mémoires
Charlotte Delbo, La mémoire et les jours, Auschwitz et après IV. Comment écrire sur l’expérience concentrationnaire, comment expliquer l’indicible ? Charlotte Delbo (1913-1985) était la secrétaire du comédien et metteur en scène Louis Jouvet, quand elle a décidé de quitter le théâtre pour s'engager dans la résistance. Elle est arrêtée en 1942, déportée à Auschwitz en janvier 1943. Libérée en avril 1945, elle restera vingt-sept mois en déportation. À son retour, elle écrit dans l’urgence, Auschwitz et après. La Mémoire et les Jours est le quatrième et dernier tome d’un cycle. Parue en 1985, juste après sa mort, l’édition est aujourd’hui complétée d’ajouts et d’un texte inédits. « Comment ai-je fait au retour pour m’en dégager, pour vivre aujourd’hui ? Auschwitz est si profondément gravé dans ma mémoire que je n’en oublie aucun instant. – Alors, vous vivez avec Auschwitz ? – Non, je vis à côté. » Ce sont des textes distincts, deux premiers récits où l’auteure imagine une femme et un homme tous deux juifs et déportés se confiant une même obsession : la façon dont ils imaginent la mort et l’extermination de leur mère, déportée avant eux et jamais revenue. Dans le récit suivant, c’est la pensée tourmentée à l’infini, d’une femme revenue du camp au souvenir de sa soeur morte dans ses bras à Birkenau et qu’elle fut contrainte d’aller déposer en pleine nuit dans la neige, ultime linceul avant de la voir, impuissante, devenir brindille anonyme à brûler, cadavre parmi les cadavres, le lendemain. D’autres textes surgissent, de ce qui reste d’Auschwitz ; un poème ou le récit de la révolte du ghetto de Varsovie en avril et mai 1943, les dévastations de la guerre, les migrations de femmes – le souvenir de toutes ces femmes que Charlotte Delbo connut au camp, polonaises, allemandes, autrichiennes, espagnoles – dans une Europe fracturée après-guerre… La douleur persiste, résiste, et cette écriture dit, par-dessus la révolte et l’injustice, la puissance de la vie, l’amour de la vie. Éd. Minuit, collection double, 167 p., 9 €. Corinne Amar