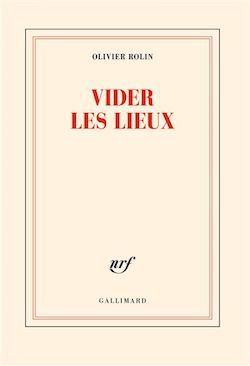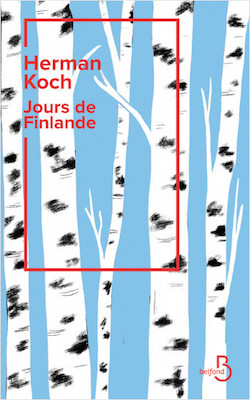ROMANS
Nane Beauregard, La Fissure. Le roman de Nane Beauregard s’apparente au kintsugi. Le kintsugi est une méthode mise au point au Japon pour réparer des objets brisés. Les morceaux de porcelaine sont recollés au moyen d’un liant et de poudre d’or. Ceci afin de sublimer la fissure. Sans préciosité, la prose de Nane Beauregard est elle aussi saupoudrée d’or et magnifie la douleur d’une mère. Elle a donné naissance à un enfant mort. Le roman se déploie amplement à partir de ce petit être qui n’a pas eu de vie. Mais il existe tout de même et son histoire se transmet à la manière d’un mythe. C’est-à-dire d’une histoire aux interprétations multiples. Dans le roman, une fissure lézarde une table en verre qui risque de se fendre et de perdre ses propriétés. Mais elle tient bon. Sa fragilité la rend-elle encore plus digne d’attention ? Pendant longtemps, la mère n’a rien dit de cet enfant particulier. De peur sans doute d’être submergée si elle l’évoquait. Nane Beauregard raconte avec une douceur très émouvante la venue au monde d’une parole. La mère ne parlait pas de cet enfant tragique « parce qu’elle savait que seul le silence reste indestructible ». Peut-être aussi n’en parlait-elle pas pour le garder au fond d’elle. Mais aussi parce que dire quelque chose de cet enfant consistait à le faire exister et donc à se le représenter. Cela supposait d’imaginer son visage. Sa présence est portée haut, comme un drapeau, par une écriture lyrique. La parole des poètes s’immisce dans cette histoire dont l’événement fondateur est un non-événement. L’enfant qui naît et qui meurt est la matrice de l’histoire familiale. Par un phrasé ample, sans limites, la narratrice, petite sœur du nouveau-né éternel, fait communiquer les mondes. Elle ne cherche pas à colmater la fissure, ou la détresse. Au contraire, elle l’explore, la sonde, elle l’élargit jusqu’à en faire un lieu, un passage. Il est d’ailleurs plusieurs fois questions de passage dans le texte. Passage d’un corps vers l’extérieur, du silence à la parole, d’un monde solaire à un autre monde hostile. Les évocations sont sensuelles. Les mots de la page sont ceux qui sont d’abord passés par la gorge. Les mondes communiquent. Les intériorités se diffusent comme de l’encre sur un papier mouillé. Elles dessinent des taches, des formes indéfinies où chacun voit peut-être un aspect de sa propre histoire, de sa perception du monde. Un monde de mots qui repose sur les épaules de l’enfant « qui nous a quittés le pied à peine posé en terre humaine en terre d’exil ». Outre la disparition de l’enfant, le livre explore la disparition de l’enfance et du paradis où la narratrice a vécu avant un long exil dans un pays démuni de saveurs. C’est l’histoire, à travers le chagrin de la mère, de celles et ceux qui ont dû quitter une terre, un monde aimé, un ventre. Et comment ont-ils survécu à cet arrachement ? Par un chant. Éd. Ramsay, 176 p., 18 €. Gaëlle Obiégly
Olivier Rolin, Vider les lieux. On habite un très vieil appartement, longtemps, très longtemps, la moitié de sa vie, où vont s’entasser les livres bien sûr, quand on est écrivain, quand on est lecteur – des milliers de livres – les lettres, les souvenirs, quelques bibelots, et puis un jour, on est viré. « II faut prendre ses cliques et ses claques », ramasser ses livres et ses souvenirs, arpenter une ultime fois l’appartement, entendre le bruit de ses pas résonner comme dans une citerne, et enfin, parvenir à se dire : je m’en vais (dernier mot de la dernière page). Un requin immobilier a pris le dessus, et le cœur de la rue la plus littéraire de Paris, la rue de l’Odéon, n’est plus ce qu’il était il y a trente-sept ans, quand Olivier Rolin y prit ses quartiers, cette rue même où l’éditrice Adrienne Monnier installait en 1915 sa librairie, La Maison des Amis des Livres.
« (...) mais ce qui traverse furtivement ma mémoire, au moment de mon départ, ce sont les mots. Longtemps après, ce n’est pas une inconnue devinée à travers la moire d’un rideau que je verrais à la fenêtre d’en face, mais une femme que j’aimais et qui m’aimait, et qui souvent traversait la rue en pyjama le matin (était-ce après le départ de sa fille à l’école ?) pour venir me visiter. Et que je n’ai pas su garder, naturellement – je ne sais rien garder, même les souvenirs il faut pour les retenir que je les aie écrits. » Exit les amours dont on se souvient soudain, les livres qu’on sort des bibliothèques de l’appartement et qu’on parcourt encore une fois avant de les ranger dans des cartons, et dont on vérifie la page de garde sur laquelle est écrit la date et l’endroit du jour où on les a lus – dans un avion ? un train ? un hôtel ? un long trajet surtout, pour savourer… Vider les lieux est un inventaire des lieux, des livres et du temps qui passe, vif ou mélancolique. Ce que recèle d’essentiellement panique, un déménagement ! Éd. Gallimard, 221 p., 18 €. Corinne Amar
Thierry Consigny, Léopoldine. Ce que nous raconte le roman, de la vie et de la mort, à dix-neuf ans, de Léopoldine Hugo, fille aînée, adorée de Victor Hugo, et de ce que fait une tragédie dans une vie d’homme, le premier paragraphe le résume en six lignes lapidaires sinon bouleversantes. « Léopoldine se noie le 4 septembre 1843, son père a quarante et un an. Lara se noie le 27 juillet 1997, j’ai trente-six ans. La mort de Léopoldine plonge Hugo dans le silence. Pendant trois ans il ne publie plus un poème, plus un vers, rien. » L’auteur qui avait consacré en 2006 un roman à sa fille, intitulé La Mort de Lara (Flammarion), trouve ici un moyen de sublimer le chagrin inconsolable de la mort d’une enfant, en plongeant dans le deuil du poète. Été 1843 : Victor Hugo (1802-1885) traverse l’Espagne avec sa maîtresse, Juliette Drouet (1806-1883), ils sont heureux, parce qu’ils s’aiment, sans contrainte, sans crainte d’être reconnus dans la rue. Hugo est marié, père de quatre enfants ; Juliette, actrice, a pour lui abandonné le théâtre et ne vit que pour lui. Léopoldine a tout juste quitté l’adolescence, elle vient d’épouser Charles Vacquerie, ami des Hugo, et passe l’été chez sa belle-famille, à Villequier, un village en amont du Havre. Ils sont à bord d’un bateau. Un vent inattendu se lève, elle tombe emportée par sa robe, se noie, son mari veut la sauver, n’y parvient pas, meurt avec elle. Hugo n’apprendra la terrible nouvelle que quatre jours après la mort de sa fille, en lisant le journal, à l’auberge où ils ont trouvé refuge. Jusqu’à la fin de ses jours, la mort de Léopoldine n’aura jamais cicatrisé, et il lui consacrera de nombreux poèmes. L’auteur évoque tantôt le poète tantôt sa fille ; surgissent alors des évocations de son propre deuil, de cette tristesse inconsolable qui, transcendée, peut mener à la joie, et permet de reconstituer les étapes de la souffrance, de la révolte contre le châtiment divin, jusqu’à l’acceptation. Un roman empreint de grâce, de littérature et de poésie. Éd. Grasset, 190 p., 18, 50 €. Corinne Amar
Herman Koch, Jours de Finlande. Traduction du néerlandais Isabelle Rosselin. En 1973, à l’âge de dix-neuf ans, Herman Koch a convaincu son père de le laisser partir dans une ferme finlandaise sur une île reculée. Après la mort de sa mère, le jeune néerlandais cherchait la solitude et à se dérober à l’inquiétude de son père quant à son avenir. Son rêve était de devenir écrivain, il ne savait quelles études embrasser pour rassurer son père. Pour ses proches, il faisait bonne figure. « Le monde anéanti n’existait que la nuit, quand j’étais seul, quand personne ne pouvait me voir. », avoue-t-il. Ces six mois passés dans les forêts finlandaises ont été une véritable renaissance. L’hiver et les travaux étaient rudes. Il n’était pas vraiment taillé pour être fermier, pour tronçonner des arbres, conduire dangereusement un tracteur, traire des vaches et labourer la terre, mais il a su gagner la confiance du couple d’agriculteurs qui l’accueillait. « J’éprouvais un sentiment de liberté, un sentiment que plus tard je n’éprouverais plus jamais. Le danger n’existait pas, ou plutôt : le danger était là, mais c’était un ami – peut-être mon meilleur ami en 1973. » Lors d’un week-end de ski en Laponie, il a sympathisé avec un professeur d’anglais, qui lui a mis Anna Karénine entre les mains, et vécu une brève romance avec Anna une adolescente. Bien sûr la mort prématurée de sa mère lui a perforé le cœur, mais il ne pouvait rester sourd à l’appel de la vie. En 2012, quarante plus tard, il revient en Finlande pour un salon du livre et les premiers mots de finnois qui refont immédiatement surface sont äiti kuollut, mère morte. « D’autres mots sont profondément enfouis dans ma mémoire, dans un lieu où un baiser pourrait les éveiller. Quelque chose, une odeur, un paysage, un fragment de musique, doit les sortir de leur hibernation. » Passant d’une époque à l’autre, Herman Koch se retourne sur son deuil de jeunesse, sur l’absence de sa mère avec qui il n’a cessé de dialoguer au fil du temps, sur ses relations complexes avec son père, sur sa rencontre avec sa femme à Barcelone, et sur cette apparition lumineuse d’Anna gravée à jamais en lui. Jours de Finlande, explore aussi l’intimité psychique de l’écrivain, le processus de l’écriture, la manière dont la mémoire et la fiction transforment les évènements car « la seule vérité est celle du livre, et non pas celle des faits tels qu’ils se sont déroulés dans le monde réel. » Éd. Belfond, 272 p., 21 €. Élisabeth Miso
RÉCITS
Annie Ernaux, Le Jeune Homme. « Si je ne les écris pas, les choses ne sont pas allées jusqu’à leur terme, elles ont été seulement vécues. », précise Annie Ernaux en préambule de son nouveau livre, rappelant d’emblée combien la vie n’a de réalité pour elle sans le prisme de la littérature. Dans ce bref récit, élaboré à la fin des années 1990, elle se concentre sur l’histoire qu’elle a eue à cinquante-quatre ans avec un étudiant de trente ans son cadet. Le jeune homme, issu d’un milieu modeste comme elle, poursuivait ses études à Rouen, ville où elle avait elle-même étudié. Son petit appartement au confort spartiate, se trouvait juste en face de l’Hôtel-Dieu, où elle avait été hospitalisée en urgence, des décennies plus tôt, suite à un avortement clandestin. Tout en lui, ses gestes, certaines de ses expressions, lui rappelaient ses origines populaires qu’elle avait fuies. « Ce que je ressentais dans cette relation était d’une nature indicible, où s’entremêlaient le sexe, le temps et la mémoire. » Du fait de coïncidences troublantes avec sa propre trajectoire et de leur différence d’âge, leur relation amoureuse prend la forme d’une singulière expérience temporelle. L’autrice de L’Événement et des Années a la sensation d’avoir déjà vécu tout cela, de s’installer dans une répétition des choses, dans une sorte d’indifférenciation des hommes qu’elle a désirés. « Avec lui je parcourais tous les âges de la vie, ma vie. » La perception des années qui les séparent, de cette longue existence qui s’est déjà écoulée en dehors de leur histoire commune, la ramène à sa mortalité et à la place centrale qu’occupe l’écriture. En une quarantaine de pages, Annie Ernaux déploie toute la puissance de sa prose incisive pour restituer au plus juste l’expérience humaine et en atténuer l’opacité. Éd. Gallimard, 48 p., 8 €. Élisabeth Miso