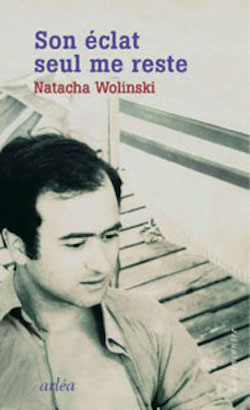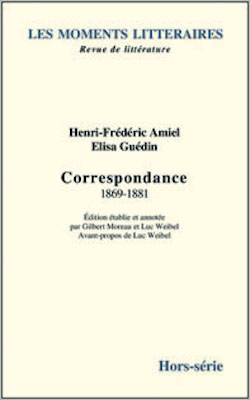ROMANS
Scott McClanahan, Le Livre de Sarah. Traduction de l’anglais (États-Unis) Théophile Sersiron. « Je n’ai qu’une certitude dans la vie. En vivant assez longtemps on se met à perdre des choses. On finit par se les faire voler : d’abord on perd sa jeunesse, et puis ses parents, et puis on perd ses amis, et puis finalement on se perd soi-même. » Depuis quelques années, Scott McClanahan, un des écrivains les plus en vue de la littérature indépendante américaine, nourrit ses romans de sa propre vie en Virginie-Occidentale. Avec Le Livre de Sarah, il décortique le délitement de son couple sur fond de réalité dans les Appalaches, une des régions les plus déshéritées des États-Unis. À aucun moment il ne se voile la face, il sait pertinemment que son addiction à l’alcool, son penchant autodestructeur et son comportement irresponsable ont eu raison de son mariage. Il se remémore par exemple le matin où il a pris ivre le volant de sa voiture, avant de s’apercevoir que ses deux enfants étaient assis sur la banquette arrière. Quand Sarah lui a fait part de son intention de divorcer, il a fait une tentative de suicide pathétique au paracétamol, puis est resté une semaine entière dans sa voiture sur le parking du Walmart, occupant ses journées à boire des packs de bière, à manger des ailes de poulet et à observer autour de lui le ballet des consommateurs et des laissés-pour-compte. Entre sa femme et lui, il y a eu des disputes fracassantes, des pleurs mais aussi beaucoup de rires et de fantaisie. Un soir où Sarah, infirmière, est rentrée déprimée de l’hôpital, particulièrement affectée par la solitude et la souffrance de ses patients, un décor de plage reconstitué avec sable et transats l’attendait au beau milieu de son salon. Si le livre relate une détresse amoureuse, il n’en n’est pas moins truffé de scènes hilarantes. Scott McClanahan conduit son récit entre lucidité, tristesse, tendresse et humour, restituant toute la beauté et la force de l’amour qui l’unissait à Sarah. Le matin de son audience de divorce, il est arrivé en retard car il a tenu à lui adresser un mail, espérant qu’à sa lecture elle renoncerait à leur séparation. Dans cette lettre d’amour, il lui disait qu’un jour il écrirait « un livre magnifique plein de douleur et de rires. » Et c’est ce qu’il a fait. Éd. de l’Olivier, 240 p., 22 €. Élisabeth Miso
Éric Chauvier, Laura. Éric et Laura se retrouvent une nuit de décembre glaciale sur le parking désert d’une usine, dans une petite ville du centre de la France. Il a quitté le décor de leur jeunesse depuis longtemps, elle, elle n’a jamais eu d’autre horizon. Mais il n’a jamais oublié l’adolescente en bikini rouge qui affolait son cœur à la piscine municipale sans qu’elle n’en sache rien. Et trente ans plus tard, le désir persiste, la beauté de Laura le fascine toujours autant malgré les traces visibles d’une déchéance. Les deux amis boivent du rosé, fument des joints et tentent de communiquer, mais la conversation s’avère difficile, décousue, trahissant tout ce qui les oppose, leurs deux mondes irréconciliables, lui le fils d’instituteur qui a réussi et elle la fille d’ouvriers à la trajectoire jalonnée d’humiliations et de galères. Éric, anthropologue, sait pour l’avoir beaucoup scruté ce que le langage révèle des relations humaines, des origines sociales, du mépris des dominants, de l’écart grandissant entre les habitants des grandes villes et ceux des régions délaissées. L’écrivain et anthropologue Éric Chauvier aime se saisir de la fiction pour déployer autrement les questions humaines au cœur de ses recherches. Ses travaux théoriques ou ses romans interrogent le quotidien, la vie ordinaire, le langage, dans ce qu’ils traduisent de conditionnements sociaux. Comme lui, Éric le narrateur de son roman, a étudié la philosophie avant de se diriger vers l’anthropologie, comme lui, il a une compagne, deux filles et évolue entre Bordeaux et Paris où il travaille. On peut voir dans ce double littéraire une part d’autofiction comme l’auteur le laisse entendre dans une interview, mais aussi une revendication sur la manière d’exercer sa discipline. Il faut se tenir au plus près des êtres et des choses, au plus près de leur parole, au plus près de la vie ordinaire, pour écarter toute idée de déterminisme et comprendre ce qui se joue profondément comme interactions humaines dans les fractures sociales de la France d’aujourd’hui. « Qui veut plonger dans l’âme de Laura se doit d’entrer, comme dans un temple oublié, dans ses façons de parler les plus ordinaires. Toute autre forme d’expertise est nulle et non avenue. Il faut revenir en littérature, dans la poétique des angles morts.» Éd. Allia, 128 p., 8 €.
RÉCITS
Natacha Wolinski, Son éclat seul me reste. Georges Wolinski a été tué le 7 janvier 2015 lors de l’attentat contre Charlie Hebdo. Sa fille Natacha dialogue ici avec lui, sondant son absence et leur relation. « Je suis née, bien avant ma naissance, dans l’oasis de tes dessins. J’ai grandi dans tes jardins secrets, dans les rêves de ta jeunesse, je suis le fruit de tes cheminements et de tes courbes indécises. J’ai vécu une partie de ma vie dans la caverne de tes retraits. » Elle s’est construite dans ses silences, sa douceur, sa légèreté et son esprit tranchant. Le dessinateur évoquait peu son passé, ne s’attardait pas sur ses chagrins, sur le décès de son père à Tunis quand il était enfant. Il ne parlait pas non plus à ses deux premières filles de leur mère défunte, il ne trouvait simplement pas les mots. Ses silences à lui ont fini par les éloigner l’un de l’autre, la fille attendant indéfiniment une parole, un récit qui ne venait pas. Comme lui, elle a grandi sous la protection d’une sœur aînée, elle n’avait que quatre ans à la mort de sa mère. « Le corps privé de mère est un corps dévitalisé, bras ballants, ventre creux, cage vide sous les côtes dans laquelle ne se glisse aucun chant. » Critique d’art pour la presse, l’auteure se trouvait à Singapour quand la terrible nouvelle lui est parvenue. « Cette distance te transformait en un astre lointain, une planète éteinte, devenue plus inaccessible encore, comme si le sort s’acharnait à mettre toujours plus de distance entre nous. » Cette nuit-là, elle a échangé au téléphone avec sa sœur et sa fille, mais était incapable de partager sa peine. Le lendemain, elle a maintenu ses interviews de galeristes, écrit calmement dans l’avion qui la ramenait à Paris. Elle désirait juste être seule et retarder le moment où il lui faudrait affronter le drame. « Je savais déjà de quoi seraient faites les retrouvailles, dans cette famille où le malheur se transmet en silence, d’une génération l’autre. » Elle se souvient de la lumière froide de l’institut médico-légal, des obsèques, de la foule présente ce jour-là qui a rendu toute intimité impossible. Natacha Wolinski témoigne de la difficulté à accepter la disparition d’un être cher et livre un délicat chant d’amour filial. Éd. Arléa, 72 p., 13 €. Élisabeth Miso
Virginie Linhart, L’effet maternel. « Tu n’avais qu’à avorter : il n’en voulait pas de cette gosse ! Il n’en voulait pas ! Ce sont sans doute ces mots proférés par ma mère qui ont déclenché ce récit. Cette gosse, ma fille donc, sa petite-fille par conséquent, dont nous venions de fêter les dix-sept ans. Que nous est-il arrivé ? Que s’est-il passé entre nous pour qu’elle soit capable de prononcer une phrase pareille ? » L’auteure, réalisatrice de documentaires, qui, en 2008, publiait Le jour où mon père s’est tu (Seuil), racontant la vie de son père, Robert Linhart, fondateur du mouvement prochinois en France, figure marquante des années 1968 et auteur d’un texte rendu célèbre, L’Établi (Minuit, 1981), évoque ici son histoire avec sa mère, en même temps que le rapport à sa propre maternité. Dans un récit mêlant à la fois l’intime et la famille, la petite et la grande histoire, l’auteure remonte le cours de sa vie d’enfant, de femme, de mère. Elle explore les dégâts laissés par la Shoah dans la famille paternelle, le rapport à la parole, au silence, mais aussi ceux causés par le féminisme des années 1970 dont sa mère fut une fière militante. Elle revisite les souvenirs heureux, douloureux de l’enfance, de l’adolescence, le père parti, l’absence de vie familiale, la peur de vivre seule la nuit sans adulte ou baby-sitter, les étés ensoleillés aussi sur la fameuse île, la grande maison où rayonnait sa mère, avec son frère, leur trio soudé, et puis les cousins, les amis, les amants de sa mère parfois de son âge, l’interdiction tacite de plaire, de grandir, de séduire à son tour. Elle dit aussi, de manière bouleversante parce que tout sonne juste, le refuge dans les livres, l’obsession des études supérieures, l’amour fou et la conviction de cet amour fou, l’envie de faire des films, et puis, la grossesse, la désertion brutale de l’amant, la trahison, la solitude, la résurrection… Il arrive parfois qu’on ait envie de dire d’un roman qu’il est saisissant tant il révèle de profondeur et, par là-même, de beauté. Éd. Flammarion, 218 p., 19 €. (Parution : 5 février 2020) Corinne Amar
Cloé Korman, Tu ressembles à une juive. « Attache tes cheveux sinon tu ressembles à une juive : d’une assignation à être plus discrète, à me conformer à une certaine norme physique, je ferai la focale de ce récit. En tant que femme, en tant qu’enfant d’une famille juive rescapée mais aussi en tant qu’écrivaine des banlieues, des minorités, des marges, le clivage pervers entre la lutte contre l’antisémitisme et les autres luttes antiracistes me choque. » Dans ce bref essai autobiographique, argumenté, ciselé, l’auteure mène son enquête dans la France d’aujourd’hui pour essayer de comprendre l’avancée du racisme et exprime un constat : il y a, en France, une façon de distinguer l’antisémitisme et le racisme comme une stratégie perverse de séparation entre les deux haines xénophobes, extrêmement dangereuse parce qu’elle sert l’extrême droite. Romancière qui, jusque-là, avait privilégié la fiction, elle parle ici à la première personne, plonge au cœur de son expérience familiale. Tu n’es pas vraiment juive, Tu ressembles à une juive... Ces phrases qu’elle avait entendues à un moment de sa vie, soit d’une étrangère alors qu’elle venait de refuser un dîner en compagnie d’autres Juifs à la sortie de la synagogue, soit de sa propre grand-mère qui lui conseillait de s’attacher les cheveux sinon elle ressemblait à une Juive, lui sont remontées à la mémoire. Au même moment, au début de l’année 2019, une vague d’événements antisémites se succédaient en France, tout aussi violents qu’extrêmement symboliques. Fille de parents militants antiracistes, il lui est indispensable de défendre un judaïsme athée, intellectuel, qui assume son caractère mélangé aux autres cultures, aux autres pays. Ce qu’elle dit, évoquant sa famille, son histoire, son rapport à la littérature comme puissance de transformation, son expérience d’enseignante en Seine Saint-Denis. Éd. Seuil, 108 p., 12 €. Corinne Amar
CORRESPONDANCES
Henri-Frédéric Amiel et Élisa Guédin, Correspondance 1869-1881. Édition établie et annotée par Gilbert Moreau et Luc Weibel, avant-propos de Luc Weibel. Henri-Frédéric Amiel (1821-1881) est l’auteur d’un journal intime dont la première édition (partielle) en 1883 lui valut une célébrité immédiate. Depuis lors, ce journal manuscrit (17 000 pages) a fait l’objet d’une publication intégrale en douze volumes aux éditions l’Âge d’homme (1976-1994). Outre son Journal, Amiel a laissé une abondante correspondance, largement inédite. Dans la dernière partie de sa vie, Amiel a échangé de nombreuses lettres avec une jeune femme rencontrée chez l’un de ses collègues universitaires, Élisa Guédin. L’éternel candidat au mariage qu’il était a-t-il songé à l’épouser ? D’entrée de jeu, Élisa le prévient qu’il n’en est pas question, en recourant à cette formule : « Homme ne suis, femme ne daigne, âme suis.»
Il en résulte pourtant une longue correspondance (144 lettres), inconnue jusqu’à ce jour, et retrouvée récemment dans une maison de campagne genevoise. De quoi parlent les deux correspondants ? De la nature de leur relation (à laquelle Amiel a donné un nom : l’« amouritié »), de la possibilité ou non de se rencontrer, de leurs lectures, de leurs idées, de leurs activités, de leurs voyages. Dans ses lettres, Amiel se montre un partenaire enjoué, habile à mener un échange qui s’apparente parfois au marivaudage. Pour sa part, Élisa révèle un visage plus ambitieux. Cette femme brillante est en quête d’une vocation. Amiel lui suggère de s’orienter vers la critique littéraire, ce qu’autorisent ses belles qualités d’analyse et de style. Elle n’en a cure. Elle voudrait se dévouer pour les déshérités. Mais ses tentatives, dans des institutions tenues par des religieuses, à Lyon ou à Paris, tournent court. Elle tient à ses aises... et à ses vacances, qu’elle passe dans des stations à la mode. Quel que soit l’état de son âme, elle s’exprime toujours avec talent, et parsème ses propos de références littéraires puisées aux meilleures sources. Parfois agacé par l’aplomb de sa correspondante, Amiel admire la qualité de son expression: il recopie plus d’un passage de ses lettres dans son journal. Cette édition est précédée d’un avant-propos de Luc Weibel, qui précise dans quelles circonstances les lettres sont arrivées jusqu’à nous. Elle est accompagnée d’un appareil de notes et d’un répertoire des personnages mentionnés, qui éclairent les nombreuses allusions des correspondants au contexte intellectuel, littéraire, religieux et philosophique de l’époque.
(Présentation de la correspondance, Les Moments littéraires)
Cette correspondance fera l’objet d’un article de fond dans un prochain numéro de FloriLettres.