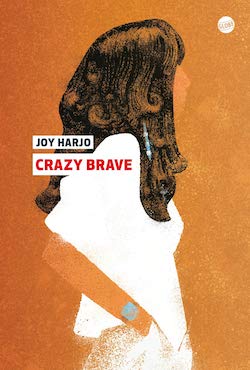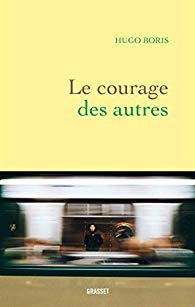AUTOBIOGRAPHIES
Kerry Hudson, Basse naissance. Traduction de l’anglais (Royaume-Uni) Florence Lévy-Paoloni. « Quand on vous a dit tous les jours de votre vie que vous n’avez rien à offrir, que vous ne valez rien pour la société, pouvez-vous échapper au sentiment d’être de basse naissance quel que soit le chemin parcouru ? » Avant de devenir une écrivaine à succès, Kerry Hudson a connu une enfance d’une extrême précarité et les tourments d’une famille instable. Parce ce que les vingt premières années de sa vie la hantaient, parce que son enfance n’était qu’un trou noir et qu’elle était assaillie par tant de questions et de terreurs nocturnes depuis trop longtemps, elle a décidé, à près de quarante ans, d’affronter ses démons en retournant sur les lieux de son passé. Réempruntant « la route erratique et nomade de (s)on enfance à travers le pays : Aberdeen, Canterbury, North Lanarkshire, Sunderland, Great Yarmouth », elle a ainsi réactivé des zones silencieuses de sa mémoire. Elle est née en 1980 dans un quartier populaire d’Aberdeen en Écosse. Sa mère célibataire, vulnérable et dépressive, cherche désespérément à s’en sortir. Son père, un américain alcoolique, diagnostiqué plus tard schizophrène, ne fait que de très fugaces apparitions. La romancière britannique se souvient d’avoir été sans cesse ballotée, d’abord seule puis avec sa petite sœur, d’un endroit à un autre, de bed and breakfast pour sans-abri en logements sociaux, consciente dès son plus jeune âge de la fragilité de son monde et des failles des adultes. Elle a été placée à deux reprises dans des familles d’accueil, a eu faim, a porté des vêtements usés et trop petits, a subi les moqueries et la cruauté des autres enfants à l’école. À l’adolescence, elle a anesthésié sa honte et sa peur de l’avenir dans l’alcool et le sexe. Kerry Hudson s’est battu pour s’extirper de la misère, a rompu avec sa famille par refus de perdre sa santé mentale. « Je l’ai fait parce que j’ai senti que je nageais vers un horizon plus dégagé, mais ma famille, par amour ou non, ne cessait de s’enrouler autour de mes chevilles, me tirant vers le fond, me remplissant la bouche d’eau sale. » Son enquête autobiographique, si elle dessine une carte de son parcours chaotique, raconte aussi d’autres histoires que la sienne, toutes symptomatiques de la violence faite aux plus démunis dans nos sociétés actuelles, malades et dysfonctionnelles. Éd. Philippe Rey, 294 p., 20 €. Élisabeth Miso
Joy Harjo, Crazy Brave. Traduction de l’anglais (États-Unis) Nelcya Delanoë et Joëlle Rostkowski. « J’hésitais à venir au monde, mais la musique m’a appelée. Dès lors, j’avais une mission. Je devais porter des voix, des chants et des histoires. Alors on les entendrait et elles pourraient se diffuser dans le monde. Ainsi j’apporterais aide et inspiration. » Joy Harjo, sacrée poétesse des États-Unis en 2019, ardente défenseuse de la culture amérindienne, a vu le jour à Tulsa, une ville creek sur la rivière Arkansas en Oklahoma. Cherokee par sa mère, Creek par son père, elle descend d’une lignée de guerriers et de chefs qui se sont opposés à la colonisation américaine et à leur déportation vers l’Oklahoma au début du XIXe siècle. Dans Crazy Brave, elle se penche sur son parcours et sur son héritage familial et tribal, révélant son courageux combat de femme. Son père, bien que très épris de sa mère, était un mari volage, alcoolique et violent. Sa mère a épousé en secondes noces un despote qui allait empoisonner sa vie et celle des ses frères et de sa sœur durant des années. La trajectoire de Joy Harjo s’est maintes fois heurtée à la domination masculine. Combien de pères et de maris indiens ont tenté d’oublier dans l’alcool et les coups qu’ils assénaient, leur rage, leurs chagrins d’enfant, les propos racistes, leurs terres spoliées ? « En quelques générations, nous qui peuplions quasiment tout le continent ne représentions plus qu’un demi pour cent de sa population. Nous étions tous hantés. » « En 1967, quand j’ai commencé l’école indienne de Santa Fe, je venais de m’évader de l’hiver affectif de mon enfance. On m’avait donné la liberté. » Au contact des autres étudiants et des enseignants, elle s’épanouit dans un cadre bienveillant et stimulant. Elle se passionne pour la peinture, le dessin, la musique et le théâtre, totalement investie dans ce formidable élan collectif artistique novateur. Jeune mère elle se retrouve pourtant à nouveau coincée dans un quotidien domestique aliénant et angoissant. Quand elle a enfin ouvert son cœur et son âme à l’esprit de la poésie, elle a pu donner une autre direction à son existence et faire que « la langue de (s)es ancêtres, complexe et métaphorique, passe dans (s)a langue et dans (s)a vie. » Éd. Globe, 176 p., 19 €. Élisabeth Miso
ROMANS
Claire Fercak, Ce qui est nommé reste en vie. Comment rendre compte de cet étrange voyage qu’est l’accompagnement d’un être cher dans la mort ? Claire Fercak, dont la mère a été emportée par une tumeur au cerveau, témoigne dans son dernier roman de cette expérience intime. Mêlant les voix de patients hospitalisés dans un service de neurologie et de leurs proches à sa propre voix, elle tisse un récit commun autour de la maladie et de la perte. « Les aidants familiaux sont très seuls, dans le désespoir sans fond de perdre la personne qu’ils aiment et de ne pas être à la hauteur de l’événement. Ils voient la mort en marche, lui serrent la main, ils ont glissé dans un univers dont ils ne pourront revenir indemnes. » L’auteure sonde avec une rare justesse le basculement du quotidien, l’aménagement de la vie professionnelle et personnelle, le sentiment de s’absenter de sa propre existence, tout entier dévoué à la personne malade, pris dans une épreuve qu’on ne peut partager. Une tumeur cérébrale incurable comme le glioblastome provoque des ravages physiques et psychiques impressionnants. Les proches doivent s’adapter « aux réactions et émotions nouvelles du patient, à son identité mouvante ». Il faut accepter sa confusion mentale, inventer de nouvelles manières de communiquer car « Vous l’aimez autant qu’avant, cet être désaccordé qui semble vivre dans l’oubli d’avoir été. » Claire Fercak souligne l’importance des choses nommées, du discours médical auquel se raccrocher, des groupes de paroles pour les familles, de l’amour manifesté à la personne qui va disparaître. Bien sûr, le livre est traversé par la peur, la douleur et le deuil mais il irradie aussi par la poésie et l’humour contenus dans les bribes d’hallucinations des malades. « Les défunts existent deux fois, la première de leur vivant, la seconde de ce qu’ils agitent en vous ; il est perpétuellement question d’eux. » Éd. Verticales, 160 p., 16 €. Élisabeth Miso
RÉCITS
Pacôme Thiellement, Tu m’as donné de la crasse et j’en ai fait de l’or. Il est vidéaste, réalisateur poète, dessinateur, essayiste, connu surtout pour ses sujets sur la pop culture, David Lynch, Led Zeppelin ou les gnostiques, pas sur sa vie intime. Sauf là. Nu, dans cet essai autobiographique. « En juin 2002, j’ai vingt-sept ans. Je pars au Japon avec Setsuko, qui est alors ma compagne. Nous débarquons à Osaka. C’est si beau que je n’arrive pas à y croire. Hélas, au lieu de me réjouir, je ne pense qu’à une chose : le fait que je n’ai pas de nouvelles de mon éditeur depuis plus d’un an. » C’est son premier livre, un essai sur le mythe de la mort de Paul Mc Cartney, il l’a envoyé à l’éditeur qui ne lui a pas répondu. Espoir mort, il est sûr qu’il ne sera jamais publié, il se croit en enfer, sabote son séjour au Japon, d’éblouissements physiques en effondrements psychologiques. Quand enfin, il a des nouvelles de l’éditeur qui publie son texte, c’est sa fiancée japonaise qui, de guerre lasse, le quitte, et à nouveau c’est l’enfer. Il est persuadé qu’il ne tombera plus jamais amoureux. Puisant dans ce registre du malheur et des scènes traumatisantes de sa vie, il veut croire que le bonheur vient d’un malheur qui a été surmonté, transformé, transmuté : regarder à l’intérieur de soi sa vie comme un livre sacré. Les souvenirs s’égrènent ; rupture amoureuse et sentiment d’être un raté, un incompris, amitiés trahies, jalousie, affres terribles de l’impuissance sexuelle, mort d’un proche. Il se confronte ainsi à ces épisodes douloureux de sa vie, transforme ses blessures, élabore une philosophie de vie, trouve sa nature. C’est drôle, incisif, poétique, habité de références à la spiritualité, à Lao Tseu, autres maîtres chinois, aux textes de la tradition hermétique. Jusqu’à emprunter un vers imparfait de Baudelaire : « Tu m’as donné de la crasse et j’en ai fait de l’or » – en réalité, « Tu m’as donné ta boue et j’en ai fait de l’or », et le faire sien. Éd. Massot, 186 p., 18,50 €. Corinne Amar
Hugo Boris, Le courage des autres. Il arrive que dans l’ennui, la monotonie, l’indifférence d’une rame de métro, un conducteur se distingue par un bon mot qui surprend tout le wagon de voyageurs. « Ligne 13, La Fourche. Annonce du conducteur d’une voix traînante et désabusée : - Je rappelle que le train est en direction de Saint-Denis. Poc, poc. Il a parlé trop près du micro. Il s’écarte un peu et ajoute : – Il desservira les gares de Ouarzazate et de Sydney. »
Il arrive aussi que dans ce même wagon, on trouve un habitué du papier, du crayon, qui rapporte ce qu’il a vu ou lu, entendu, ce qui l’intrigue, l’amuse, l’enchante. C’est le cas de l’auteur qui consigne depuis une quinzaine d’années sur des pages de cahier ou des bouts de papier ce qui se passe autour de lui dans les transports en commun.
C’est un recueil de textes, certains de trois lignes, d’autres de cinq ou six pages, qui racontent des saynètes de vie dans les trains de banlieue. Tout commence par une agression dans le RER B, alors que Hugo Boris rentre chez lui, qu’il est plongé dans un livre, que la veille, il s’enorgueillissait d’avoir gagné sa ceinture noire de karaté. Un homme hurlant, violent, provoque une altercation. Il ne bouge pas, tassé, tétanisé – courage volatilisé – il a tout juste le réflexe de tirer la sonnette d’alarme. Il s’est senti lâche, éprouve alors, le besoin d’interroger cette lâcheté, cette impuissance à s’interposer quand d’autres ont pu. Pourquoi a-t-il eu « des mains de beurre alors que la veille ses poings étaient serrés pour frapper ? » Sidération sur laquelle il revient – la peur, le courage, les réactions des hommes à des formes de violence – qu’il analyse, à partir d’autres micro-événements vécus dans les transports en commun. Le courage des autres qui redressent la tête, qui interpellent, s’interposent, font fuir l’agresseur, un jour, est devenu contagieux. Éd. Grasset, 170 p., 17 €. Corinne Amar