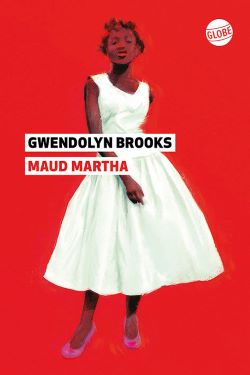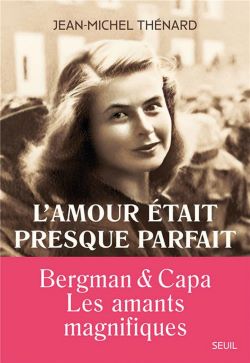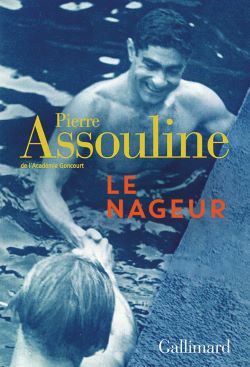Récits
Carmen Yáñez, Un amour hors du temps. Ma vie avec Luis Sepúlveda. Avec un texte inédit de Luis Sepúlveda. Traduction de l’espagnol (Chili) Albert Bensoussan. En 2020 le Covid emportait Luis Sepúlveda. Sa veuve, la poète Carmen Yáñez, raconte ici les années partagées avec l’écrivain chilien mondialement connu, sous les feux de l’amour, du militantisme et de la littérature. Ils se sont rencontrés très jeunes à Santiago, se sont mariés en 1971, ont eu un fils alors qu’ils étaient encore étudiants, à une époque où leur pays connaît de profonds bouleversements. Ils ont cru avec enthousiasme et participé activement à « la voie pacifique vers le socialisme » qu’empruntait le Chili, à cette formidable promesse de progrès social, sanitaire et culturel portée par Salvador Allende. Mais le coup d’État du 11 septembre 1973 réduit en cendres leurs espoirs et fait basculer leurs vies dans l’horreur. Luis Sepúlveda est arrêté, torturé et emprisonné à Temuco. « Son militantisme, sa participation comme garde du corps d’Allende, ses écrits engagés avec sa ferveur populaire faisaient de lui un ennemi gênant et un objectif déclaré pour « la geste héroïque » que livrait la Junte militaire en massacrant ses opposants. » Elle aussi est enlevée par la police secrète de Pinochet, torturée et incarcérée à la sinistre Villa Grimaldi. Par sécurité et parce qu’elle ressent le besoin impérieux d’exister en dehors de lui, ils se séparent en 1977. Lui, sillonne l’Amérique latine avant de s’installer en 1982 en Allemagne, elle obtient l’asile politique en Suède en 1981 et se résout à s’exiler avec son fils Carlos Lenin. Vingt ans et six enfants (à eux deux) plus tard, ils se redécouvrent. « Nous étions pleins de souvenirs. Des amis en commun que nous avions perdus, des histoires si personnelles. La jeunesse nous avait laissé une trace indélébile sur la peau. » Cette deuxième chance donnée à leur histoire, se conclut par de nouvelles noces et un nouveau cadre de vie à Gijón, dans les Asturies. Avec ce livre émouvant Carmen Yáñez, adresse une magnifique déclaration d’amour à l’homme qui a illuminé sa vie, à ses parents, à tous les compagnons de lutte disparus et à ceux qui ont résisté au pire et qui l’accompagnent aujourd’hui. Éd. Métailié, 176 p., 18 €. Élisabeth Miso
Romans
Gwendolyn Brooks, Maud Martha. Traduction de l’anglais (États-Unis) Sabine Huynh. En 1953, Gwendolyn Brooks publie son premier et unique roman. S’inspirant de sa propre histoire, la poète américaine (prix Pullitzer de poésie en 1950) y dépeint l’existence de Maud Martha Brown, une Afro-américaine de Chicago, issue de la classe ouvrière. Elle suit ainsi son héroïne des années 1920 aux années 1940, et expose en trente-quatre courts chapitres ses aspirations, ses déceptions, sa lucidité extrême, son cheminement intime et sa quête pour trouver sa place dans une société dominée par les Blancs. Enfant, Maud Martha lit, observe beaucoup et décrypte le monde avec la sensibilité poétique qui la caractérise. Elle comprend vite qu’elle n’a ni la grâce ni la beauté de sa sœur Helen. « Ce qu’elle voulait, c’était offrir au monde une bonne Maud Martha. Telle était l’offrande, la parcelle d’art, qui ne pouvait venir de nulle autre que d’elle même. » Adolescente, elle aime se plonger dans les magazines qui relatent le mode de vie des New-Yorkais, comble de l’élégance selon elle. Une fois adulte, son modeste appartement et la vie conjugale ne satisfont pas toutes ses attentes, mais elle ne se laisse pas pour autant gagner par l’amertume. Crainte qu’un ami lycéen Blanc trouve sa maison misérable, commentaire raciste d’une représentante en cosmétiques, regards des Blancs dans un cinéma, indifférence d’un Père Noël pour sa petite fille dans un grand magasin, en quelques exemples choisis de la gêne et de l’humiliation persistantes qu’éprouve Maud Martha, Gwendolyn Brooks embrasse la question raciale. « Il y avait en elle ces débris de haine contenue, de la haine sans yeux ni sourire et – chose particulièrement regrettable, qui disait son manque le plus criant – sans beaucoup de voix. ». Même au sein de son couple, sa couleur de peau pose problème, son mari aurait de toute évidence préféré épouser une femme à la peau plus claire. À travers le parcours de son héroïne, sa volonté de mener sa vie comme elle l’entend, d’y insuffler de la beauté et de la saveur malgré l’adversité, Gwendolyn Brooks donne à voir sa puissance poétique et son refus farouche de se laisser entraver par les démons de l’Amérique. Éd. Globe, 192 p., 21 €. Élisabeth Miso
Biographies
Claude Arnaud, Picasso tout contre Cocteau. « La création n’obéit pas à des critères moraux. Elle est le fait de personnalités souffrant d’un trop-plein de vie minée par une certaine difficulté d’être. Elle implique des assassins en puissance – il faut savoir « tuer » pour devenir immortel – et des victimes fascinées. » Voilà la fine lecture avancée par Claude Arnaud des liens qui unirent Pablo Picasso et Jean Cocteau. Le romancier, essayiste et biographe de Cocteau, retrace avec érudition un demi-siècle d’une amitié tumultueuse. Subjugué par Le Sacre du printemps des Ballets russes en 1913, le jeune poète désire ardemment se rapprocher des représentants de cette nouvelle ère artistique que sont Apollinaire, Cendrars, Max Jacob, Braque et surtout Picasso. Dès leur première rencontre en 1915, il succombe au magnétisme du peintre espagnol, « (…) l’un des rares créateurs à posséder d’instinct cette sauvagerie que la modernité requiert (…) » et se propose de célébrer son génie. « Pour bien travailler, Picasso a besoin d’un atelier qui l’isole du monde, d’une femme qui conforte son être et d’un écrivain apte à vanter ses exploits. » Le touche-à-tout virtuose, n’aura de cesse de s’attirer la reconnaissance du visionnaire à l’écrasante personnalité et à l’impressionnante production. Il concrétise avec Erik Satie et Picasso son projet du ballet Parade. Leur relation prend la forme au fil des ans, d’échanges fructueux, de pillages respectifs, de moments de grande complicité, d’agacement ou de longs silences et jette régulièrement l’auteur d’Orphée dans des affres de douleur. La cruauté de Picasso n’est un secret pour personne, il se sert des autres, se lasse, ne vit que pour son art. Maintes fois, il se désintéresse de son cher poète, lui préfère la compagnie des surréalistes toujours prompts à le dénigrer, le tient à distance de son irrésistible ascension dans les années 1930, pour finalement renouer au moment de la Guerre d’Espagne. Le masochisme de Cocteau et son obsession de percer le mystère créatif du Malaguène, le pousseront toujours à reconquérir ses faveurs. Leur amitié singulière, résiste ainsi au temps et illustre admirablement l’effervescence artistique de la première moitié du XXème siècle. Éd. Grasset, 240 p., 20,90 €. Élisabeth Miso
Jean-Michel Thénard, L’amour était presque parfait. Ingrid Bergman et Robert Capa, les amants magnifiques. « Amoureuse, je ne l’ai été que de Capa » : Ingrid Bergman (1915-1982) attendit la fin de sa vie pour révéler dans une autobiographie son histoire d’amour avec Robert Capa. En juin 1945, l’actrice suédoise, arrive à Paris avec son Oscar de la meilleure actrice pour Hantise de George Cukor, elle séjourne au Ritz. Le garçon d’étage a glissé une lettre sous sa porte. Une invitation à dîner, signée Robert Capa. La star de Hollywood va tomber sous le charme du « plus grand photographe de guerre du monde », Robert Capa, hongrois de naissance, pseudonyme d'Endre Ernő Friedmann (1913-1954), dont l’œil photographiera des artistes, des écrivains, des hommes politiques, mais fixera surtout l’horreur des guerres qui traversent le siècle. Ils vivront deux années de passion. Ingrid Bergman est mariée à un médecin, Petter Lindstrom, ils ont une petite fille, Pia, mais avec lui elle est malheureuse, maltraitée, piégée dans sa soumission. Là où il peut, Capa, le séducteur, la retrouve, au gré de ses tournages ; Berlin où il la photographie dans une baignoire en morceaux dans une rue au milieu des gravats ; Paris à nouveau où elle savoure, avec lui, la ville et sa liberté ; Los Angeles, Hollywood où il acceptera de ne venir que pour elle et même, d’y travailler. Il est léger, profond, drôle, refuse de l’épouser choisissant d'être libre, pour pouvoir partir à tout moment sur les champs de bataille, mais la libère de l’image lisse qu’elle s’était forgée et offrait au monde. « Capa me faisait rire en permanence », il l’appelle Mon archangélique petite Suédoise, et leur rencontre sera déterminante pour la comédienne. Ils se séparent, après s’être retrouvés fin mars 1947, à New-York, amants magnifiques de la Libération – il ne veut pas devenir M. Bergman, elle l’accepte, mais elle a conquis son indépendance grâce à lui. En 1954, Capa mourra en reportage sautant sur une mine, en Indochine. Éd Seuil, 250 p., 19,50 €. Corinne Amar
Pierre Assouline, Le nageur. C’est le parcours et le destin extraordinaire d’un champion hors du commun, celui qu’on appela malgré lui, « le nageur d’Auschwitz » : Alfred Nakache (1915-1983). Enfant, il aura mis du temps à se jeter à l’eau. À Constantine, la ville algérienne de ses origines juives, l’eau est partout, et la famille – onze enfants et leurs parents – s’adonne volontiers aux joies aquatiques. « J’avais une frousse épouvantable de l’eau », avouera-t-il, jusqu’à ce qu’un événement survenu chez les scouts vers l’âge de treize ans le guérisse de sa phobie et révèle une passion sinon un don, pour la nage et le défi. L’enfant de Constantine rejoindra Paris et le Racing Club de France dès 1933, et devient le champion, celui qui va rafler cinq titres lors des championnats de France cette année-là. Dénoncé durant la guerre, il est arrêté, déporté à Auschwitz. Au camp, il y a une piscine, réservée aux SS, emplie d’une eau de pluie « sale, chargée, stagnante ». Avec sadisme, les gardes y jettent des objets pour l’obliger à aller les récupérer au fond de l’eau. Là encore, il décide de surmonter, de gagner, sympathise avec un jeune déporté sportif : ils bravent l’interdit. « Nous avons enlevé nos pyjamas et fait des longueurs dans le bassin à incendie, racontera Klieger. Quand un SS ou un Capo s’approchait, les copains nous avertissaient, on sortait très vite de l’eau et on enfilait nos pyjamas. » Même à Auschwitz, les Juifs sont encore des hommes. Sa femme et sa petite fille seront gazées. Il survivra aux « marches de la mort » pesant moins de 40 kilos à son arrivée à Paris, dans un hôpital parisien. « Laissez-moi reprendre contact avec le monde vivant, après quoi j’essaierai de renager », souffle-t-il aux reporters accourus à son chevet. Il renaît, bat le record du monde du 3 × 100 mètres 3 nages le 8 août 1946, participe même aux JO de Londres deux ans plus tard. Il intègrera à nouveau l’équipe de France, et puis arrêtera. Il éloignera de lui la guerre, se remariera, s’installera dans une maison de pêcheur sur les hauteurs de Sète, nagera jusqu’à la fin. Éd. Gallimard, 255 p., 20 €. Corinne Amar.