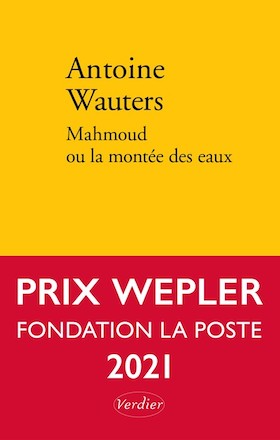Antoine Wauters est né le 15 janvier 1981 dans le petit village de Fraiture (commune de Sprimont, Belgique). Écrivain, poète et scénariste, il est diplômé en philosophie (Université Libre de Bruxelles) et a travaillé quelques années comme professeur de français et de philosophie. Antoine Wauters a publié plusieurs livres dont quatre aux éditions Verdier. Il a reçu le prix Wepler Fondation La Poste 2021 pour Mahmoud ou la montée des eaux.
Le 8 novembre dernier, le jury du prix Wepler-Fondation La Poste a récompensé Mahmoud ou la montée des eaux, paru chez Verdier. Qu’avez-vous ressenti en recevant cette distinction littéraire ?
Antoine Wauters De la joie, même si, j’avoue, je me sens souvent mal à l’aise dans ces moments. Il est difficile d’être ainsi exposé quand on vit la plupart du temps à l’écart, ce qui est mon cas puisque je vis depuis deux ans dans les bois, loin des villes, dans un petit village de Belgique. Mais oui, le soir de la remise du Prix, j’ai ressenti une profonde joie à l’idée que les mots et le message de paix de Mahmoud aient été entendus. Dans un monde comme le nôtre, répondre à la brutalité par la douceur me semble de la plus haute importance.
Dans ce livre, Mahmoud, un vieux poète syrien, raconte son histoire et celle de son pays, depuis la rive et les profondeurs du lac el-Assad qui recouvre son village natal, englouti par la construction du barrage de Tabqa. Quelques mots sur ce barrage construit au début des années 1970, et sur les conséquences de cette construction ?
A. W. D’abord, vous dire que l’édification de « barrages-poids » est une sorte de « gimmick » chez beaucoup de dictateurs. Sous la dictature militaire brésilienne, sous Franco, sous Salazar, vous voyez ces projets titanesques apparaître. Réaffirmer la puissance de la nation en prenant le contrôle des fleuves, réactiver le vieux mythe de l’eau salvatrice balayant les inégalités, le scénario est souvent le même. Le barrage de Tabqa, pour Hafez el-Assad, c’est le symbole d’une Syrie moderne, une Syrie fertile qui offrira à chacun de meilleures conditions de vie. Or le barrage sera responsable de l’expulsion de plus de 11000 familles, le lac engloutira des tas de villages et le « Projet de l’Euphrate », ainsi que l’appelle Hafez, créera dans le paysage et l’histoire du pays une fracture irréversible. J’ai vu dans la création de ce barrage et de ce lac le symbole de toute l’histoire syrienne. Un pays noyé, sans passé, sans présent, sans avenir. Noyé par la mégalomanie du clan Assad.
Le narrateur, Mahmoud, parcourt ce lac immense sur une barque. Autour de lui : la guerre. Il rame, plonge, parle. Il évoque son enfance, ceux qu’il aime, son premier amour, Leila, ses enfants partis se battre, sa femme, Sarah, à qui il s’adresse… Cette immense étendue d’eau est symbole de disparition, de destruction. Elle est partout, même dans les mots. Vous écrivez page 100 : « l’eau des mots ». Paradoxalement, l’eau manque terriblement en Syrie…
A. W. Mahmoud est un homme nostalgique. Plonger, pour lui, c’est revoir ce qu’il a perdu, ce que le lac a englouti, sa passion pour Leila, les souvenirs de ses parents dans l’ancienne maison, les jours heureux. C’est l’eau de la mémoire, si vous voulez. Il plonge dans ses souvenirs. Mais les souvenirs ont une forme étrange, chez lui, celle de la ruine, du vestige et de la mélancolie. Mahmoud, au fond, ne fait jamais qu’effleurer son passé, puisque ce qui a été perdu l’est à jamais. Écrire aussi, pour lui, c’est plonger. Il descend dans la mémoire de son corps et celle de son esprit, dans celle de la Syrie. Il n’oublie rien. Son souhait, c’est de garder vivants quelques éclats de lumière. Mais le paradoxe est le suivant, vous avez raison : alors qu’en 2017 la presse internationale parle d’un possible déluge dans la région, en raison de l’endommagement du barrage et des combats entre Daesh et les forces démocratiques, aujourd’hui, la Syrie a soif, les gens n’ont rien et le niveau de l’Euphrate n’a jamais été aussi bas. Une nouvelle guerre de l’eau a commencé avec la Turquie. C’est ce côté prédateur de l’homme et des grandes nations dont j’ai voulu parler, en montrant à quel point notre monde est abîmé par ces soifs de domination et cette vieille idée, chère à Descartes, de se rendre « maîtres et possesseurs » de la nature.
Le récit est écrit en vers libres. Qu’est ce qui a motivé le choix d’une forme poétique ? Dans votre discours de réception vous avez dit que « la poésie est non seulement ce qui peut tenir tête à la barbarie, mais aussi ce qui permet de réintroduire du sens dans ce qui n’en a plus. »…
A. W. La poésie, c’est l’acte de relier les mots à leur sens et leur silence profonds. C’est ne faire dire aux mots ni plus ni moins que ce qu’ils disent. La poésie est une écoute patiente, attentive. On vit aujourd’hui dans un monde d’éléments de langage, de clichés, de formules et de discours préfabriqués. Vous avez des menteurs patentés qui se retrouvent, à la télé, à jouer les parangons de vertu. Vous avez des mots qui ne disent absolument rien, des mots orphelins, sans portée, des mots enfermés dans le vide d’une logique marchande, technologique et technocratique. Ce livre, c’était pour moi une façon de raconter l’histoire de la Syrie avec des mots re-connectés à notre humanité, des mots simples ne visant qu’une chose : rappeler que la souffrance n’a pas de frontières et que l’histoire de la Syrie est aussi la nôtre. En cela, la poésie est une pratique de l’empathie. La forme poétique s’est imposée parce que je ne voulais pas que les lecteurs lisent « Mahmoud », je voulais qu’ils plongent avec lui dans le lac, qu’ils soient essoufflés avec lui, émus avec lui, qu’ils ressentent le cahot de sa barque sur ce lac grand comme une mer, et éprouvent avec lui son amour et sa peine.
Dans Mahmoud ou la montée des eaux, on peut lire : « L’écriture comme une barque / Entre mémoire et oubli. » Est-ce que l’agencement des mots, des phrases scandées sur la page blanche, qui produit un rythme spécifique, balancé et fragmentaire à l’instar de la mémoire et de l’oubli, suggère à la fois le vide, le mouvement de l’eau et le silence ? Une sorte d’intimité du fond et de la forme ?
A. W. Oui. J’avais envie de créer un rythme hypnotique et qu’on se trouve d’emblée entre les mondes. Le réel de la guerre et des balles qui fusent, et le monde du souvenir et des jours heureux. Le monde de la sagesse et celui de la folie. Je voulais faire sentir le trouble et l’égarement de Mahmoud, qui est quelqu’un qui ne sait plus s’il doit vivre ou non, espérer ou non, se souvenir ou non, croire au retour de ses enfants partis se battre contre Bachar ou se faire à l’idée de leur mort. Il ne sait plus si ce qu’il voit est bien réel. Ces choses qui défilent à la surface de l’eau et que l’eau emporte, ce parasol Orangina, ce ballon de foot, cette tête d’enfant toute bleue… sont-elles réelles ou bien hallucinées ? Il ne sait plus. Mais malgré l’angoisse qui est la sienne, puisqu’il passe constamment d’un univers doux à un réel d’une totale cruauté, il s’efforce de ne pas craquer. C’est un résistant. Sa barque, sa poésie, son amour pour Sarah et pour ses enfants, il s’y accroche de toutes ses forces. C’est quelqu’un qui est sur le fil, Mahmoud. Constamment. Il peut mourir à tout instant, sombrer dans la folie, avoir à tout instant des envies de vengeance et de meurtre, mais il s’efforce pourtant de rester doux, de ne pas blesser les choses. D’être un homme délicat et surtout, sans haine. Voilà, c’est cela, Mahmoud est un homme qui se refuse à la haine.
Dans un entretien avec Alain Veinstein, le poète André du Bouchet disait que « c’est en cessant de vouloir parler aux autres avec le langage des autres que peut-être, alors, un autre sera touché. » Cette langue poétique, à travers laquelle votre personnage s’exprime, est-elle aussi une manière de toucher davantage, de rendre sensible le rapport à la douleur et au monde ?
A. W. Je ne connaissais pas cette phrase de du Bouchet, mais je l’aime bien. Je crois en effet que c’est en parlant avec nos tripes et notre ressenti le plus personnel, que, paradoxalement peut-être, on atteint le cœur des gens. Les grands discours pleins de mots universels, je n’y crois pas. Je préfère les paroles déviantes, remplies de failles. Car ce sont des paroles qui, quand elles vous touchent, vous touchent au seul endroit où il importe de l’être.
Vous êtes-vous beaucoup documenté avant de vous lancer dans l’écriture de ce texte, et quel en a été le point de départ ? Les films du réalisateur Omar Amiralay (1944-2011), décédé juste avant les « Printemps arabes » ?
A. W. J’ai d’abord lu tout ce que je pouvais lire sur l’histoire de la Syrie. Je l’ai fait pour moi, parce que je n’aimais pas être ignorant à ce point. De fil en aiguille, je me suis intéressé au clan Assad et j’ai été étonné de voir comment Bachar est arrivé au pouvoir, lui qui se destinait à devenir ophtalmologue et étudiait à Londres, dans une relative quiétude. J’ai trouvé ça d’une ironie totale. Un type qui ne veut pas être dans la politique, qui veut s’émanciper et qui, parce que son frère aîné décède dans un accident de voiture en 1994, va subitement devenir le monstre que l’on connaît. D’où cette phrase, qui revient dans tout le livre : « les monstres naissent dans la nuit ». Mais ce qui m’a donné envie d’écrire cette histoire, c’est effectivement la création de ce barrage et de ce lac. J’y ai vu quelque chose d’énorme, d’inouï. Le mensonge pharaonique d’un despote qui, tout en promettant à son peuple bonheur et prospérité, ne se rend pas compte de la symbolique funeste de l’ennoiement de tous ces villages. Le livre est dédié à Omar Amiralay, qui m’a inspiré le personnage de Mahmoud. Dans son documentaire Déluge au pays du Baas, il y a cette figure d’un vieil homme, sur sa barque, qui parle de sa vie et de son village englouti. Ça m’a ému aux larmes. Ce livre, c’est la poursuite du monologue de ce vieux sur sa barque, mais couplée à toutes mes lectures et à des obsessions personnelles : le temps qui passe, l’enfance, le manque, la recherche de la lumière…
Vous citez, au cours du récit, des extraits de poèmes et notamment, en exergue, le poète iranien Sohrab Sepehri (1928-1980). Il y a aussi les poètes syriens, le poète israélien Amos Oz, le russe Maïakovski… En quoi ces poètes vous ont nourri ? Et en quoi la poésie syrienne contemporaine vous a-t-elle inspiré ? Quelle est sa spécificité ?
A. W. Je dirais que la poésie syrienne, mais c’est vrai également pour la poésie de Sohrab Sepehri, est une poésie qui, en peu de mots, produit un maximum d’effets. Ce sont des poésies qui ont des yeux et des sens particulièrement affutés. Les poètes, là-bas, voient des choses que nous peinons à voir. Le reflet de la lune sur un plat de concombres, qui s’en émeut ici ? C’est vraiment ce que j’aime dans ces textes-là, l’extrême attention, qui est en fait un extrême amour, des choses muettes et ordinaires. J’y vois une leçon de philosophie de la plus haute importante, précisément parce qu’elle ne se présente ni comme une leçon, ni comme de la philosophie. Je suis aussi très sensible à la dimension politique des écrits de poètes syriens contemporains. Ils permettent de regarder les choses autrement. Si je tenais à ce qu’ils figurent dans le texte, en italique, c’est parce que j’ai écrit le livre avec eux. On écrit toujours à plusieurs, même si on aime soutenir l’inverse. Il y a des fantômes en nous qui écrivons. Les prix littéraires leur reviennent. Nous, finalement, nous ne sommes que de pauvres passeurs.
Bibliographie
Aux éditions Verdier
Mahmoud ou la montée des eaux, 2021
Pense aux pierres sous tes pas, 2018
Moi, Marthe et les autres, 2018
Nos mères, 2014
Chez d’autres éditeurs
L’Enfant des ravines, éditions maelstrÖm, 2019
Sylvia, Cheyne éditeur, 2014
Césarine de nuit, récit, Cheyne éditeur, 2012
Ali si on veut, récit coécrit avec Ben Arès, Cheyne éditeur, 2012
Prix
Prix Wepler – Fondation La Poste, 2021 (Mahmoud ou la montée des eaux)
Prix Marguerite-Duras, 2021 (Mahmoud ou la montée des eaux)
Prix de la Librairie Nouvelle d’Orléans, 2021 (Mahmoud ou la montée des eaux)
Prix des lecteurs de la Librairie Nouvelle à Voiron, 2021 (Mahmoud ou la montée des eaux)
Prix littéraire du Deuxième Roman attribué par l’association Lecture en tête, 2018 (Pense aux pierres sous tes pas)
Prix Première de la RTBF, 2014 (Nos mères)
Prix Révélation de la SGDL, 2014 (Nos mères)