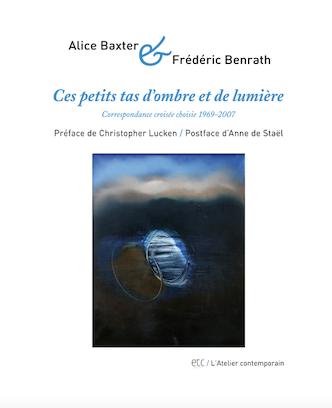Alice Baxter, pseudonyme de Michèle Le Roux doublement emprunté au récit Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll et au film Véra Baxter de Marguerite Duras, est une écrivaine, critique d’art et « presque-peintre » dit-elle, née en 1947 à Équeurdreville. Elle a enseigné les lettres et l’histoire-géographie au collège, avant de devenir professeure d’arts plastiques en 1976. Elle a notamment édité les Écrits et lettres de Frédéric Benrath (L’Atelier du Grand Tétras, 2014), et écrit de nombreux textes sur les œuvres de Tal Coat, Jean-Jacques Saignes, Claude Monet, Édouard Manet, Zoran Music, Jean Dubuffet, Gérard Gwezenneg ou Frédéric Faye.
La correspondance que vous avez entretenue avec le peintre Frédéric Benrath entre 1969 et 2007, paraît aux éditions L’Atelier contemporain. Il s’agit d’un volume de près de six cents lettres et cartes postales dans lesquelles « tout n’a pas été retenu », écrit Christopher Lucken dans sa préface. Et Anne de Staël de mentionner dans sa postface, que vous aviez fait, dans un premier temps, de nombreuses coupes « pour resserrer les propos autour de la création, surtout par discrétion ». En supprimant « ce qui était plus personnel et portait le souffle de leur idéal, la création paraissait désincarnée », a-t-elle aussi remarqué. Comment avez-vous procédé pour composer cet ensemble qui porte principalement sur la création artistique, littéraire et picturale, et dans lequel s’expriment non pas la vie quotidienne mais, presque au quotidien, les émotions, les réflexions, les obsessions, les doutes et les enthousiasmes, les perceptions respectives ; la vie, en somme ?
Alice Baxter Quand j’ai été amenée à relire toute la correspondance que nous avons échangée, Benrath et moi, sur près de quarante ans, en vue de cette publication, qui m’a été demandée par un éditeur, je me suis rendu compte qu’il était impossible de tout publier. Pour plusieurs raisons. D’une part, la trop grande quantité de lettres (qui aurait nécessité plusieurs volumes). D’autre par le contenu parfois trop personnel de certaines lettres, soit nous concernant Benrath et moi, soit par respect pour les personnes évoquées. Il était impératif de faire une sélection, en choisissant un axe, un thème, un éclairage précis, qui s’est imposé d’emblée : notre réflexion autour de la création, qui en constituait le centre. Benrath aimait beaucoup écrire, il se destinait au départ à une double carrière de peintre et de poète, même si la peinture a pris très rapidement le dessus. En m’écrivant, il put aussi affronter cette autre forme d’expression littéraire. Ce fut pour lui, en quelque sorte, comme un atelier parallèle à celui destiné à la peinture. Comme ce fut le cas aussi pour moi, mais exclusivement sur le plan littéraire.
Comme je le dis dans l’introduction à ce livre, j’ai choisi de « mettre en lumière le thème central et récurrent de cette correspondance, à savoir notre double regard sur la création artistique, littéraire et picturale. Mais, pour ce faire, comment dissocier l’indissociable ? Comment séparer le dialogue intellectuel de son socle amoureux ? Comment détisser la chaîne sur laquelle s’est tramée l’étoffe de notre histoire ? Comment « désincarner » en quelque sorte cette émulsion complexe où l’art et la vie, le corps et l’esprit, étaient si intimement dépendants l’un de l’autre ? Tâche impossible, dont Anne de Staël sut me dissuader. En me faisant comprendre l’impérieuse nécessité de garder intacte l’implication personnelle nécessaire à la compréhension de l’œuvre de Benrath.
Dès sa première lettre, voici comment il évoquait notre rencontre : « notre rencontre me semble très liée à la peinture, pour ne pas dire à son espace émotionnel ». (8 septembre 1969). Et à propos de son œuvre : « je pense que l’homme et la femme y sont potentiellement présents, non pas figurés. » (30 janvier 1972)
Au départ, je n’avais pas l’intention d’évoquer cette implication personnelle. Mais Anne m’a fait comprendre que, sans cette dimension, cette première sélection de lettres était trop sèche, en quelque sorte vidée de sa substance qui, pour Benrath, était indissociablement liée à la peinture. Cela ressemblait plus à un dialogue entre un professeur et son élève, ce qui dénaturait la compréhension de l’œuvre. « Il faut réhydrater l’ensemble », m’a-t-elle dit. Ce que j’avais « désincarné », il me fallait donc le « réincarner ». Ce travail d’écriture se faisait parallèlement à la vie quotidienne, dont on se parlait aussi beaucoup, mais j’ai choisi de ne pas mettre cet aspect plus anecdotique et superficiel en évidence.
« J’ai trop besoin de quelqu’un à qui je puisse m’adresser », écrit Frédéric Benrath le 29 septembre 1971... Et en décembre 1977, il vous dédicaçait un livre de H.F. Peters sur Lou Andréas Salomé, Ma Sœur, mon Épouse, en ces termes : « Pour toi, ni sœur, ni épouse, mieux, confidente, à l’écoute première de la « vraie vie » parole et regard mêlés pour l’essentiel »... Les échanges épistolaires, la correspondance, occupaient une place privilégiée pour Frédéric Benrath, tant dans le caractère même de son œuvre picturale (par exemple, les cartes postales détournées adressées au philosophe Jean-Noël Vuarnet) que dans son rapport à l’écriture de ses pensées, de ses idées... Il en était de même pour vous qui écrivez en préambule aux lettres : « Dans ce puits nourricier, nos réflexions respectives s’abreuvaient l’une à l’autre, en perpétuelle et fertile interaction »...
A.B. Il suffisait parfois d’un seul mot, de sa part, ou de la mienne, pour faire naître la réflexion et le questionnement... Ses interlocuteurs épistolaires les plus proches, comme Jean-Noël Vuarnet et moi-même à cette époque, lui permettaient d’attiser sa pensée, comme on attise les braises d’un feu sous la cendre. À notre sujet, le 12 juillet 1975, il m’écrivait « j’ai besoin d’avoir près de moi des êtres intellectuellement solides comme toi, comme lui. Il me faut des questions, des sourciers, et peut-être des sorciers, car je crois que l’art c’est un peu tout cela, la peinture et l’écriture se rejoignent en ce sens qu’elles posent l’univers comme énigme... » Pour reprendre l’image du souffle animant le feu, il aimait citer Artaud écrivant à la femme aimée Génica Athanasiou : « on a fiévreusement besoin de cette sorte de confident fait du même tissu que vous-même, des mêmes crépitements ».
Dans notre côtoiement épistolaire, il se retrouvait dans « ces traces qui se reconnaissent dans d’autres traces » (lettre du 14 avril 1976). Je lui servais un peu de miroir, comme si j’étais un peu le double de son regard, en vision décalée, un peu prémonitoire. Oui, comme si nous étions un double regard et que ces regards fusionnaient en un seul... Ainsi, sans en avoir conscience, je décuplais sa possibilité de voir et d’analyser. C’est ainsi que je peux comprendre sa dédicace du 18 janvier 1978 : « à Michèle, pour son regard toujours comme un faisceau de voyance ». « Avec toi le vécu s’imbrique tellement dans mon travail, notre respiration est tellement au même rythme sur la peinture, le cinéma ou la lecture. Tellement que j’ai du mal à penser que nous sommes deux. » (29 juillet et 3 août 1976)
Ainsi s’opérait une sorte de reconnaissance mutuelle. Notre relation, lui à la peinture, moi à l’écriture, se nourrissaient mutuellement : « Ton texte [Le Vertige oblique de l’espace] m’a accompagné et je l’apprécie toujours de plus en plus. Il faut continuer pour que je puisse, moi, continuer à peindre », m’écrivait-il le 28 février 1978. « Même si parfois le malheur m’habite et me submerge, jamais il n’empêchera notre dialogue de produire de l’écriture chez toi, de la peinture chez moi. » (14 avril 1976)
Quelques mots sur votre rencontre avec Frédéric Benrath, sur ce tableau Violet d’Égypte (qui a changé le cours de [vos] vies) et sur la publication, aujourd’hui, de ces « conversations épistolaires » longtemps tenues secrètes ?
A.B. Lorsque j’ai rencontré Frédéric Benrath, j’avais 22 ans et étais célibataire, lui 39 ans, et marié. Je ne connaissais même pas l’existence de son nom en tant que peintre. J’ai été invitée à dîner chez Benrath par un ami que nous avions en commun, Gérard Gwezenneg, qui venait lui-même de découvrir depuis peu l’œuvre de Benrath. J’étais passionnée depuis mon enfance par la peinture et rêvais d’être peintre un jour. Mais, en tant que fille d’ouvrier, la principale préoccupation de ce moment pour mes parents était de me voir faire mes études à L’École Normale d’Institutrices de Caen, ainsi nommée à l’époque, en vue d’une carrière dans l’enseignement. La peinture ne pouvait donc être envisagée à l’avenir pour moi que comme un passe-temps. Mais à 19 ans, j’avais déjà découvert la peinture de Zao Wou Ki, et son univers pour moi fascinant, à la Maison du Théâtre et de la culture de Caen.
En entrant dans la maison de campagne de Benrath pas loin de chez moi en Normandie à Saint Germain des Vaux, que vois-je ? Le seul et unique tableau de lui dans la pièce, un superbe « Violet d’Egypte », dont la vision m’a complètement bouleversée, car représentant exactement l’univers que je portais en moi. Ce qui se passe dans l’absence de mots s’est alors concrétisé. Au début, je vivais à Caen, lui à Paris. D’où cette correspondance par écrit postal, en plus du téléphone. L’ordinateur et les technologies actuelles de communication rapide n’existaient pas à l’époque. Mais, même lorsque je suis venue vivre à Paris, peu loin de chez lui, nous avons continué à éprouver la nécessité de nous écrire, parfois presque quotidiennement pendant des années, afin d’échanger presque en continu nos impressions, nos pensées, nos questionnements, qui nourrissaient bien sûr nos rencontres en direct... Peu à peu, les réflexions portant sur la peinture se sont intensifiées, jusqu’à ce que Benrath m’encourage à écrire sur la peinture de façon officielle, et me fasse sortir progressivement de l’anonymat, en me présentant à des personnes susceptibles de me publier et de m’aider dans ce sens.
Il est souvent question, dans la correspondance, des angoisses du peintre et d’une « mélancolie tenace » à laquelle il est en proie. L’écriture épistolaire semble l’accompagner, le soutenir, « pour ne pas [se] noyer dans la peinture »...
A.B. Oui, Benrath était sujet à des crises d’angoisse existentielle qui pouvaient le terrasser pendant des jours et parfois des semaines. Souvent accompagnées de maux de tête. Relisant cette correspondance en vue de sa publication, j’ai pris après coup conscience de l’ampleur et de la profondeur terribles de ce mal-être, que j’avais tellement l’habitude de vivre, presque au quotidien, que je l’assumais du mieux possible, essayant de soutenir Benrath du mieux que je pouvais, en lui maintenant la tête hors de l’eau. De plus il était fasciné par la mort... « J’ai un bonheur de mort en moi », m’écrit-il le 15 février 1974 dans ce sublime oxymore qui pourrait qualifier à la fois l’œuvre et la vie de Benrath. Il avait même programmé de se suicider à l’âge de trente ans, comme il l’avait écrit dans une petite plaquette poétique, La Vie au hasard, publiée en 1955... Son intérêt pour le romantisme allemand n’est pas étranger à cette attirance dont il se nourrissait dans son propre théâtre intérieur. Avec le temps, j’avais appris à prendre du recul avec cela, non seulement pour l’aider à ne pas sombrer, en étant moi-même assez forte, mais aussi pour me protéger.
Il avait suffisamment de lucidité aussi pour se rendre compte de ses ambivalences et de ses propres contradictions... « Je suis de ceux qui appellent au secours et qui refusent d’être secourus » (13 août 1977)...
Dans mon premier livre consacré aux écrits de Benrath en 2014, j’ai assez longuement analysé cela en lui donnant la parole. J’ai donc choisi dans cette correspondance présente, de ne pas alourdir l’ensemble par cet aspect très personnel ne concernant pas directement l’éclairage choisi, c’est-à-dire le questionnement autour de la création, même si cette angoisse en fait aussi partie intégrante. « Je n’ai aucun moral, la peinture est un acte désespéré », m’écrit-il le 20 juillet 1978. « Vois-tu, je suis condamné, il me faut donc vivre mon malheur jusqu’au maximum de mes forces. Je te l’écris pour que tu sois la première à le savoir et peut-être un jour, si le cœur t’en dit, à témoigner. (1er septembre 1975) » Notre correspondance l’aidait probablement à surmonter ses angoisses : « Je crois que ma correspondance, mais celle que j’ai avec toi surtout, m’aide non seulement à exorciser mes démons, mais à les utiliser, à renverser de ce fait leur nocivité, à les rendre créatifs, si je puis dire. » (29 juillet 1975)
Mais aussi la présence de son fils qu’il a toujours cherché à protéger. « Depuis plusieurs années je rassemble mes forces pour régler certains problèmes, celui, majeur, étant l’avenir d’Emmanuel. N’ayant pas de fortune personnelle, j’ai dû chaque jour lutter pour que se construise cette petite chose qui est un enfant et aujourd’hui presque un homme. » (14 août 1979).
L’écriture épistolaire n’est-elle pas aussi un témoignage essentiel de l’évolution de son œuvre et de votre travail de réflexion sur l’art, la critique ?
A.B. L’écriture épistolaire est forcément un témoignage essentiel dans notre réflexion, aussi bien chez lui que chez moi, sur la peinture en général, la sienne en particulier. En ce qui concerne Benrath, je ne peux pas dire si cela a eu une influence sur l’évolution de son œuvre. Sur l’évolution de sa réflexion, oui, indéniablement. Ce n’est pas la même chose. Frédéric lui-même disait qu’il peignait « en aveugle », c’est-à-dire que sa propre réflexion sur sa peinture venait toujours après coup, jamais avant, toujours en amont, jamais en aval. Il semblait toujours découvrir sa peinture une fois terminée, toujours étonné de ce dont elle était porteuse. Que notre écriture épistolaire lui permît de mieux voir sa peinture, oui, c’est certain. Mais dire qu’elle l’a influencée, je ne peux pas l’affirmer. Si c’est le cas, c’était probablement de l’ordre de l’inconscient. Pour autant, notre réflexion croisée prit progressivement une dimension créatrice interactive entre nos deux modes d’expression, comme il l’évoque dans cette lettre : « Je souhaite que ma peinture soit à ton écriture ce que cette dernière est à ma peinture, c’est-à-dire quelque chose d’assez rare et d’exceptionnel, comme l’est, tout jugement de valeur exclu, l’écriture de Becket pour la peinture de Bram Van Velde, et inversement. » (8 juillet 1978)
En ce qui me concerne, écrire de telles lettres me demandait parfois des journées entières. Cela exigeait de moi un effort considérable de réflexion, de mise en forme, d’autant plus que j’avais face à moi quelqu’un qui avait déjà une culture et une connaissance artistique et littéraire très solide. J’écrivais chaque lettre comme un texte littéraire, même concernant le vécu quotidien. C’était pour moi un véritable engagement dans un travail d’écriture. « T’écrire, c’est aussi écrire », lui ai-je confié le 29 décembre 1980. Au bout de quelques années de cet échange, Frédéric m’a d’ailleurs encouragée à m’engager officiellement dans cette voie, parallèlement à ma profession d’enseignante, en me présentant à certaines personnes, comme Jean-Jacques Lévêque, responsable de la rubrique arts plastiques à la revue Les Nouvelles Littéraires, en me faisant rencontrer son amie Geneviève Bonnefoi, critique d’art très connue et reconnue dans le milieu artistique, qui elle-même m’a présentée à Maurice Nadeau, de la revue La Quinzaine Littéraire.
À la lecture de cette phrase qui figure dans une lettre du 17 août 1980 : « Moi qui ne peins pas, mon corps est enraciné dans la peinture, imbibé de ces tableaux que j’ai vus et qui sont à jamais entrés en moi », j’ai immédiatement pensé à l’écrivain Marcel Moreau qui, après avoir vu les dessins et sculptures, ou peintures sculptées de Jean Dubuffet – dont la plupart ont pour sujet des arbres qui appartiennent au cycle de L’Hourloupe –, lui écrivait en novembre 1971 : « Vos forêts sont entrées en moi par les racines »…
A.B. Frédéric Benrath lui-même disait que j’étais complètement « imbibée » par sa peinture. Évidence d’une reconnaissance d’un univers que l’on porte en soi, et que l’on retrouve chez l’autre. Même phénomène que l’on peut avoir dans la lecture d’un roman, de la poésie, ou la vision d’un film. Les grands créateurs ont parfois accès à une forme d’inconscient collectif, dans lequel chacun peut se retrouver. C’est la force des grandes œuvres. Quand j’ai vu pour la première fois ce fameux « Violet d’Égypte », je me suis immédiatement identifiée à cet univers, comme si je le portais en moi depuis toujours. Benrath lui-même engageait le spectateur de sa peinture à entrer en quelque sorte dans le tableau comme dans un espace à parcourir, dans lequel il puisse se fondre.
Le Romantisme allemand est évoqué fréquemment dans vos échanges, et notamment les peintures de Caspar David Friedrich auxquelles vous êtes tous les deux sensibles. Quand on regarde le tableau Moine au bord de la mer (1808), on comprend l’attirance de Benrath pour Friedrich qui a peint un dénuement radical, une brume opaque proche de l’abstraction, où le ciel d’une dimension abyssale et la mer sombre se confondent, où la couleur devient sursaut de lumière. La peinture de Benrath, n’a-t-elle pas quelque parenté, accointance avec l’immensité mystérieuse des espaces de Friedrich ?
A.B. Oui, ce tableau en particulier, Le Moine au bord de la mer, est un de ceux qui ont bouleversé Frédéric Benrath. Et ce de façon très durable. Il l’avait vu lors de ses premiers voyages à Berlin. Non seulement pour l’espace et la lumière que vous décrivez fort bien, que dans les rapprochements que l’on peut faire avec l’espace et la lumière des tableaux de Benrath. Mais aussi pour la présence minimale de ce petit personnage, le moine, tourné vers l’infini océanique. Dans certains de ses tableaux, Friedrich a ainsi placé des personnages vus de dos, tournés non vers le spectateur, mais vers l’espace peint, en faisant ainsi en quelque sorte entrer le regard du spectateur dans le tableau. Ce que revendiquait Benrath dans la contemplation. Dans un entretien avec Jean-Noël Vuarnet, Une sorte d’euphorie, qui suspend l’image en 1977, pour une exposition à la galerie Gervis à Paris, Benrath écrit textuellement « je voudrais mettre le regard dans le tableau. Friedrich y plaçait le regardant, son double, cela m’a bouleversé » dans le même entretien, il ajoute « Je voudrais, oui, qu’on puisse y plonger, et même y respirer (...), qu’on s’y perde, non pas qu’on y voie, mais qu’on y soit ». En dernier lieu, Benrath a fait souvent référence à un texte de Kleist écrit en 1810 sur ce tableau précis, où il emploie l’expression « désert d’eau ». Expression que reprendra Benrath plus tard comme titre pour toute une série de tableaux.
Pouvez-vous nous parler des différents supports et mediums qu’utilisaient Frédéric Benrath et de leur impact sur la composition d’une œuvre ?
A.B. Je ne suis pas dans le secret des choix techniques expérimentés par Frédéric Benrath, dont il parlait assez peu. Il peignait sur différents supports, sur toile (essentiellement peinture à l’huile), soit sur papier ou carton avec différentes techniques et différents mediums : gouache, acrylique, aquarelle, ou mélanges de techniques dont lui seul avait le secret, jouant parfois avec des émulsions a priori incompatibles, mais dont il tirait des effets de matières surprenants. Il semble qu’il n’ait jamais utilisé les pastels secs, et peu les pastels gras, mais je ne peux en dire plus. Le travail sur papier se faisait aussi parfois en collages, utilisant les « déchets » de ses œuvres détruites, ajoutés ou non à des images imprimées, comme c’est le cas pour les cartes postales détournées à partir de photos ou de reproductions de tableaux d’autres artistes. La seule chose dont il parlait sur le plan technique était la difficulté qu’il rencontrait avec l’acrylique à cause de son absence d’odeur. Ce qui, pour lui, lui ôtait toute sensualité, dont il avait tant besoin pour peindre. Il a retrouvé le plaisir de peindre à l’acrylique quand il a utilisé l’essence de térébenthine, dont l’odeur si particulière provoquait chez lui un certain désir sensuel qu’il recherchait pour peindre.
L’impact que ces choix techniques pouvaient avoir sur la composition des œuvres ? Je ne sais, et je pense que lui-même aurait du mal à le dire... Car, comme je l’ai précisé plus haut, il disait lui-même « Je peins en aveugle » (entretien avec Jean-Noël Vuarnet, Le peintre à la question, catalogue de l’exposition au musée de Cherbourg en 1974). Il semblerait toutefois qu’à une certaine période, il a vu apparaître à sa grande stupéfaction, des formes primaires plus ou moins géométriques essentiellement dans ses œuvres sur papier, a priori jamais dans ses huiles sur toile. Ainsi dans la série des « Deltas lumineux ». Voici une des rares fois où Benrath parle de cette apparition de formes élémentaires aléatoirement géométriques dans leur lien avec les différentes techniques, sur papier et sur toile : « je peins tous les jours et plus longuement que jamais, toujours sur papier. Ça bouge et à mon grand étonnement des formes primaires sont apparues, cercle, triangle, carré. Rassure-toi, formes à ma façon et dans ma nature, ce fut une hécatombe, mais j’en ai une dizaine dont j’ose penser qu’elles te plairaient. Peut-être sont-elles un peu dures et sauvages mais symboliques ces triangles, cercles ou carrés. La série des Triangles porte le nom de « Delta Lumineux »... Tout un programme. » (Lettre à mon adresse du 20 juillet 1981)
Certaines graphies incertaines, de façon tremblée et vivante, dans une apparente maladresse traçante, sont apparues autour des années 1990, ceci essentiellement dans les œuvres sur papier, originales ou en estampes. Très peu présentes, voire inexistantes dans les huiles sur toile. Là aussi je pense qu’il y a une incidence entre le choix technique et la composition des œuvres, mais je ne pourrais pas l’analyser moi-même.
De nombreuses citations de poètes, écrivains, philosophes et critiques d’art « arrosent » la correspondance. La poésie, notamment, accompagne Frédéric Benrath dans son travail. Au poète et peintre Henri Michaux qu’il rencontre en 1954, il emprunte un titre pour une exposition...
A.B. Il m’a dit lui-même un jour qu’il pourrait écrire toutes ses lettres avec des citations. La plupart des titres de tableaux de Benrath sont extraits de ses lectures, romans, poésie ou philosophie. La lecture était pour lui une véritable expérience existentielle, très profonde, provoquant parfois chez lui des remises en question fondamentales qui le bouleversaient. Il s’en est expliqué à plusieurs reprises, dans des entretiens ou des lettres, comme je l’analyse dans mon premier livre sur les écrits de Benrath. « Les titres de mes tableaux témoignent souvent de cette relation peinture-écriture. Peu d’entre eux me viennent uniquement de l’image produite, même si cela arrive, les titres parlent souvent de mes lectures, de ces mouvements privilégiés où la pensée trouve son accord avec le mouvement de la peinture. Mais l’un n’explique pas l’autre, mais l’un n’illustre pas l’autre, ils sont autonomes et pourtant solidaires. » (Extrait d’un dossier pour une étudiante, 1987). Ses interlocuteurs privilégiés en littérature se retrouvent donc dans ses titres de tableaux, sous forme d’hommage, de citations, ou de « portraits ». Ainsi, non seulement Henri Michaux, comme vous le signalez, mais aussi le plus grand des philosophes pour lui, Nietzsche, pour ne pas le nommer, dont il a réalisé un « portrait », évidemment très abstrait, à l’image de sa peinture en général... N’oublions pas le romantisme allemand, avec Jean-Paul Richter, Novalis, Caroline de Günderode, Hölderlin, le plus fréquemment cité. Mais aussi plus proche de nous, Paul Celan. Sans oublier Kafka, Dostoïevski, Artaud, Blanchot, et tant d’autres... comme son grand ami Jean-Noël Vuarnet, qui le guidait souvent dans ses choix de lectures.
.................................................
Sites Internet
Éditions L’Atelier contemporain
https://www.editionslateliercontemporain.net/
Site des amis de Frédéric Benrath
https://www.benrath.fr/
Textes d’Alice Baxter sur des œuvres d’artistes
http://alicebaxter.blogspot.com/