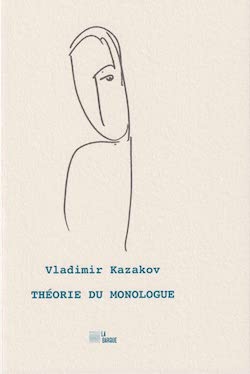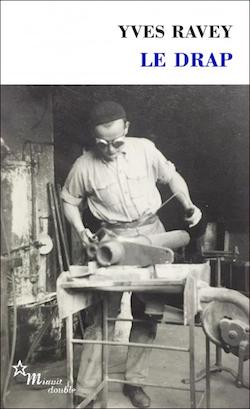ROMANS
Renato Cisneros, Tu quitteras la terre. Traduction de l’espagnol (Pérou) Serge Mestre. Dans La Distance qui nous sépare, Renato Cisneros sondait sa relation à son père, Luis Federico Cisneros Vizquerra, le redoutable ministre et militaire péruvien. Dans son nouveau livre, il remonte plus loin dans sa généalogie, déroulant, des premières décennies du XIXe siècle à nos jours, une histoire familiale des plus romanesques sur fond d’histoire nationale. Dès qu’il a découvert certains secrets du passé, il n’a eu de cesse de vouloir rompre avec cette tradition péruvienne du silence, de l’oubli. Plus jeune, l’écrivain ne s’intéressait pas vraiment à ses origines, à cette lignée prestigieuse des Cisneros que ses oncles et son père honoraient immanquablement lors des réunions familiales. « (…) je pressentais, qu’un jour, par inertie mais aussi par orgueil, il me faudrait couper drastiquement les ponts, qu’un jour, il me faudrait me détacher de tout ça et trahir le pacte de sang avec ma famille paternelle pour former ma propre dynastie et ne pas devenir un autre chainon tourmenté par ces germes anciens auxquels je serais par ailleurs toujours irrémédiablement uni. » Nicolasa Cisneros, sa trisaïeule, scella le destin des siens en s’éprenant du curé Gregorio Cartagena. Toute sa vie, elle cacha cet amour illégitime et inventa un père fictif, Roberto Benjamín, à ses sept enfants. Renato Cisneros révèle les ravages de ce mensonge, de cette réalité falsifiée, sur les générations suivantes. Comment le silence, la clandestinité, l’exil, les doubles vies dont est tissée la mémoire familiale, se sont reproduits au fil du temps et viennent impacter sa propre existence. Son roman, d’une grande puissance narrative, s’est nourri d’une longue enquête et remet en perspective la manière dont son héritage familial a façonné son identité, sa vision du monde, ses émotions et son travail d’écrivain. Il a pu retracer les trajectoires de son arrière-grand-père, Luis Benjamín Cisneros, poète et homme politique, monument littéraire national, et de son grand-père Fernán Cisneros, journaliste, poète et diplomate, poussé à l’exil par le dictateur Leguía. Son oncle Gustavo, taraudé lui aussi par le désir de se libérer du poids de ce silence, a été le seul à l’encourager, l’aidant à déterrer des archives, lui communiquant des lettres déterminantes. Les autres ont toujours éludé les questions sur le mystérieux Roberto Benjamín. « Ils ont refusé de comprendre et de dissiper les énormes nuages qui bâchaient leur monde. Ils n’ont pas cru que « si la douleur mène à la vérité, elle devient bienveillante ». » Éd. Christian Bourgois, 304 p., 23 €. Élisabeth Miso
Gabriella Zalapì, Willibald. Mara, sa sœur Ana et leur mère Antonia, ont quitté l’Italie en 1976 pour s’installer dans un quartier populaire de Genève. L’appartement modeste qu’elles occupent est encombré de mobilier et d’objets raffinés. De tous les tableaux qui peuplent le décor de son enfance, Le Sacrifice d’Abraham peint par Govaert Flinck, un disciple de Rembrandt, est celui qui fascine le plus Mara. En 1938, Willibald son arrière-grand-père maternel, un industriel et collectionneur juif, a fui Vienne n’emportant que cette toile, si précieuse à ses yeux, pliée dans sa valise. En 1989, Antonia décide de vendre aux enchères plusieurs objets de valeur, dont ce tableau. C’est un traumatisme pour Mara. « Il y a des images qui mettent en concurrence toutes celles qui viennent après et qui jamais n’atteignent la même densité. Il y a des images qui obstinément rythment une vie, qui se manifestent au gré des hasards pour nous rappeler un flux souterrain. Le Sacrifice d’Abraham est l’une de celles-ci. Sa complexité, sa beauté sont les références invisibles de Mara. » Des années plus tard, un musée viennois contacte Antonia pour lui restituer des verres syriens du XIVe siècle, ayant appartenu à Willibald. Mara retrouve sa mère dans sa maison toscane et exhume des documents intimes de son aïeul. À travers sa correspondance avec un ami et le journal de bord qu’il a tenu lors de sa traversée à bateau entre Lisbonne et Rio, elle reconstitue son périple de Vienne à Teresópolis au Brésil, et tente de percer le mystère de son attachement au Sacrifice. Elle questionne sa mère sur son passé, sur ses liens avec Willibald, colmatant leur propre relation faite « de courants d’air ». Comme pour son premier roman Antonia, où une femme, dans les années 1960, se plongeait dans les archives personnelles de sa grand-mère et brisait le cours ennuyeux de son existence bourgeoise à Palerme, Gabriella Zalapì s’est inspirée de son histoire familiale. L’artiste plasticienne, anglaise, italienne et suisse, procède par fragments, par motifs de textes et de photographies pour composer un récit délicat autour de la mémoire, de la filiation, de la transmission. Éd. Zoé, 160 p., 17 €. Élisabeth Miso
Eula Biss, Avoir et se faire avoir. Traduction de l’anglais (États-Unis) Justine Augier. Quand elle devient propriétaire d’une maison à Chicago, la poète et essayiste Eula Biss, prend toute la mesure de ce que cela raconte de son statut social et de tout un système de valeurs. Elle désirait bien une maison pour elle et sa famille, pour le sentiment de solidité, de sécurité que cela procure, et pourtant elle ne peut s’empêcher de penser au temps pour écrire qu’aurait pu financer son compte épargne, à la perte de liberté qu’induit le confort matériel. « Je voulais m’accrocher à l’inconfort et je voulais m’accrocher au confort. Ce livre est le fruit de cette contradiction. » De ses comportements quotidiens, de ses conversations avec son mari John Bresland (écrivain et enseignant à l’université comme elle), avec ses amis écrivains, artistes, universitaires et de ses lectures infusées de littérature (Virginia Woolf, Emily Dickinson), d’anthropologie (David Graeber), de sociologie (Erik Olin Wright) ou de sciences économiques (John Kenneth Galbraith), elle va tirer une subtile réflexion sur la manière dont le capitalisme conditionne nos existences. Elle interroge aussi bien sa propre expérience de transfuge de classe, sa précarité passée, ses privilèges actuels de blanche aisée que notre rapport à la possession, au travail, à la consommation, au temps, notre aliénation. « Nous ne sommes pas obligés de privilégier l’accumulation plutôt que la redistribution, mais c’est la règle qui gouverne nos vies quotidiennes – nos emplois et nos jeux. » Quel sens donnons-nous au travail ? Quelle importance accordons-nous aux activités humaines qui ne génèrent pas de profit ? Quels critères prédominent pour définir ce qui est productif ou pas, utile ou pas ? Quelle place occupe un écrivain, un artiste dans notre modèle économique ? Autant de questions qu’Eula Biss nous tend comme un miroir et dont elle s’empare avec brio. « Peut-être que la valeur de l’art, pour les artistes comme pour les autres, réside dans le fait qu’il renverse les systèmes de valeur. L’art défait le monde produit par le travail. » Éd. Rivages, 352 p., 22 €. Élisabeth Miso
CORRESPONDANCES
Vladimir Kazakov, Théorie du monologue. Traduction, annotations et postface de Tatiana Nikishina et Olivier Gallon. Un homme écrit trente-cinq lettres d’amour à la jeune femme qu’il aime. « La vie et l’écriture, chacune dans le miroir de l’autre, échangent leur reflet ». « Douce Ira, J’ai une telle envie de vous écrire, ne serait-ce que quelques lignes ! Mais comment, et à quel sujet peut-on écrire à une telle matrechetchka ? Cette question me rend perplexe et en même temps m’émeut presque jusqu’au frisson. Savez-vous ce que je faisais pendant que vous restiez silencieuse ? J’écoutais sans cesse votre silence. J’ai entendu de bien curieux mystères (...) Votre VlaKa. » Théorie du monologue ou les lettres adressées à Irina, entre décembre 1973 et juin 1974, une jeune femme que l’on devine à travers la correspondance, mais dont on ne lit jamais les lettres en retour. Est louée sa jeunesse – il y a en vous tant d’enfant – sa douceur, une telle sensibilité en elle qu’il se sent lourd avec ses mots passionnés, exaltés, fiévreux, et au sens qu’il s’imagine trop ancien. Les lettres nous racontent cette histoire d’un homme qui attend, qui espère, dans un présent difficile, dans un climat hostile, et dont on peut comprendre qu’elles sont lues par leur destinataire. L’intime de cet homme nous est dévoilé dans son exaltation fiévreuse, emportée – comment « écrire une lettre calme, qui ne vous effraie pas ». On sait si peu de choses de cet auteur… On le découvre dans cette délicate édition, La Barque, avec son beau titre énigmatique comme l’illustration de couverture. On apprend que Vladimir Kazakov (1938-1988), né à Moscou, fut poète, écrivain, dramaturge, qu’avant de se consacrer entièrement à l'écriture, poésie, prose, théâtre – il a vingt-huit ans, à cette époque – vit de petits boulots physiques et d’errances, et verra son œuvre artistique, d’inspiration futuriste, publiée d’abord clandestinement. « Demain » : voici mon mot d'hier préféré. Nom : Vladimir. Nationalité : amour. Éditions La Barque, 48 p., 15 €, Corinne Amar
RÉCITS
Yves Ravey, Le drap. « Mon père ne travaille plus, depuis une semaine. Le matin, il reste assis à la cuisine, devant son bol de café. Il penche la tête, le coude sur la table, la main sur le front. Le médecin lui a signé un arrêt-maladie de quinze jours. Il a dit vous devez consulter des spécialistes à l’hôpital. C’est inutile, l’hôpital, a répondu mon père. Je n’ai jamais vu de docteur de ma vie, je n’ai jamais été malade. » Dans l’imprimerie où il travaille et respire des vapeurs nocives, un homme tombe malade. Parce qu’il n’a jamais été malade, parce qu’il a peur d’être licencié, il demande au médecin de garder le silence. « Et puis, un jour, il ne se lève pas. Comme un animal écrasé sur la route, il gît, à même le drap. » Il y a le père, sa figure d’homme abattu, impuissant, après avoir œuvré tant d’années à la tâche, les amis qui passent à l’hôpital – sa dernière visite là-bas, il espère aller mieux ensuite – partagent des souvenirs ; et puis, il y a, en parallèle, le portrait de cette mère, de cette femme dévouée à ses enfants, à son mari, qui rechigne à assommer, à découper une anguille pêchée le matin par le père – mais puisqu’elle doit – vaillante, jusqu’à la fin, et qui meurt avec lui, ce jour ultime où elle l’habille et le rase pour l’enterrement, avec juste devant elle, le vide des yeux du père. Un fils raconte la maladie de son père, raconte une vie et celle de ceux qui l’entourent. En soixante-dix-sept pages d’intense brièveté, en un style minimaliste adoptant précisément l’épure pour un sujet aussi personnel et douloureux, ce fils fait revivre les derniers instants ; un homme, une époque, un métier, une vie sur ce métier. Une vie dure. Parmi ses préférences, cet auteur discret citera volontiers Duras ou la littérature américaine qui lui aura beaucoup apporté : réduire au maximum, voilà sa marque de fabrique ; vouloir l’intrigue la plus simple, pour créer les émotions les plus vives, les plus complexes, voilà son enjeu. Un très beau texte. Éd. Minuit double (réédition), 80 p., 6,50 €. Corinne Amar