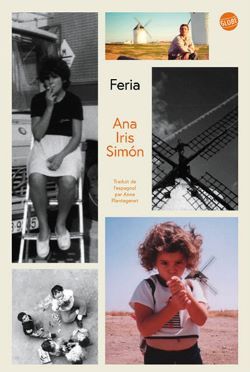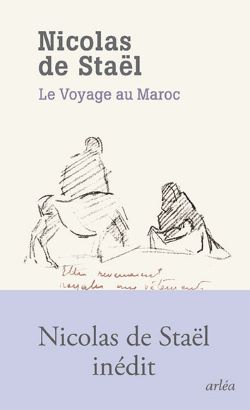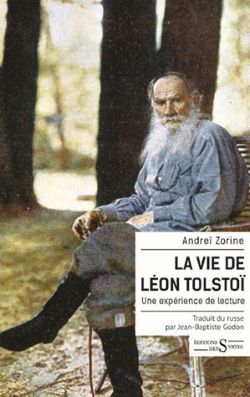Romans
Franck Courtès, À pied d’œuvre. Pendant vingt-six ans, Franck Courtès a été un photographe reconnu pour ses portraits d’artistes, de personnalités politiques ou de sportifs. Et puis un jour, il n’a plus supporté, trop d’injonctions mercantilistes, trop d’images partout pour désirer en créer de nouvelles. L’inspiration s’est évaporée. Il a abandonné la photographie pour l’écriture. Bien que rencontrant un succès certain, ses livres ne lui permettent pas de vivre. « Le métier d’écrivain consiste à entretenir un feu qui ne demande qu’à s’éteindre. Un feu dans la neige. Il faudrait prévenir, mettre un panneau. Cela exige une grande volonté. » Il s’enfonce dans la pauvreté, doit quitter son grand appartement pour un studio prêté par sa mère, se prive de tout, saute des repas, redoute le mépris ou la pitié de ses proches. Il désespère de trouver un emploi, ses cinquante-cinq ans lui ferment toutes les portes. Issu de la bourgeoisie, un tel déclassement n’était pas imaginable. Il s’inscrit sur une plateforme qui met en relation des particuliers avec des travailleurs manuels, prêts à offrir leurs services pour une rémunération de misère, « un genre de marché aux esclaves moderne ». Il devient homme à tout faire : déblayeur de gravats, jardinier, serveur, livreur à vélo pour quelques dizaines d’euros par jour et abîme son corps chaque fois un peu plus. Il côtoie d’autres hommes de milieux populaires, plus aguerris aux tâches ingrates ou plus dévastés encore. « Rien ne nous rapproche, malgré notre indigence commune. Le cloisonnement est si efficace qu’il dissout dans le silence et l’invisibilité toute possibilité de protestation. » Sa famille désapprouve son entêtement à rester dans une telle situation. Ses deux enfants adolescents sont partis vivre au Canada avec leur mère. C’est un grand déchirement pour lui de se confronter à leur incompréhension, de ne pas être à la hauteur de son rôle de père, mais il lui est impossible de renoncer à écrire. Franck Courtès décrit avec une grande lucidité et sans atermoiement, l’immense difficulté à rester en accord avec soi-même dans un monde totalement régi par l’avidité et l’asservissement, et a trouvé dans l’écriture sa manière de résister. Éd. Gallimard, 192 p., 18,50 €. Elisabeth Miso
Ana Iris Simón, Feria. Préface Manuel Vilas. Traduction de l’espagnol Anne Plantagenet. Ana Iris Simón est née en 1991 en Espagne. Elle vient d’un milieu modeste, a pu faire des études supérieures et devenir journaliste et pourtant son existence ne lui semble pas plus enviable que celle de ses parents et de ses grands-parents. À son âge ses parents étaient propriétaires et avaient déjà fondé une famille, projets inaccessibles à la plupart des gens de sa génération. S’interroger sur la précarité des trentenaires européens, sur les conséquences de la crise financière de 2008, sur les frustrations de la classe moyenne espagnole, sur l’idée de progrès ou sur la maternité, la conduit à sonder ce qui lui a été transmis. Dans ce premier roman autobiographique, elle rend hommage aux siens, à sa terre et contemple avec nostalgie « les vestiges d’une Espagne qui fut et n’est plus. » Elle a grandi à Ontígola dans la province de Tolède. Ses parents étaient facteurs. Ses grands-parents maternels, forains, déplaçaient leur stand de jouets de feria en feria, de village en village. Ses grands-parents paternels étaient paysans communistes, originaires de Campo de Criptana, dont les moulins à vent ont été immortalisés par Don Quichotte. Chez les Simón, la famille se réunissait au grand complet deux fois par an. L’oncle Hilario qui travaillait depuis ses dix ans, aurait pu être instituteur, tant il était féru d’histoire et de poésie. C’était un formidable conteur, qui savait que « la seule manière que nous avons de rester vivants, c’est la mémoire. Nous restons vivants dans les histoires que nous racontons. » Son père lui a aussi enseigné l’importance de vivre dans les récits, sa mère une manière bien à elle de rayonner et de tenir à distance la routine. La jeune écrivaine rend palpable la fantaisie, la générosité, la poésie dans laquelle elle a baigné au sein de cette famille étonnante. Elle raconte la force des liens tissés entre les êtres, de l’attachement à cette terre sans relief de La Mancha. Pour Ana Iris Simón « (…) il n’existe rien de plus beau que la fierté que s’autorisent les humbles, car elle émane des choses essentielles.» Éd. Globe, 272 p., 22,00 €. Elisabeth Miso
Récits
Lori Saint-Martin, Pour qui je me prends. « Si j’ai changé de vie et de langue maternelle, c’était pour pouvoir respirer alors que j’avais toujours étouffé. Je raconte, ici, l’histoire d’une femme qui a appris à respirer dans une autre langue. Qui a plongé et refait surface ailleurs. » Dans ce récit intime, la romancière, traductrice et professeure d’université Lori Saint-Martin (1959-2022), dévoile comment elle s’est complètement réinventée en changeant de langue. Elle a vu le jour dans une famille prolétaire de Kitchener, une ville industrielle du sud de l’Ontario. Enfant, elle ne se sent à sa place ni dans son foyer, ni dans sa langue maternelle. Très tôt, elle comprend qu’il lui faudra fuir cet univers monotone pour ne pas dépérir. À dix ans, elle découvre le français à l’école et c’est une révélation. Elle se promet de tout mettre en œuvre pour faire des études, se choisir une nouvelle langue, un nouveau nom et devenir écrivain. La musique et la littérature sont des lueurs vers cet autre horizon dont elle rêve adolescente. Pour qui te prends-tu ?, lui reproche sa mère dès qu’elle sent sa volonté farouche de s’éloigner d’elle, d’échapper à son destin. « Jamais le français ne m’a semblé une langue étrangère : il était vrai, profond, j’y étais chez moi, j’y étais moi. » Elle travaillera d’arrache pied pour maîtriser dans les plus subtiles nuances cette langue qui s’imposera comme celle de l’écriture. Elle sera la première de sa famille à entrer à l’université et construira sa vie d’adulte au Québec. Longtemps elle a tu son passé, ses racines ouvrières, l’effacement de son nom. Avec ce livre, qu’elle a écrit en quelques semaines au café Barbieri de Madrid, Lori Saint-Martin remonte le cours de sa singulière métamorphose en traquant la jeune fille qu’elle était. À travers sa relation à ses origines, à la littérature et aux trois langues (avec l‘espagnol) qui l’accompagnent quotidiennement, elle reconstitue les multiples facettes de son identité. Elle s’est vraiment réconciliée avec l’anglais à la naissance de ses enfants, et a pu pleinement renouer avec les siens avant de les perdre. « (…) c’est l’histoire d’une femme qui est parvenue à parler enfin. » Éd. de l’Olivier, 160 p., 17,00 €. Élisabeth Miso
Nicolas de Staël, Le voyage au Maroc. « Le Maroc est tellement beau qu'il faudrait y faire une académie de peinture ». Lorsqu’il arrive au Maroc entre 1936 et 1937, Nicolas de Staël (1913-1955) a 23 ans. Il sort de l’Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles, veut voir le monde, changer d’horizon et de lumière. Il parcourt le pays. À Marrakech, il rencontre plusieurs peintres français. Dans un café, point de rendez-vous des artistes, il croise Jeannine Guillou. Peintre elle-même, elle est alors mariée à l'artiste polonais Olek Teslar. « Nicolas demande à la cantonade, où trouver de la terre pour modeler et Jeannine l'emmène chez elle. Ils ne se quitteront plus. » Il la convainc de partir avec lui. Celle dont il peindra le portrait en 1941 et 1942 sera sa muse et sa compagne dix ans durant. Il narre, dans un premier texte écrit à l’origine pour une revue, sa découverte du Maroc : « Les Gueux de l’Atlas ». Il y défend la culture berbère que les Arabes méprisent. La deuxième partie est constituée de lettres qu’il adressa à ses parents adoptifs. Ses propres parents étant morts tragiquement peu après que la famille eut émigré en Pologne, les trois enfants – Nicolas avait cinq ans – furent élevés par un couple d’amis, un industriel d’origine russe, Emmanuel Fricero et son épouse. Il leur fait part de ses recherches artistiques, tandis qu’un nouveau monde s’ouvre à lui, de ses réflexions, qu’il nourrit de croquis, de ses incertitudes, de son manque d’argent. En fin, des notes éparses de Nicolas de Staël. Le volume, constitué de textes pour la plupart inédits, est présenté et annoté par Marie du Bouchet, et édité à l’occasion de la rétrospective grandiose consacrée à Nicolas de Staël au Musée d’Art Moderne de Paris, jusqu’au 21 janvier 2024. Éditions Arléa, 183 p., 22 €. Corinne Amar
Andreï Zorine, La vie de Léon Tolstoï, Une expérience de lecture. Traduit du russe par Jean-Baptiste Godon. Spécialiste de la culture et de l'histoire intellectuelle russe à l'Université d'Oxford, l’auteur nous plonge dans la vie de la plus grande gloire littéraire de son temps, Léon Tolstoï (1828-1910). Mêlant avec un sens subtil de la narration et de l’érudition les éléments biographiques, des analyses littéraires, des extraits des journaux de Tolstoï et de sa femme, Sofia – l’un comme l’autre ont tenu un journal jusqu’à leur mort – il nous dévoile l’écrivain de génie, mais aussi l’homme pétri d’angoisse et de contradictions qui utilisait ses journaux intimes comme moyen d'autoflagellation cathartique, malheureux de ne savoir maîtriser son goût immodéré pour les plaisirs de la chair. Tolstoï connut à la fin de sa vie une révolution spirituelle : il repensa le mariage et la relation conjugale, appela même, dans son roman qui fit scandale, La Sonate à Kreutzer (1889), à renoncer totalement à l'amour charnel. Lorsqu’alors âgé de 34 ans, il voulut épouser Sofia qui, à l’époque n’avait que 18 ans, il invita sa fiancée à lire ses journaux intimes dans lesquels il décrivait, entre autres faits, ses relations passées avec d'autres femmes, dont une paysanne avec qui il avait eu un enfant naturel. Si la jeune femme fut choquée, elle ne renonça pourtant pas au mariage. On découvre ainsi que Sofia ne fut pas seulement une mère de 13 enfants (dont neuf survécurent) attelée aux innombrables tâches domestiques, mais qu’elle fut une femme : cultivée, pianiste, artiste, qui écrivait des nouvelles et tint un journal toute sa vie, blessée par la jalousie de son mari ou frustrée de ne pas s’épanouir davantage. On apprend que Tolstoï était un sensible qui aspirait à la tendresse et regrettait une mère qui le laissa orphelin à l’âge de deux ans après avoir donné naissance à son unique fille. Le vieil homme de 77 ans en 1906 notait dans son journal : « Humeur pesante et maussade toute la journée. Le soir venu, mon état s’est changé en tendresse : j’éprouvai un besoin d’amour, d’affection. Où pouvais-je me blottir ? Me pelotonner comme le font, je suppose, les enfants avec leur mère. » Éd. des Syrtes, 252 p., 23 €. Corinne Amar