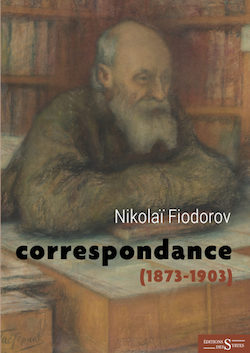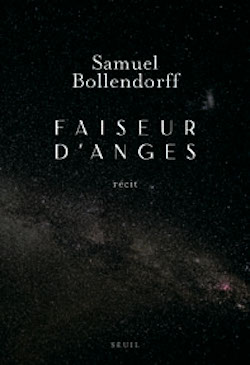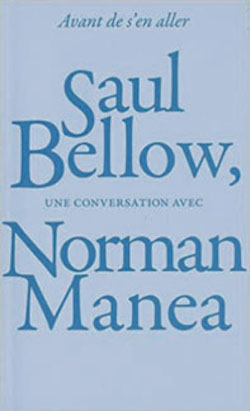CORRESPONDANCES
Nathalie Azoulai Serge Toubiana, Ozu et nous. Nathalie Azoulai et Serge Toubiana ont voulu partager par écrit leur fascination pour le cinéma de Yasujirô Ozu. Ils se sont ainsi penchés sur vingt et un de ses cinquante-quatre films (Le Fils unique, Il était un père, Bonjour, Printemps tardif, Voyage à Tokyo…) Dans un dialogue sensible, ils mettent en lumière ses thèmes de prédilection : les liens familiaux, la transmission, les relations entre hommes et femmes, le poids des injonctions de la société japonaise, le conflit entre tradition et modernité, les jeunes femmes qu’on presse de se marier, le contraste entre la vie à Tokyo et la vie en province, le passage du temps. Tous deux sont particulièrement frappés par la subtilité avec laquelle le cinéaste japonais dépeint les relations entre parents et enfants et notamment ce moment déchirant où les enfants adultes partent pour construire leur propre famille. « (…) Yasujirô réalise le miracle de tresser ensemble la pudeur et l’intimité pour descendre, comme le long d’une corde, dans la profondeur des attachements. », note la romancière au sujet de Printemps tardif qui relate l’histoire d’une fille qui ne souhaite pas quitter son père veuf. L’un comme l’autre, film après film, ils sont éblouis par la grâce et la beauté des images, la puissance des sentiments sans que jamais les corps ne s’effleurent. L’ancien critique des Cahiers du cinéma et ancien directeur de la Cinémathèque française analyse le parfait équilibre entre la forme et le propos. « Ozu n’a jamais besoin d’insister ni de souligner, tant le moindre souffle, la moindre sensation se ressentent de manière démultipliée, et tant les effets de mise en scène et le découpage des séquences sont délicats et harmonieux. » Il rappelle, en citant Henri Langlois, combien le génie d’Ozu n’a été reconnu que tardivement en Europe, alors que Mizoguchi et Kurosawa étaient primés dans les plus grands festivals internationaux. Sans doute, s’accordent-ils à penser, parce ce que son cinéma s’est concentré sur la vie domestique avec une apparente modestie dans l’intrigue et la forme. Même si elle se fonde sur des spécificités culturelles, des codes sociaux qui échappent parfois à notre entendement occidental, la perception d’Ozu de la condition humaine est bien universelle. Voyage à Tokyo, par la justesse des situations et des émotions décrites, ravive ainsi chez Nathalie Azoulai et Serge Toubiana des blessures intimes qu’ils évoquent fugacement avec pudeur. Éd. Arléa, 222 p., 19 €. Élisabeth Miso
Nikolaï Fiodorov, Correspondance (1873-1903). Fils illégitime d’un prince et d’une paysanne, Nikolaï Fiodorov (1828-1903), né dans la région de Tambov, à quelques 400 kms au sud-est de Moscou, fondateur d’un courant de pensée qu’on appelle le cosmisme russe, et surnommé le Socrate moscovite, était philosophe et chrétien. Il occupa le poste de bibliothécaire pendant vingt-cinq ans au Musée Roumiantsev, à Moscou, après avoir enseigné l’histoire et la géographie dans différentes écoles et villes de Russie. Il détonna par son savoir encyclopédique et sa pensée philosophique, humaniste, qu’il érigea en une œuvre qu’il appellera Philosophie de l’œuvre commune (1906, Des Syrtes, oct. 2021). Dès la fin du XIXe siècle, le cosmisme russe plaçait l’homme au centre d’un univers plus vaste encore que le globe terrestre, univers confié par Dieu, qu’il s’agissait de préserver, d’enrichir et non d’exploiter. « À cette œuvre, l’homme est appelé à participer, et il a une responsabilité face aux destinées du monde ». Fiodorov accorde une place exceptionnelle à l’action humaine, indissociable du savoir, et c’est elle qui unit tous les hommes. Trait caractéristique des débuts de l’ère soviétique ; l’homme, selon Fiodorov, doit être capable de se créer ou de se recréer lui-même. Penseur, philosophe, il a foi en les avancées de la science. De même, il se voudra le porte-parole des « non-instruits », ceux-là mêmes qui sont le plus exposés aux maux divers, aux maladies, à la faim… Les 281 lettres de sa correspondance sont adressées essentiellement à ses deux disciples, mais aussi à ses pairs – éditeurs, peintre, philosophes – et grands penseurs de son temps. Il y expose sa pensée en progression, ses interrogations, son enseignement, des idées aussi brûlantes d’actualité que les questions de météorologie, d’urbanisation en excès, la conquête de l’univers, sa préservation, la maladie, la mort. « Vaincre la mort », était son obsession. Éd. Des Syrtes, 506 p., 25€. Corinne Amar
RÉCITS AUTOBIOGRAPHIQUES
Rachel Cusk, L’œuvre d’une vie. Devenir Mère. Traduction de l’anglais Lori Saint-Martin et Paul Gagné. Dans ce livre écrit il y a vingt ans, Rachel Cusk confie son expérience de la maternité, faisant voler en éclats tous les clichés de la félicité. De la grossesse jusqu’aux premiers mois de vie de sa fille aînée Albertine, elle sonde les sentiments ambivalents et les profondes métamorphoses qu’elle a observés chez elle. Elle démonte avec humour les tabous autour du mystère de la naissance, les discours idéalisants sur la grossesse, l’accouchement et l’arrivée d’un enfant qui ne préparent pas à la brutale réalité de la maternité. Malgré leur émancipation, leur indépendance financière et professionnelle, les femmes sont toujours confrontées au patriarcat. De la domination médicale au partage de la parentalité et des tâches domestiques, les femmes savent qu’elles n’occupent pas la même place que les hommes. « La destinée biologique des femmes se dresse toujours au milieu des ruines de leur inégalité. », constate la romancière. En devenant mère, elle s’est aperçue qu’un glissement identitaire avait eu lieu, elle n’était plus et ne serait plus jamais la même personne, la même écrivaine qu’elle était auparavant. Elle ne peut plus disposer de son temps, de ses envies, de sa liberté comme elle l’entend, ne vivre ou ne décider que pour elle-même. Elle se demande comment concilier sa réussite personnelle et ses obligations maternelles. Son corps et son esprit sont désormais connectés à son enfant. « Avoir des enfants isole les femmes des hommes, mais aussi d’elles-mêmes dans la mesure où l’idée qu’une femme se fait de l’existence est profondément transformée. Une autre personne a existé en elle et, une fois née, continue d’habiter le royaume de sa conscience. » Bien que comblée par la maternité, Rachel Cusk mesure la douleur et les interrogations que génère le renoncement à sa vie passée. Des sentiments contradictoires l’assaillent entre amour absolu et aliénation perturbante qu’elle illustre par des citations littéraires (Tolstoï, Edith Wharton, Coleridge, D. H Lawrence ou Flaubert). L’amour maternel la surprend et la façonne, « (…) comme tout amour, celui-ci renferme en son cœur un conflit, un germe de tourment qui érode la perle du plaisir ; mais contrairement aux autres, il ne peut être résolu. » Au fil des mois, elle raconte comment elle et sa fille s’apprivoisent l’une l’autre, comment elle explore ce que c’est que d’être mère et ce qu’elle découvre sur elle-même. Éd. de L’Olivier, 224 p., 20 €. Élisabeth Miso
Samuel Bollendorff, Faiseur d’anges. Le photographe et réalisateur Samuel Bollendorff qui capture habituellement dans son objectif l’existence des autres, pose ici son regard sur son histoire personnelle, dans un récit nourri de photographies intimes qu’il convoque sans les montrer. L’album de famille s’ouvre sur la mémoire photographique élaborée année après année par Margot sa grand-mère paternelle luxembourgeoise et qui le captivait enfant. Les trous qu’elle comporte sont autant d’indices sur les drames ou les désillusions dont on se refusait à parler dans un milieu bourgeois prisonnier des convenances. Le livre gravite autour de Paul, le père de l’auteur. Ancien psychiatre, il s’est un jour retranché du monde, abîmé dans sa violence et dans un système de pensée, un flot de paroles discontinu incompréhensibles pour ses proches. Samuel Bollendorff revisite sa propre construction mentale entre ce père si singulier et une mère psychanalyste qui n’a jamais enfermé qui que ce soit dans un diagnostic définitif et réducteur. Enfant, il voyait son père un week-end sur deux et durant les vacances. Il se souvient de leurs moments de complicité dans la Ford Fiesta jaune, de leurs vacances au Luxembourg, de la tendresse de Margot, des sempiternels conflits familiaux que provoquait l’étrange comportement de Paul, mais aussi des moments de joie et de fantaisie uniques. Le laboratoire photo que Paul installe dans sa salle de bains devient un espace de conversation privilégié, le lieu où il développe enfant sa propre vision des choses, le déclencheur de sa passion pour le langage visuel. « Chaque photographie prendra à sa charge une part évanescente du souvenir, la consignera, gage contre le vide de l’oubli. C’est ma révélation. » Hanté depuis toujours par l’effacement et le néant, le photographe jette des passerelles entre son cheminement intérieur et ce qu’il veut donner à voir dans ses images. Dès ses débuts, il s’interroge sur les rapports entre fond et forme « Je cherchais à produire des formes d’images qui impressionneraient la rétine de façon affective, qui permettraient de ressentir avant tout. » À l’abri de rien, Le Grand Incendie, La nuit tombe sur l’Europe, Contaminations, ses enquêtes photographiques et ses films témoignent de notre perte d’humanité, de la violence faite aux plus faibles (mal-logés, sans-abris, malades, réfugiés, travailleurs détachés) dans nos sociétés actuelles ou encore des ravages environnementaux. Éd. du Seuil, 176 p., 18 €. Élisabeth Miso
MÉMOIRES
Saul Bellow, Avant de s’en aller, Une conversation avec Norman Manea. Traduit de l’anglais et du roumain par Marie-France Courriol et Florica Courriol. C’est une rencontre entre deux grands écrivains : le premier, fils d'immigrants juifs russes, américain depuis l’âge de neuf ans, une vingtaine de romans derrière lui – dont Un homme en suspens, son premier roman publié en 1944, et le fameux Herzog (1966) – Prix Nobel de littérature en 1976, romancier, avec une carrière de professeur de littérature qui le mènera d'université en université, de Chicago à New-York ; le second, roumain, né en 1936, Juif aussi, et son cadet de vingt et un ans, qui pose les questions, connaît l’écrivain, aime l’homme. Saul Bellow (1915-2005) et Norman Manea se rencontrent pour la première fois à la fin des années 1970 à Bucarest, dans une réunion officielle à l’Union des Écrivains de Roumanie. « Notre démocratie socialiste, explique Norman Manea, avait besoin de quelques écrivains juifs pour accueillir le célèbre auteur américain qui avait lui-même des origines juives. (...) » Ils se reverront, s’estimeront, dans une proximité intellectuelle et intime, deviendront amis. Portrait subtil qui parle de l’exil, de l’identité, de la transmission, des femmes (Saul Bellow aime beaucoup les femmes, les séduire), de la littérature – et notamment juive-américaine. Il parle plusieurs langues ; le yiddish à la maison, l'hébreu qu'il apprend à l’école juive, l'anglais et le français qu'il entend dans les rues de Chicago, puis à New-York. Il est surtout un fervent défenseur de la dimension extraordinaire du quotidien, sensible à ses principes de vie : une extrême lucidité sur le monde, une éducation religieuse, un sens de la fidélité et de la loyauté envers lui-même : « (...) Le monde est un endroit étrange ; on a sa propre version, qui n’est pas celle d’un autre ; et on reste fidèle à sa version et à ce qu’on a vu. C’est, je pense, personnellement, ce qui est à la base de ma condition d’écrivain. Tu sais parfaitement de quoi je parle. » Éd. La Baconnière, 160 p., 11€. Corinne Amar