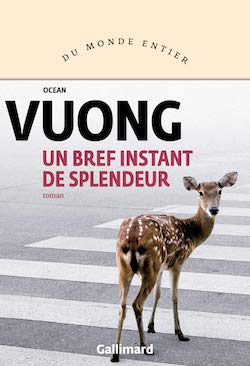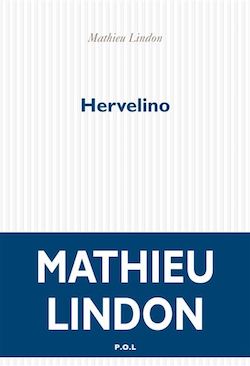AUTOBIOGRAPHIES
Chantal Thomas, De sable et de Neige. Chantal Thomas aime à revenir sur les rivages de son enfance. Chaque parcelle de sa peau garde en mémoire l’océan, le sable et le ciel du bassin d’Arcachon. Ce décor maritime l’a initiée très tôt à la changeante beauté du monde. « S’il entrait dans une géographie, c’était d’abord dans celle, intime, mouvante, de (s)on âme, dans une manière d’être du côté du friable et de l’évanescent ». L’écrivaine publie quelques photographies anciennes et laisse affleurer les souvenirs, les sensations et les émotions intenses liées à ce paradis maritime, « là où le monde était en accord avec (s)es envies ». Là où elle a ancré en elle cette joie d’exister, aiguisé cette capacité à vibrer avec ce qui l’entoure, à saisir les moments fugaces de beauté et de grâce. Elle se glisse à nouveau dans son corps de petite fille toujours en mouvement, offert à toutes les expériences sensorielles, ivre de vagues et de jeux sur la plage, d’infinie liberté. L’éblouissement imprimé en elle par ce paysage girondin l’a poussée vers d’autres horizons. Ici encore, Chantal Thomas égrène des impressions de voyages, des images inoubliables : un hôtel inachevé en Algérie, le Machu Picchu, Kyoto sous la neige et parle du délicieux rituel qu’est l’appropriation d’une chambre d’hôtel. Souvenirs de la marée basse était consacré à sa mère, ce livre-ci dévoile son amour pour son père, disparu prématurément à quarante-trois ans quand elle avait dix-sept ans. Ce père « emmuré dans son blockhaus de silence », qui n’évoquait jamais la guerre et ses années de résistance, ni son travail de dessinateur industriel dans une usine à papier, avait une présence lumineuse. Au fil des pages, il lui apparaît très nettement. De dos, se découpant sur fond de ciel et de mer, conduisant son bateau vers des eaux de pêche, skiant dans les Pyrénées ou se retournant vers elle pour lui tendre des cerises, lors d’une randonnée en montagne. « Désormais je vivrai sur deux temps : le temps figé du deuil impossible, le temps mobile et miroitant de l’événement. La mort de mon père : une partie de moi, cachée, est devenue pierre, l’autre a fait de justesse un saut de côté et a rejoint le courant de la vie, sa merveilleuse fluidité. », confesse-t-elle. Ce séisme affectif a décidé de l’orientation qu’elle donnerait à son existence, elle fuirait l’ennui et les conventions et n’aurait « d’autre guide que l’intensité de l’émotion : l’éclat de l’instant ». Éd. Mercure de France, Traits et portraits. Avec des photos d’Allen S. Weiss, 208 p., 19 €. Élisabeth Miso
ROMANS
Ocean Vuong, Un bref instant de splendeur. Traduction de l'anglais (États-Unis) Marguerite Capelle. « J’ai vingt-huit ans, je fais 1,63 m, 51 kg. Je suis beau vu sous trois angles exactement, et sinistre de partout ailleurs. Je t’écris de l’intérieur d’un corps qui autrefois t’appartenait. Autrement dit, je t’écris en tant que fils. » Dans une longue lettre adressée à sa mère analphabète, Little Dog, le narrateur, se penche sur sa douloureuse histoire familiale et sur sa double culture vietnamo-américaine. Né à Saïgon en 1988, il arrive à l’âge de deux ans aux États-Unis. Il grandit dans un quartier pauvre de Hartford dans le Connecticut, entre une mère qui use parfois de ses poings sur lui et une grand-mère tendre et schizophrène, deux femmes dévastées par la guerre du Vietnam. À dix-sept ans, sa grand-mère a laissé derrière elle sa campagne et un mariage arrangé. Elle s’est rebaptisée Lan (Orchidée) et a également choisi un nom de fleur pour sa fille Hong (Rose), née d’un soldat américain. Little Dog parle avec sa mère et sa grand-mère un vietnamien atrophié et leur sert d’interprète en anglais. « Notre langue maternelle n’a donc rien d’une mère : c’est une orpheline. Notre vietnamien est une capsule temporelle, qui marque la fin de ton éducation, réduite en cendres. Maman, s’exprimer dans notre langue maternelle, c’est parler seulement partiellement en vietnamien, mais entièrement en guerre. » Il porte en lui les traumatismes de ces deux femmes et le roman entier gravite autour de ce lourd héritage. « J’étais une plaie béante au beau milieu de l’Amérique et tu étais à l’intérieur de moi, tu demandais : Où sommes-nous ? Où sommes-nous, mon bébé ? » Toute son enfance, il voit sa mère s’épuiser pour gagner de quoi survivre, d’abord à l’usine puis dans des salons de manucure. À l’adolescence, il découvre dans un champ de tabac son homosexualité et qu’il peut être vu et désiré pour ce qu’il est. Ocean Vuong signe avec ce premier roman autobiographique, une magnifique déclaration d’amour filial et explore les questions de transmission, d’exil, de race, d’identité, de langage et d’addiction. Sa voix tout à la fois poétique et crue, nous rappelle que les mots, le langage, la littérature sont des alliés puissants pour comprendre qui nous sommes. Éd. Gallimard, Du monde entier, 304 p., 22 €. Élisabeth Miso
Adriaan Van Dis, Quand je n'aurai plus d'ombre. Traduction du néerlandais (Pays-Bas) Daniel Cunin. À quatre-vingt-dix-huit ans, la mère d’Adriaan Van Dis, bien décidée à quitter ce monde, entend bien recueillir l’aide de son fils. L’écrivain néerlandais y consent à la seule condition qu’elle lève le voile sur les mystères de sa vie. Mais consigner les souvenirs d’une personne, habituellement avare de confidences, peut s’avérer une entreprise déroutante. Le fils s’arme donc de patience face à un récit chaotique, dénué de trame chronologique, surgi d’associations d’idées et d’images. Pour espérer reconstituer le puzzle familial, il lui faut écarter ses mensonges et ses dénis, supporter ses exigences et sa brutalité, réprimer les nombreuses questions qui l’assaillent. Entre rage et tendresse contenue, une lutte s’engage entre eux. « Notre colère me tenait sous son emprise. La colère, c’est aussi de l’amour, tangible au milieu de la nuit. » Adriaan Van Dis sent pourtant poindre de l’émotion chez cette femme fière, autoritaire et distante. Sa mère semble enfin se délester « des souvenirs qui la poursuivaient, dont elle souffrait et qui, au fil des années, s’étaient mis à mener une vie autonome dans sa tête, une existence indivisible. Peut-être entrouvrait-elle son intérieur d’acier et m’accordait-elle un certain accès à son intimité. » Un objet obsède l’auteur depuis des décennies : ce coffre recouvert d’un batik, toujours fermé à clef, source d’une terrible dispute entre eux quand il avait seize ans (scène inaugurale du roman). Quels secrets peut-il bien renfermer ? Que pourrait-il lui apprendre sur cette mère énigmatique, froide, qui s’éclipsait quand son père (son second mari) le battait et dont il guettait des manifestations d’amour. Issue d’une famille de propriétaires terriens, elle a épousé un officier indonésien qu’elle a suivi aux Indes néerlandaises. La Deuxième Guerre mondiale lui a ôté ce premier mari et l’a jetée avec ses trois filles dans un camp japonais. C’est ce passé colonial, dont il sait si peu de choses, que le romancier cherche plus particulièrement à démêler. Bribes par bribes, il brosse alors le portrait d’une aventurière et sonde leur attachement féroce, donnant à voir toute la complexité de leur relation mère-fils. Éd. Actes Sud, 320 p., 22,50 €. Élisabeth Miso
MÉMOIRES
Julien Gracq, Nœuds de vie. Ce sont des fragments de prose que ces nœuds de vie, des Instantanés poétiques, qui entrecroisent les thèmes chers à l’écrivain – le voyage, la flânerie le long des routes, des chemins, la littérature – et le timbre d’une voix, d’une écriture, qui rappellent que la beauté existe bien. La Bibliothèque nationale de France qui possède un fonds Julien Gracq (1910-2007) détenait ce carnet inédit. Il nous est donné à lire aujourd’hui, en attendant un ensemble de textes dont il fait partie, 29 autres cahiers, intitulés Notules. Gracq en a interdit la publication pendant la durée de vingt ans après sa mort, soit en 2027. Parce qu’il y égratigne ses contemporains ici et là, au fil de la plume ? Probablement, évoque l’universitaire, Berhild Boie, qui signe l’avant-propos. Ces instants littéraires amènent sans forcer à la contemplation. « Il fait un froid de fin d’hiver clair et froid, de ce bleu métallique et luisant de zinc neuf qu’on voit au ciel des dernières gelées quand les jours rallongent (…). L’envie brusque m’a traversé, je ne sais pourquoi, d’être transporté aux pointes de Bretagne, dans le fleuve de vent acide, corrugant, qui décape les petites maisons blanches, sur la côte saliveuse et fouettée, vers la mer qui dans chaque échancrure grumelle et monte comme la neige des œufs battus. » Julien Gracq se promène, lit, écrit, observe, fait part de ses goûts, consacre tout un chapitre aux chemins et aux rues de ses flâneries, dans les villes ou les campagnes de France – lorsque les églises sonnent les vêpres – se fixe sur des époques, revoit des souvenirs d’enfance, la figure de son grand-père, pense aux passions qui s’éloignent avec l’âge sauf celle conservée, entretenue, vitale de la littérature. La langue est ciselée, les mots ne craignent pas d’être rares, ont leur musique, leur langage, leur intemporalité. Éd. José Corti, 165 p., 18 €. Corinne Amar
RÉCITS
Mathieu Lindon, Hervelino. « (…) Le mot évoque l’Italie et l’Italie m’évoque Hervé. Il date du début de notre relation et l’Italie était encore loin, on ignorait qu’elle en serait le stade quasi ultime. Au fil des années, j’y ai rejoint Hervé à l’île d’Elbe, dans la maison de Hans Georg ou à l’ermitage de Santa Catarina qu’il aimait tant, mais la Villa Médicis, ce fut une autre vie. Hervé y est arrivé pour deux ans à l’automne 1987, juste avant d’apprendre qu’il était séropositif. » Il appelait son ami, l’écrivain, journaliste et photographe, Hervé Guibert (1955-1991) « Hervelino », ils s’étaient rencontrés en 1978, chez le philosophe Michel Foucault. Tous les deux, journalistes – Lindon, au Nouvel Observateur, Guibert, au Monde, tous les deux écrivains – libres et jeunes, héros magnifiques d’une époque que le sida allait dévaster. Hervé Guibert, avec ses boucles blondes de poète séduisant, subversif, a ce visage d’ange dont tous s’accordent à dire qu’il est d’une beauté surréelle. C’est pour l’un l’âge de la jeunesse, c’est pour l’autre, déjà la fin de la vie. Ils ont le même âge, trente ans, lorsqu’ils se retrouvent pensionnaires ensemble à la Villa Médicis, à Rome. Hervé y est depuis un an. Quand Mathieu arrive à la Villa Medicis l’année d’après, il l'héberge chez lui une année de plus, incognito. La maladie s'est déjà déclarée, mais il continue d’écrire intensément, de vivre, de l'oublier. Leur amitié durera jusqu’à la mort d’Hervé en 1991, à l’âge de trente-six ans. Mathieu Lindon raconte, dans Hervelino, les intenses années de complicité, d’amitié amoureuse entre Rome et Paris, l’écriture, les sorties romaines, les moments de fête, les restaurants toujours, puis le retour à Paris, la maladie, les visites impossibles à l’hôpital. « Dans mon idée, il n’était pas chaud pour que sa dégradation physique apparaisse devant moi qui avais été amoureux de lui sans jamais avoir couché avec lui. » Un texte pudique qui dit l’amour et l’amitié, le souvenir et la mélancolie du souvenir. Éd. POL, 170 p., 18 €. Corinne Amar