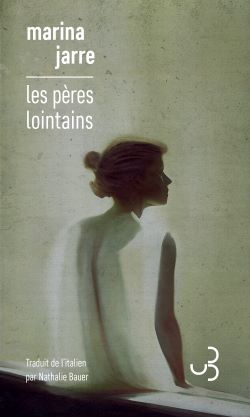Récits
Chris de Stoop, Le Livre de Daniel. Traduction du néerlandais (Belgique) Anne-Laure Vignaux. « Oncle Daniel, qui ne faisait qu’un avec sa ferme et acceptait son déclin, avait pour philosophie de toujours se tenir en dehors. Il ne nourrissait plus d’ambitions, n’attendait plus rien. Dans sa ferme, derrière ses volets fermés et sa porte barricadée, personne ne pouvait le voir ni l’entendre, il pouvait être simplement lui-même. Libre. » Daniel Maroy, un fermier de quatre-vingt-quatre ans, a été assassiné chez lui, un soir de mars 2014, par des jeunes gens désœuvrés d’un village voisin. Les faits se sont déroulés à Saint-Léger en Belgique. Ces vingt dernières années, après le décès de ses parents et de son frère handicapé, la perte de ses terres, et un échec amoureux, le vieil homme s’était isolé, réservant ses marques de tendresse à ses quatre vaches. Chaque samedi, juché sur son tracteur bleu, il se rendait au supermarché et conversait avec plaisir, avec la caissière ou avec la boulangère. Mais pour la plupart des habitants, c’était un marginal, « un vieux crasseux », quelqu’un de négligeable. Chris de Stoop a très peu connu son oncle Daniel, mais il se sait relié à lui. Comme lui, il a grandi dans une ferme et a pu observer les bouleversements du monde paysan, la détresse des exploitants agricoles, la désertification des campagnes, les désastres écologiques. Il partage le même attachement à la terre, le même amour de la nature et des animaux, et s’est posé dans la ferme familiale après avoir longtemps parcouru le monde pour ses reportages. En tant que partie civile, représentant de la famille, il a participé activement au procès qui s’est tenu en 2019 à Mons. Il a pris soin d’apporter au tribunal une photo de son oncle, lui redonnant ainsi un visage, réparant cette invisibilité qui ne semblait gêner personne. « Comme si cela n’avait pas d’importance. Comme s’il n’avait pas vécu et n’existait qu’à travers sa mort. » Avec une précision d’enquêteur chevronné, une profonde empathie et une remarquable remise en perspective du contexte social et des diverses responsabilités, l’écrivain belge met au jour tout le processus de déshumanisation à l’œuvre dans cette tragique affaire. Éd. Globe, 288 p., 22 €. Élisabeth Miso
Marina Jarre, Les Pères lointains. Traduction de l’italien Nathalie Bauer. En 1987, Marina Jarre publiait ce récit autobiographique, aujourd’hui traduit en français. La romancière italienne y déploie une fascinante exploration identitaire, de la mémoire et des liens familiaux. Elle est née en 1925, à Riga, d’un père juif letton et d’une mère italienne. Sa mère lui préfère sa sœur cadette et passe son temps à détailler ses défauts. Son père est presque un étranger pour elle. Dès son plus jeune âge, elle manifeste une étonnante conscience d’elle-même et des autres. Elle s’interroge sur ses émotions, sur ses propres comportements et ceux des adultes, tente de décrypter le monde qui l’entoure et ce qu’on attend d’elle. Elle n’a jamais l’impression d’être à sa place, toujours embarrassée par ce « moi intérieur sans forme ». Elle développe très tôt un goût prononcé pour la lecture et pour le langage, élabore des mensonges, invente des histoires, trouvant dans les mots un dérivatif à ses peurs et à ses faiblesses. Même si elle la jalouse parfois, sa sœur est son seul véritable ancrage affectif. Tous ses repères basculent en 1935, quand à dix ans, elle s’installe avec sa mère et sa sœur à Torre Pellice dans le Piémont, chez sa grand-mère maternelle. À douze ans, elle voit son père pour la dernière fois, il mourra fusillé par les Allemands à Riga, en 1941. « Diversement absents de ma vie, mon père et ma mère, fantômes symboliques, l’ont marquée tous deux d’un sceau non direct, non voulu et pas même imprimé par eux, ma mère ne pouvant m’accepter, mon père avec sa mort tragique. » Elle convoque sa jeunesse sous le fascisme, les années de guerre, ses amis résistants. Elle sonde sa vie d’épouse et de mère, le décalage existant entre son désir d’être une femme et son réel ressenti. « En tant que femme, il m’a fallu naître de moi-même, je me suis mise au monde avec mes enfants. » Marina Jarre dépeint, avec une remarquable acuité et une grande beauté formelle, la manière dont elle s’est construite en tant que fille, que mère et qu’écrivaine. Éd. Christian Bourgois, 280 p., 20,50 €. Élisabeth Miso
Biographies
Anne-Capucine Blot, Bette Davis fatiguée d’être moi. Sa naissance, un soir d’orage dans le Massachusetts, présageait déjà une existence exempte de tiédeur. Bette Davis (1908-1989), l’inoubliable Margo Channing d’Ève de Joseph L. Mankiewicz (1950), n’a eu de cesse de se battre pour imposer sa volonté et son indépendance. Anne-Capucine Blot retrace le parcours de cette icône de l’âge d’or du cinéma hollywoodien, une des premières actrices à s’ériger contre la toute-puissance des studios. Après le divorce de ses parents, la petite Ruth Elizabeth Davis forme un trio très soudé avec sa mère et sa sœur Barbara. Sa mère sera un soutien précieux pour sa vocation artistique. Adolescente, elle se passionne pour le théâtre, rêve d’un avenir palpitant et décroche une bourse à l’École Robert Milton-John Murray Anderson à New York. Dès ses débuts sur les planches, dans la troupe de George Cukor notamment, elle affiche un caractère bien trempé. Elle débarque à Hollywood en 1930 et comprend qu’elle n’a pas le profil souhaité de la femme glamour et sensuelle. Elle ne se satisfait pas des rôles médiocres qu’on lui propose et va se démener pour jouer des personnages d’une tout autre épaisseur. Elle épuise ses partenaires et ses metteurs en scène, avec ses exigences et ses colères, mais son talent crève l’écran. Son travail acharné lui vaut sa première nomination aux Oscars pour L’Emprise (1934), et la fameuse statuette lui revient pour L’Intruse (1935) et pour L’Insoumise (1938). En 1936, Bette Davis veut renégocier son contrat avec la Warner Bros et se livre, à vingt-huit ans, à un bras de fer avec le coriace Jack Warner, qui ne l’intimide pas le moins du monde. Elle perd son procès, mais gagne en marge de manœuvre. Son théâtre intime est tout aussi volcanique : quatre mariages, trois enfants, des amants, un grand appétit sexuel. Elle traque le bonheur inlassablement, mais ne parvient pas à concilier ses désirs de stabilité domestique et ses ambitions professionnelles. En 1949, après seize ans de bons et loyaux services, la Warner accepte de lui rendre sa liberté. Malgré le succès de Qu’est-il arrivé à Baby Jane ? (1962), son étoile décline au fil du temps. Éd. Capricci, 112 p., 11,50 €. Élisabeth Miso
Florence Noiville, Écrire, quelle drôle d’idée ! Quand la journaliste rencontre pour la première fois Milan Kundera, devenu un ami au fil des entretiens qui les lieront, et qu’elle lui dit qu’elle aimerait faire un livre sur lui, que son métier d’ailleurs, c’est d’écrire, elle craint son froncement de sourcils. Il s’étonne, s’en amuse et dit : Écrire ? Quelle drôle d’idée ! « Combien de fois m’a-t-il dit : « Tout est dans mes livres » ? Ce n’était pas une formule. Sa vie a infusé dans ses pages. Il suffit de se promener dans cette « autre maison » pour le retrouver. Lui, ou des bribes de lui éparpillées dans des héros qui lui ressemblent. » Kundera, né le 1er avril 1929 à Brno en Tchécoslovaquie (Moravie), qui écrivit ses premiers livres en tchèque mais n’utilisa plus que le français à partir de 1993, est l’un des écrivains les plus lus au monde, avec quarante-neuf traductions de ses dix-sept livres : il a 94 ans, refuse d’apparaître publiquement depuis plus de quarante ans. Il vieillit, est malade, on est en décembre 2020, et l’auteure décide de partir avec son mari sur les traces de sa vie, sur les lieux chers à l’écrivain : faire ce qu’elle appelle son pèlerinage kundérien, en Moravie, en Bohême. Alors, elle est venue demander au couple Milan et Véra Kundera – sa femme depuis plus d’un demi-siècle – des adresses, des numéros de téléphone, le trajet de leurs balades, là-bas… Le livre égraine les années phares du couple : leurs déménagements successifs, le départ de la Tchécoslovaquie soviétique pour la France en 1975 et Kundera nommé à l’université de Rennes comme professeur de littérature comparée, la genèse de certains romans ou encore, le carnet de voyage de Florence Noiville. Souvenirs rassemblés, biographie, éléments personnels ou documentés, fragments de romans de l’écrivain, photographies : l’univers de l’œuvre romanesque nous montre par-dessus tout combien, dans « la sagesse de l’incertitude », le romancier apprend au lecteur à appréhender le monde comme question et non comme réponse. Éd. Gallimard, 318 p., 21 €. Corinne Amar
Pauline Dreyfus, Ma vie avec Colette. C’est un texte d’une tendresse pour la femme de lettres moderne, comédienne aussi et danseuse de music-hall, indifférente aux convenances que fut Colette (1873-1954) ; un ton d’une poésie folle et d’une proximité avec son héroïne qui émeut, et rend honneur à la collection qui propose à un écrivain d’écrire sur l’ami secret en compagnie duquel il ou elle a passé toutes ces années et sans qui l’existence aurait été différente. « Colette ? J’aime en elle l’amie des bêtes, la femme libre qui ne sombra jamais dans le militantisme, la créatrice d’une prose fastueuse et poétique. » Pauline Dreyfus nous entraîne ainsi dans le monde de Colette, son attachement pour Saint-Sauveur-en-Puisaye, ce village pittoresque et tranquille en Bourgogne-Franche-Comté, et la maison, fondatrice de son œuvre, que les souvenirs viennent magnifier, car toujours revue avec ses yeux éblouis d’enfant. Au centre du pays originel de Colette, il y eut Sido, la mère, la fée du domaine familial, la mère-chienne trop tendre, qui eut quatre enfants dont Gabrielle – qui choisira de s’appeler Colette. Puis, il y eut la vie amoureuse et mouvementée de Colette ; Willy, d’abord, son premier mari, épousé en 1893, chez qui elle emménagea à Paris, quittant son paradis pour cet appartement impudique, « agencé pour la commodité et la négligence d’un célibataire dissolu ». Elle est affectée par ses infidélités très vite, en même temps qu’il l’initie aux salons littéraires et musicaux, l’amène à l’écriture et aux premières ébauches de Claudine à l’école (1900), exploitant sans vergogne ce qu’il décelait en elle de talent : « – Vous devriez jeter sur le papier des souvenirs de l’école primaire. N’ayez pas peur des détails piquants, je pourrais peut-être en tirer quelque chose… Les fonds sont bas. » Elle aura un second puis un troisième mari, une fille – elle sera une fille aimante, une mère négligente – perdra sa mère adorée, personnage principal de sa vie et de son œuvre… Hommage rendu à une hédoniste, pour qui la vie fut un cadeau et qui, jusqu’à la fin, lui rendit grâce par l’écriture. Éd. Gallimard, 153 p., 17,50 €. Corinne Amar