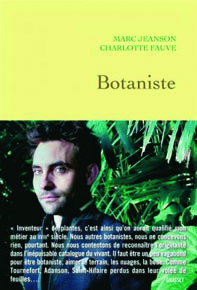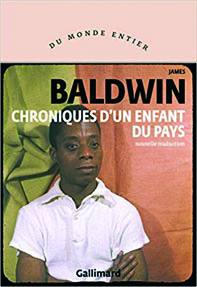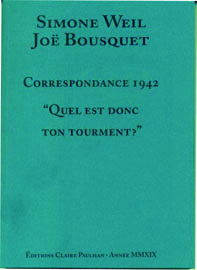RÉCITS
Clémentine Autain, Dites-lui que je l’aime. Il aura fallu trente ans à Clémentine Autain pour sortir du silence, pour se reconnecter à sa mère, la comédienne culte des années 1970-1980 Dominique Laffin, décédée à trente-trois ans en 1985 quand elle avait douze ans. Longtemps, elle a réussi à tenir à distance ses émotions et les admirateurs de la défunte qui lui rappelaient son magnétisme et s’étonnaient de son mutisme à son sujet. Puis ses enfants ont commencé à l’interroger sur cette grand-mère dont on ne leur parlait pas, elle ne pouvait plus se dérober. Elle n’a cessé de vouloir la faire disparaître, d’enfouir un passé chaotique à ses côtés, les souvenirs sombres ayant en apparence recouvert toute trace de joie ou de douceur. « Ce qui abîme, c’est la répétition. Ce qui nous a séparées, c’est la récurrence de ton incapacité à prendre soin de moi. Je n’ai plus trouvé la force de comprendre, j’ai condamné. », écrit la députée France Insoumise de Seine-Saint-Denis dans ce livre émouvant, véritable déclaration d’amour. Dominique Laffin était belle et libre, elle a marqué de sa grâce et de sa modernité des films comme Dites-lui que je l’aime de Claude Miller (1977), La Femme qui pleure de Jacques Doillon (1979) mais était dévorée par ses démons intérieurs, dépendante de l’alcool et des somnifères. La fille fait remonter à la surface des situations d’abandon, d’oubli, de honte, des scènes d’ivresse traumatisantes mais aussi son chagrin d’enfant, la douleur intolérable du manque charnel. « Je me suis rendu compte que tu étais vraiment morte, que je ne te reverrais pas, que nos corps ne se toucheraient plus jamais, que je n’entendrais plus ta voix, quand l’odeur sur ton écharpe s’est évaporée. » Tout en admettant s’être construite en opposition à cette mère défaillante, elle redécouvre au fil des témoignages de cinéastes, d’actrices et de sa mémoire réveillée, un autre visage, celui tant aimé. Clémentine Autain peut enfin accepter sans crainte l’héritage de cette mère tourmentée et lumineuse, drôle, fantasque, talentueuse et féministe engagée. « En réalité, je ne t’ai évidemment jamais vraiment perdue de vue. Je t’ai même toujours retrouvée mais par effraction, jamais de face, je n’en avais ni le courage, ni l’envie. » Éd. Grasset, 162 p., 16 €. Élisabeth Miso
Arthur H, Fugues. Un des rêves tenaces d’Arthur H est de jouer Jean-Sébastien Bach. L’Art de la fugue étant à ses yeux un modèle de beauté, de perfection artistique et spirituelle, de liberté, il s’y est donc attelé. La vie et l’œuvre du compositeur le fascinent et tout particulièrement ses deux traversées à pied de l’Allemagne entrepris à quinze et vingt ans pour sa formation musicale. L’Art de la Fugue, convoque dans son esprit deux autres histoires de fugues, de voyages initiatiques. Celle de sa mère, Nicole Courtois, le jour de ses dix-huit ans, le 27 mars 1958. Cette fille d’un ouvrier métallurgiste et d’une dactylo, ayant en horreur l’horizon plus que rétréci de sa banlieue d’Argenteuil, avait projeté avec un petit groupe d’amis dont son petit ami de construire une embarcation et de partir pour Tahiti. Leur grand rêve d’évasion a pris fin en Corse, mais les quelques semaines passées sur l’île à s’émanciper de conventions sociales aliénantes ont été décisives pour la jeune femme. Son fils, admiratif de son audace, du courage avec lequel elle a bravé l’hostilité des mentalités de l’époque, publie ici certaines des lettres qu’elle a adressées à sa famille. Vingt-quatre ans plus tard, le chanteur et musicien allait être pris du même besoin de fuite comme seule issue à son mal-être et prendrait aussi la plume pour rassurer sa mère. En mars 1982, il est en vacances en Guadeloupe avec son père Jacques Higelin et décide de ne pas rentrer à Paris. Il a quinze ans, s’estime trop renfermé et la perspective de déprimer au lycée lui fait sauter le pas. « J’avais besoin de retrouver une vitalité, une présence solaire à la vie. Quand des idées comme celles-ci apparaissent et allument des désirs inédits, il devient impossible de les sacrifier à la raison. » À travers ces trois récits de fugues entrelacés, de rêves et d’élans vitaux, Arthur H dessine un rafraîchissant autoportrait et rend un délicat hommage à la liberté inspirante de ses parents. « Je les aime et leur suis infiniment reconnaissant : ils m’ont transmis l’idée fondamentale que la liberté est aussi quelque chose qu’on s’accorde à soi-même, on ne demande pas l’autorisation aux autres, on se l’offre. » Éd. Mercure de France, Traits et portraits, 192 p., 19 €. Élisabeth Miso
Marc Jeanson, Charlotte Fauve, Botaniste. C’est un récit autobiographique qui parfois ressemble à un journal, à d’autres moments, à un conte enchanteur à l’endroit du lecteur ou parfois encore, à une encyclopédie de botanique, tant le propos est scientifique, précis, érudit, qui nous emmène très loin dans l’histoire des plantes et de ses inventeurs. L’auteur, responsable de l’herbier du Museum national d’histoire naturelle à Paris, y veille sur les espèces disparues, à l’arrière du Jardin des Plantes où vivent huit millions de plantes séchées. Être botaniste, nous dira ce jeune passionné, c’est aimer le terrain, la boue, les nuages et l’inconnu, c’est penser aussi au monde de demain. L’ancien étudiant en botanique qui fit ses premiers stages à l’herbier du Muséum parisien sait que « l’important, ce sont les tropiques. Là où il y a le plus d’espèces, les dernières forêts primaires, les grandes étendues, les lianes qui grandissent à une vitesse folle », que tout cela ne dure pas, qu’il faut aller sur le terrain. Dans ses voyages au bout du monde, ses missions sous les tropiques, en Malaisie ou en Indonésie, au Vietnam, en Chine, en Thaïlande, en Equateur, à Taïwan ou au Japon, il expérimente un rapport intime au sauvage : « Planter mon hamac avec moustiquaire intégrée à 1,20 mètre du sol pour éviter les pires saloperies de bestioles. Discuter avec mes compagnons. Lire un livre à la bougie. Marcher une heure, rebrousser chemin, dialoguer avec des villageois pour dénicher une fleur. Découvrir une espèce jamais encore décrite, retrouver une plante observée séchée dans l’herbier, rapporter des plantes à Paris, les étudier, les recenser, les numériser, échanger avec d’autres herbiers dans le monde, poursuivre l’inventaire du vivant... » Pour le lecteur, c’est une plongée dans l’intensité d’une aventure humaine, sa magie, en même temps que dans le quotidien d’un métier et de ses exigences. Co-écrit avec la journaliste C. Fauve. Éd. Grasset, 224 p., 18 €. Corinne Amar
ESSAIS
James Baldwin, Chroniques d’un enfant du pays. Nouvelle traduction de l‘anglais (États-Unis), Marie Darrieussecq. « L’histoire du Noir en Amérique est l’histoire de l’Amérique – ou plus précisément, est l’histoire des Américains. » Dans ces essais parus en 1955 et rédigés entre vingt-quatre et trente ans, James Baldwin s’attaque aux mythes, aux préjugés, aux non-dits, aux peurs et aux fantasmes raciaux qui nourrissent la violence et les injustices de son pays. Scrutant la littérature, le cinéma, la presse, la religion, la politique, il décortique une histoire de l’Amérique édifiée sur la question raciale et s’interroge sur ce que signifie être Noir à l’intérieur de ses frontières. Il fustige la perception caricaturale des Blancs, leur aveuglement à envisager la communauté noire comme un problème social et non humain et n’épargne pas plus les Noirs qui se détournent de leur héritage par désir d’intégration. Quiconque se coupe de ses origines et de son histoire passera inévitablement à côté de lui-même. « Notre déshumanisation du Noir est ainsi indissociable de notre déshumanisation de nous-mêmes ; la perte de notre propre identité est le prix que nous payons quand nous anéantissons la sienne. » La puissance du livre tient aux subtiles passerelles jetées entre son implacable analyse des mécanismes et des contradictions de la société américaine et son expérience intime, aux résonances entre trajectoire et lutte personnelles et histoire collective. « (…) il ne faut jamais, dans sa propre vie, accepter les injustices comme une banalité mais il faut les combattre de toute sa force. Or ce combat commence dans le cœur, et sur moi reposait désormais la charge de protéger mon propre cœur de la haine et du désespoir. » Aîné d’une fratrie de neuf enfants, l’écrivain a grandi à Harlem et a très tôt pris conscience des tensions entre Blancs et Noirs, de sa propre terreur et de sa révolte. Il évoque sa relation à son père, un pasteur rigide, amer et paranoïaque, et sa mort survenue pendant les émeutes d’Harlem en 1943 ; relate le voyage à Atlanta de deux de ses frères censés se produire avec leur ensemble vocal lors de la campagne du candidat Wallace en 1948 et leur désillusion face aux mentalités faussement progressistes. Il se remémore les humiliations racistes subies dans le New Jersey et le réel danger que représentait alors sa propre rage, l’oxygène de sa vie en France malgré le manque d’argent et un épisode carcéral à Fresnes. James Baldwin, par sa redoutable acuité, la force de son engagement civique et artistique, sa noblesse d’âme, s’inscrit parmi les figures les plus remarquables de la littérature du XXe siècle. Éd. Gallimard, Du monde entier, 224 p., 20 €. Élisabeth Miso
CORRESPONDANCES
Simone Weil, Joë Bousquet, Correspondance 1942, « Quel est donc ton tourment ? ». Sur le point de partir en exil aux États-Unis pour fuir une persécution, la philosophe Simone Weil (1909-1943), s’est arrêtée à Carcassonne pour rencontrer l’écrivain Joë Bousquet (1897-1950) qu’elle ne connaît pas, quelques heures, au milieu de la nuit. C’est à lui qu’elle vient ouvrir son âme, oser une demande bien précise. Elle a besoin de sa caution pour appuyer, dans son combat contre les nazis, son projet de faire partie d’un corps d’infirmières en première ligne dont elle veut proposer la création aux autorités militaires de la Résistance. Grand invalide de guerre, atteint à la colonne vertébrale par une balle allemande à l’âge de vingt et un ans, cloué à vie dans une chambre plongée dans la pénombre, souffrant, Joë Bousquet écrit. Il participe à la revue Les Cahiers du Sud, édifie peu à peu une œuvre poétique qui le transcende, concentré sur un travail intérieur de transformation d’un destin tragique, subi, en une destinée maîtrisée ; la quête d’un bonheur conquis par une perception autre de la réalité, par l’invention d’un autre monde où la mort est supprimée. Avec lui, Simone Weil aborde ces questions qui la préoccupent, celles de la souffrance, du bien, du mal, de Dieu. Un échange de lettres a lieu entre avril et mai 1942, peu après cette rencontre extraordinaire qui voit naître une amitié immédiate. « Vous rencontrer a été pour moi plus que précieux », écrira Simone Weil dans sa première lettre du 13 avril 1942, (…) j’ai été très touchée de constater que vous aviez fait véritablement attention aux quelques pages que je vous ai montrées. Je n’en conclus pas qu’elles méritent de l’attention. Je regarde cette attention comme un don gratuit et généreux de votre part. » Avec elle, il évoque son expérience de la guerre et cette blessure à partir de laquelle il s’est construit. Il l’interroge sur son expérience intérieure, fasciné qu’il est par les mystiques. Ce sont ainsi sept lettres restituées dans leur intégralité, resituées dans leur contexte, minutieusement annotées par Florence de Lussy et Michel Narcy, et précédées d’une préface conséquente qui invite à revenir nombre de fois sur sa lecture. Éd. Claire Paulhan, mars 2019, 200 p., 27 €. Corinne Amar.