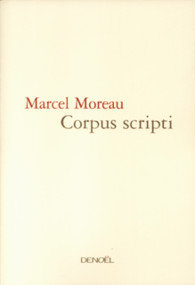Le 4 avril 2020, nous apprenons la disparition de Marcel Moreau, atteint du Covid-19.
Nous quitte un grand écrivain, un homme libre, un colosse, « notre » colosse, nous disait avant-hier Marie-Rose Guarnieri (libraire et fondatrice du Prix Wepler-Fondaion La Poste), affectée, elle aussi, par sa disparition. On a longtemps soulevé, grâce à ses mots viscéraux, des montagnes, dit-elle encore. Nous lui avions remis le Prix Wepler Fondation La Poste en 2002, pour couronner Corpus Scripti, paru à l’époque chez Denoël. Ont suivi notamment deux interviews dont une pour écrire la préface de sa correspondance avec Jean Dubuffet, publiée aux éditions L’Atelier contemporain en 2014 sous le titre, De l’Art Brut aux Beaux-Arts convulsifs (et soutenue par la Fondation La Poste). Pour rendre hommage à Marcel Moreau, dont l’œuvre (une soixantaine de livres) inscrit le corps dans le champ de la pensée, nous vous proposons la lecture d’une lettre adressée à Jean Dubuffet en novembre 1971, date à laquelle ce dernier présentait à la galerie Jeanne Bucher des dessins et sculptures, ou peintures sculptées, dont la plupart ont pour sujet des arbres qui appartiennent au fameux cycle de L’Hourloupe. « Vos forêts sont entrées en moi par les racines », lui écrivait Marcel Moreau.
NATHALIE JUNGERMAN
Lettre (sonore) de Marcel Moreau à Jean Dubuffet
Article de Gaëlle Obiégly sur la Correspondance de Jean Dubuffet et Marcel Moreau
Ci-dessous un entretien avec Marcel Moreau et son discours de réception du Prix Wepler Fondation La Poste 2002.
Entretien avec Marcel Moreau.
Propos recueillis par Nathalie Jungerman
Novembre 2002
Marcel Moreau est né en 1933, à Boussu, village minier du Borinage (Belgique). Fils d'ouvrier, il a notamment gagné sa vie comme aide-comptable au journal Le Peuple à Bruxelles, puis en 1955 entre comme correcteur au journal Le soir. Premières velléités d'écrivain. Premiers « états de possession ». Quintes sera publié en 1963. Il se marie en 1957 et aura deux enfants. En 1968, il s'installe à Paris où il exerce son métier de correcteur (Alpha Encyclopédie, Le Parisien Libéré, en 1971, Le Figaro, jusqu'en 1989). Nombreux voyages en Inde, Iran, Népal, Cameroun, Pérou, Mexique, U.R.S.S., Chine, Etats-Unis, Canada. Naufrage (100 morts) en Adriatique, au retour d'un séjour en Grèce. Rencontres avec Paulhan, Anaïs Nin, Dubuffet. Correspondance importante avec ces deux derniers. Une longue amitié avec Topor (un livre : Le Grouilloucouillou. Texte pour 13 portraits, d'Antonio Saura. Quelques prix littéraires en Belgique, et un au Canada.
....................................
Claude-Louis Combet a dit qu'une voix le dictait, ses manuscrits ne comportent effectivement aucune ratures… Qu'en est-il de votre travail d'écriture ? Comment construisez-vous autour de ces bribes charnelles ? Comment s'organisent vos manuscrits ?
Marcel Moreau : Mes manuscrits s'organisent d'une façon très désordonnée. C'est une voix qui surgit, ce n'est pas une voix qui me dicte. « Corpus Scripti » est un thème qui n'a cessé d'habiter mon écriture : le rapport du corps et de la création. Dans ces bribes, deux ou trois lignes sont à peu près lisibles ! Il y a toujours une courbe qui se forme, d'ailleurs je n'en comprends pas le sens. Ensuite, c'est comme si j'étais dans l'impossibilité de quitter la page, il faut que tout se passe là. Il y a quelque chose de très organique et d'immédiat. Les peintres s'intéressent beaucoup à cette étape de l'écrit. Jean Dubuffet, par exemple, qui aimait beaucoup ce que je faisais, trouvait dans mes manuscrits un rapport avec l'Art Brut. Je ne pense pas que ce soit de l'Art Brut mais en tout cas c'est une écriture de pulsion. Il y a jaillissement. À ce stade de l'écriture, le style, la musicalité, les idées sont déjà là. Je ne connais pas le vertige de la page blanche... Je ne suis pas non plus dans la grâce continuelle d'écrire, je travaille sur des profondeurs, sur des ténèbres, ce n'est donc pas facile de porter tout ça à la lisibilité et à la justesse, c'est un combat. Et mes manuscrits en sont un témoignage. Le problème d'une telle écriture est que la pensée va plus vite que la main, il y a des mots qui manquent à l'intérieur des phrases, des lettres qui manquent à l'intérieur des mots. L'organisation se fait à la machine, sur ma vieille Olivetti où tout est à reconstituer. Le caractère même de la machine m'oblige à freiner ce rythme, cette instance, cette espèce de folie, à avoir du recul, c'est là que j'entends si le style n'est pas bon. C'est là aussi que les phrases amputées se reconstituent.
Votre écriture témoigne d'une mise en difficulté de soi, un processus proche de la folie…
M.M Il y a danger, danger de vertige, de déséquilibre, de désaxation. Parfois je touche le fond car le sens des mots peut être impitoyable. Ce n'est pas un exutoire bien que l'écriture puisse l'être. Le sens des mots peut vous faire tomber très bas. L'écriture vous écrase, vous terrasse et vous relève, c'est une écriture en mouvement. Un imprimeur et éditeur belge a publié un livre sur mes manuscrits. En regard de chaque illustration – des linogravures réalisées par un peintre à partir de mes manuscrits –, j'ai fait un commentaire. Ce peintre a travaillé sur la graphie, a grossi, isolé, déplacé des caractères et finalement ces compositions plastiques ressemblent aux encres de Michaux. Mes commentaires ne sont pas là pour expliquer ma manière d'écrire, c'est impossible, ça échappe à la raison. Après quarante ans d'écriture, c'est toujours un mystère pour moi. Je peux donner quelques pistes : par exemple, l'importance de collision, de télescopage dans les mots, car avec une telle circulation, il y a forcément des accidents, les mots se rencontrent les uns les autres, les sonorités se choquent et peuvent faire naître de nouvelles idées.
Dans Corpus Scripti, vous parlez d’« une écriture d'avant les mots, et même d'avant les idéogrammes »…
M.M Parfois le langage m'apparaît comme une pâte imprécise, primitive, primordiale, une masse sonore. À moi d'en tirer des mots et des idées. Dans ma jeunesse, l'écriture était aussi un acte semblable à celui d'un sculpteur qui travaille, modèle à partir de quelque chose d'informe. J'ai dû commencer par là. À présent, ce n'est plus tout à fait ainsi que se présentent les choses. Je suis assez critique envers cette écriture parce qu'elle n'est pas aussi belle que celle à laquelle j'ai pu arriver aujourd'hui, pas aussi musicale ; il s'agissait plutôt d'une écriture géologique. C'était un monde en formation, en déformation comme un phénomène géologique. C'était ma manière d'entrer dans l'écriture, avec mes instincts, mes pulsions et une force.
Dans votre rencontre avec les mots, vous évoquez des « corps analphabète »...
M.M Je pense que beaucoup de gens vivent avec le silence de leur corps, c'est-à-dire qu'ils ne parlent jamais à leur corps, ils ne l'écoutent pas, ils n'entendent rien. Alors qu'en vérité, il y a beaucoup de sons, de musique et parfois de tintamarre. J'ai donné la parole au corps, j'étais dicté par le corps ou bien c'était moi qui dictais au corps. J'en fais le lieu même de la création littéraire….
Votre premier livre, Quintes, est l'itinéraire d'un personnage mais cette trame romanesque est le prétexte à des digressions et considérations personnelles sur l'écriture et sur l'implication du corps…
M.M Quintes est une aventure physique, sensuelle et charnelle mais surtout très intérieure. C'est mon premier livre et il représente sept années de travail. Je lisais beaucoup avant de commencer à écrire (un livre par jour), j'étais passionné par les mots, j'avais l'amour des mots. Puis, il a fallu absolument que je fasse quelque chose d'autre avec tout l'univers qui était en moi, cet univers qui était un chaos indescriptible, des tensions violentes, des concupiscences extrêmes… Je n'avais pas de mots à ce moment-là pour exprimer tout ce que je ressentais, et j'étais dans un renfermement qui devenait insoutenable. Il fallait que j'écrive, je ne pouvais plus faire autrement, ou alors c'était la folie. J'ai commencé en 1956. Quintes m'a demandé beaucoup de travail et j'ai supprimé beaucoup de livres dans ce livre. C'était vraiment une tentative, je n'étais jamais content de moi-même mais c'était déjà un début de libération… Avec Quintes, je commence à jeter sur le papier tout ce que j'ai gardé en moi. La trame romanesque est en effet un prétexte à des considérations plus intimes. Il faut mettre le mot roman entre guillemets. Je ne suis pas un constructeur de situations romanesques. Je ne travaille pas des personnages qui ont une famille, une histoire, qui se parlent. Ce rapport avec les mots s'est donc imposé tout de suite à moi, avec la lecture puis l'écriture, c'était une rencontre inévitable comme une fatalité. Une rencontre physique.
D'un côté, il y a des récits, et de l'autre, une sorte de ressassement éternel, cette écriture autobiographique. Comment voyez-vous votre propre parcours ?
M.M Je me qualifie de chercheur, plutôt que d'écrivain. Quand j'ai des lecteurs qui me disent le plaisir, le bonheur que je leur apporte en mettant des mots sur des choses qu'ils n'osent ou ne peuvent nommer, je me dis que je leur ai transmis une vérité ou bien je les ai mis en état de comprendre leur propre vérité. Il se passe quelque chose de l'ordre de cette lumière-là. C'est un travail inachevable. Aujourd'hui, après avoir écrit tant de livres, je suis plus vrai avec moi-même que je ne l'ai jamais été. Je suis passé à l'essai avec un livre publié en 1966, Le chant des paroxysmes. C'était la première fois que je m'attaquais aux idées mais tout en évitant la théorie et en en faisant une expérience charnelle. Je ne considère pas cet essai très réussi, je n'étais pas mûr pour écrire des pensées, des réflexions sur le monde. Alors au rythme de ma vie sentimentale, amoureuse, des livres qui sont une littérature où je m'intéresse seulement à l'amour ou à la femme, (sept ou huit publiés aux éditions Lettres Vive) ont accompagné tous ces ouvrages. Une écriture nécessaire qui me fait un bien énorme par rapport à l'écriture de recherche, à l'essai.
Comment s'est établi le lien avec Anaïs Nin, avec qui vous avez eu une correspondance ?
M.M Une anglaise qui me lisait et qui connaissait Anaïs Nin lui a envoyé un jour un de mes livres. Anaïs Nin a réagi immédiatement avec enthousiasme et nous avons commencé une correspondance. Trois des lettres qu'elle m'a envoyées sont d'ailleurs publiées dans son journal. Un jour, j'ai eu très envie d'aller la voir, je la savais malade et il était temps qu'on se rencontre. Je suis donc parti à New York. C'était dans les années soixante-dix. Je l'ai rencontrée à une période où je commençais à douter. Elle trouvait à ma démarche une dimension qu'elle n'avait pas su trouver pour elle-même. Elle vivait une vie de grande fécondité littéraire mais en même temps elle était très sollicitée. Elle avait l'impression de ne pouvoir travailler en profondeur et ça lui donnait mauvaise conscience de me lire car elle prétendait que j'allais plus loin qu'elle dans la connaissance de la nature humaine. Ce qu'elle m'a dit là était très important. Ce qui me troublait, me désespérait aussi, c'était de ne pouvoir évaluer ce que j'écrivais à l'aube de la critique. C'était simplement un questionnement intérieur. Finalement les lettres d'Anaïs Nin étaient un encouragement. Pourtant, à cette époque, j'avais déjà un certain nombre de lecteurs. Bien sûr, je n'étais pas très médiatisé …. Tous les critiques qui m'avaient soutenu à mes débuts, toujours en insistant sur le caractère choquant de mes livres, sont morts les uns après les autres : Claude Bonnefoy qui a écrit des choses admirables, Alain Bosquet…. Il y avait quand même les dictionnaires de littérature qui me faisaient une place.
Et avec Jean Dubuffet ?
M.M C'est aussi un de mes lecteurs qui a envoyé un livre à Dubuffet. Il a été enthousiaste. On s'est rencontrés plusieurs fois... Il voyait quelque chose de très fort en rapport avec ce qu'il faisait lui-même. Chez lui, c'était plus cérébral que viscéral, c'était un rapport au chaos aussi, à l'expression brute, mais quand même assez structuré. J'étais très touché par le regard qu'il portait à mes livres car peu de personnes avaient grâce à ses yeux. Face aux œuvres de Dubuffet, je ne ressentais pas de palpitations comme je peux en ressentir devant certaines œuvres expressionnistes qui ont une conception des corps éclatés. Il m'a fallu un peu de temps pour entrer dans son univers… C'était un grand novateur. J'écrivais un livre par an, chaque fois le lui envoyait, et il m'adressait des lettres exclamatives, m'encourageait, m'emmenait dans son atelier….
Le Prix Wepler-Fondation La Poste 2002 vous a été décerné pour Corpus Scripti, publié aux éditions Denoël. Qu'est ce que vous apporte ce Prix ?
M.M Ce Prix m'a apporté quelque chose d'absolument inattendu. Je me disais que c'était fini, trop tard pour moi en France ; j'ai eu plusieurs prix en Belgique, et un au Canada… J'ai eu beaucoup de plaisir à recevoir le Prix Wepler-Fondation La Poste à cause de sa singularité : il récompense des œuvres que les prix traditionnels se sont fait une spécialité de laisser dans l'ombre. Je redoutais un peu la soirée à la brasserie Wepler et j'ai été agréablement étonné.
Vous avez beaucoup voyagé, en Inde, au Népal, en Iran, au Mexique, en Chine … Vous avez même été victime d'un naufrage dans l'Adriatique, en 1971. Quels retentissements ces voyages ont eu sur l'écriture ?
M.M Lors de ce naufrage dans l'Adriatique, le bateau était en flammes, des passagers autour de moi étaient morts. J'ai pensé à la littérature, notamment à un de mes livres, La Terre infestée d'hommes, un livre dévastateur, destructeur, un livre avec la folie et la mort qui correspondait à ce que j'étais en train de vivre. J'avais là un sentiment d'acceptation de la mort… mais j'en étais à mon sixième livre, je me suis dis que j'en avais au moins un de plus à écrire et j'ai lutté, encouragé par cette pensée. J'ai finalement été sauvé au bout de deux heures et demi. Maintenant il y a 35 livres de plus ! Les voyages étaient pour moi un besoin de casser la sédentarité, d'entendre d'autres langues, de voir d'autres visages, de sentir d'autres odeurs. Ces voyages très physiques, infatigables, où le corps était en mouvement, ont dû en effet avoir des retentissements sur l'écriture. Je n'ai plus à présent d'impulsion de ce genre. Il y a toujours ce voyage intérieur, cette descente au fond de soi.
Discours de Marcel Moreau.
Prix Wepler-Fondation La Poste 2002 pour Corpus Scripti
Le 25 novembre 2002
Pardonnez-moi, je n’ai pas d’éloquence naturelle, surtout dans l’émotion.
D’habitude, dans l’émotion, mon cœur se débrouille avec son petit vocabulaire d’analphabète. En ce moment, je lui envoie du renfort. Je l’associe à tous mes organes. Ils l’ont bien mérité, entre autres les sans-grade. Voilà quarante ans, quarante livres que je leur donne la parole, ou qu’ils la prennent. Je suis entré en écriture par un putsch viscéral de cet ordre, ou de ce désordre, à en ébranler ma raison. Ma raison en fut ébranlée, mais pas mon amour des mots. Que ces voix éraillées des tréfonds aient pu ici et là, faire œuvre polyphonique, je n’en reviens toujours pas.
Je n’avais jamais reçu de récompense en France. Pour Quintes, mon premier livre, dont le succès eut pour détonateur Alain Jouffroy et pour parrainage Jean Paulhan et Simone de Beauvoir, on m’attribua le Prix des Enfants terribles, fondé par Jean Cocteau. Mais il me fut retiré aussitôt. On s’était aperçu que j’avais un an de trop selon les statuts. C’est dire si le vote qui s’est porté aujourd’hui sur mon nom me touche. Car j’ai atteint l’âge de penser qu’étant donné ce que j’écris, par les temps qui courent, s’il faut du courage pour me lire, il en faut davantage pour m’élire.
J’ai ce soir, envers celles et ceux qui viennent de distinguer Corpus Scripti, ce que j’appellerai « la reconnaissance du ventre ». Qu’on ne s’y trompe pas. Cela n’a rien de vulgaire, ni de profane. Le ventre est un mot et une réalité que ma passion d’écrire a su charger d’un sens si vertigineux que lorsqu’il est reconnaissant, comme maintenant, c’est aussi beau qu’un jouir.
Je crois avoir fait souvent l’impossible pour ramener la puissance du langage dans les abîmes du corps. L’affaiblissement du Verbe, sa frivolité, sa cristallisation en slogans, en facteurs de conditionnement, son usage à des fins purement mercantiles, voilà, à mes yeux l’ennemi, voilà la névrose. Et la névrose commence déjà là où l’homme manque du pouvoir ou de l’audace de mettre des mots vrais sur les affolements de son identité.
Je vous remercie, Mesdames, Messieurs, d’avoir prêté attention de cette manière à mes démons et à leurs tentatives. Grâce à vous on saura peut-être un peu mieux qu’ils n’avaient pas que le mauvais en eux, et en littérature.
C’est très sentimental, ce que je dis là.
Marcel Moreau