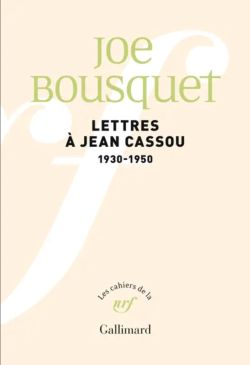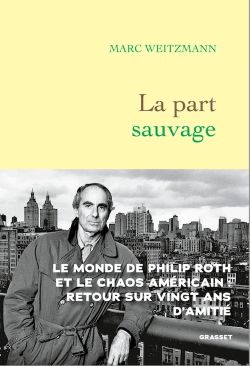Romans
Belinda Cannone, Venir d’une mer. « Longtemps la mer a été partout autour de moi, bordant la ville, baignant mon enfance, tissée aux jours, naturelle, disponible, familière. » Pour la collection « Ma nuit au musée », Belinda Cannone a choisi d’arpenter le Mucem, ce magnifique cube de verre à la résille de béton si délicate, posé face à la mer à Marseille. En empruntant, cette nuit d’octobre 2023, la passerelle qui relie le J4 de Rudy Ricciotti au Fort Saint-Jean, elle a l’impression de saisir intimement le geste de l’architecte. Ce musée tant aimé l’a reconnectée à la cité phocéenne où elle a grandi et qu’elle a quittée à dix-huit ans, après un chagrin d’amour. Née en Tunisie, sicilienne du côté de son père, corse du côté de sa mère, sans certitude d’appartenance à un lieu précis, elle se définit plutôt comme une migrante et sonde ici ses origines, l’histoire des migrations méditerranéennes de sa famille au cours du XXe siècle. La structure dedans-dehors du Mucem entre en résonance avec le motif mémoire-identité au centre de son livre. « J’expose ce qui du Temps et de la mémoire (celle de la Méditerranée, celle de ma lignée, celle de mon existence) habite les méandres de mon identité. » Pour ce projet littéraire, la romancière et essayiste a lu l’Odyssée dans la traduction de Philippe Jaccottet et convoque aussi bien Gaston Bachelard, Paul Ricœur que les films Kaos des frères Taviani ou America America. Le film d’Elia Kazan, vu à vingt ans, a agi comme un révélateur. « Par l’émotion violente que suscite en moi le film, j’apprends que ces rêves d’émigrants me concernent et que ma sensibilité le savait avant ma conscience. » Dans cette exploration intime, surgissent les figures de sa mère et de sa grand-mère maternelle. Elle a déjà écrit sur son père, qui lui a transmis l’amour de la langue française et l’exigence d’une pensée claire. Sa mère, atteinte d’Alzheimer, n’a toujours été que silence, absorbée dans une mélancolie qui avait pour source la perte de sa mère, enfant. De ses racines méditerranéennes, Belinda Cannone tisse une réflexion sur la manière dont le passé se dévoile à nous et nous façonne, et nous rappelle combien la fiction nous aide à identifier nos propres émotions et à décrypter le monde. Éd. Stock, 208 p., 19,50 €. Élisabeth Miso
Correspondances
Joë Bousquet, Lettres à Jean Cassou 1930-1950. Édition établie par Dominique Bara et Hubert Chiffoleau, Avant-propos de Hubert Chiffoleau. Préface de Jean Cassou. Publié après la mort de Joë Bousquet, le recueil Lettres à Jean Cassou donne à voir – avec une éclairante préface de Cassou – la relation de vingt années qui lia Joë Bousquet (1897-1950), poète et écrivain paralysé à vie après une blessure de guerre et figure de l’immobilité radicale, et Jean Cassou (1897-1946), écrivain aussi, homme d’action et d’engagement public, résistant, critique d’art, futur conservateur en chef du Musée d’Art moderne. C’est surtout les 107 lettres du premier qui nous sont révélées ; celles, intégrales, de Jean Cassou, dispersées, n’ont pas été retrouvées. « Carcassonne, 28 mai 1930, Cher Monsieur, Votre lettre m’a donné une grande envie de vous connaître. Vous savez ou vous ne savez pas que, démoli, il y a douze ans par une balle, je ne sors guère de ma chambre que l’été pour errer en voiture. » Cloué à son infortune, Joë Bousquet ne pouvait aller vers le monde ? Qu’à cela ne tienne, rappelle l’avant-propos : il fit venir le monde à lui ! Au cœur des profondes secousses historiques : l’entre-deux-guerres, la montée des totalitarismes, la Seconde Guerre mondiale et l’après-guerre. Jean Cassou n’est pas seulement un confident, il est présenté comme l’un des amis les plus fidèles et attentifs du poète, agissant pour les réflexions, les projets littéraires et les recherches éditoriales de Bousquet. « Tu vois quelle montagne je veux soulever », on est en 1945 et le poète fait part de ses projets, note ses rêves. Le lecteur découvre une pensée, une « communion des ténèbres », qui fait de la blessure une source de connaissance, de la poésie une forme de salut, une manière d’habiter le monde – même lorsque le monde semble s’être retiré du corps. Les lettres révèlent une écriture fragmentaire, habitée d’aphorismes, « de magie et de générosité » selon Jean Cassou, où la souffrance se convertit en une lucidité extrême. Bousquet ne cherche pas à se plaindre ; il élabore une esthétique de la catastrophe intime, où la nuit devient source de vision. Une réflexion aiguë sur les formes possibles de la liberté. Éd. Gallimard, Les Cahiers de la NRF, 402 p., 25 €. Corinne Amar
Essais
Martin Page, Douceur de la musculation. Comme bien d’autres personnes comme lui qui ne répondent pas aux normes, « queers, neuroatypiques ou inadaptées », Martin Page garde un très mauvais souvenir des séances de sport au collège et au lycée. Il n’a jamais pu adhérer à cette conception du sport viriliste et élitiste, basée sur la compétition et la domination. À l’approche de la cinquantaine, alors qu’il se débattait avec nombre d’angoisses, dont celle de sa précarité d’écrivain, il s’est tourné vers le sport. « Par désespoir tout autant que par désir d’espoir, parce que je ne voyais rien d’autre à faire et qu’il fallait m’en sortir, je me suis mis à courir, comme on s’enfuit, comme on tente d’échapper à un abîme qui avance. » Puis il a commencé à pratiquer la musculation et à en percevoir très vite les bénéfices sur son psychisme, son travail et sur ses interactions sociales. Son corps transformé est devenu un rempart contre la violence du monde. « Dans les mouvements lents et précis de la musculation, il y a une chorégraphie, c’est-à-dire une création à partir de mon corps et de mon esprit pour converser avec le monde, et ne plus simplement être articulé par lui. » La musculation est politique parce qu’elle renforce l’estime de soi, l’autonomie, la liberté et peut donc aider à trouver une place en ce monde. La musculation est démocratique, car accessible à tous, dans une salle de sport ou même sans aucun équipement particulier, juste en utilisant les ressources de son propre corps et la gravité. Martin Page déconstruit les préjugés sur la musculation, sur les normes physiques ou de genre, laissant entrevoir qu’il se joue bien autre chose dans la métamorphose physique qu’une vaine quête narcissique dénuée de pensée. « Quand la société passe son temps à nous blesser et à nous épuiser, le développement de notre force physique est une nécessité tout autant que les luttes collectives. » Ce livre de résistance, dédié à tous ceux « qui vivent dans l’intranquillité », nous invite à prendre soin de nous et de nos proches, afin de reprendre le pouvoir sur nos existences dans une société oppressante et normative. Éd. Le nouvel Attila, 176 p., 13 €. Élisabeth Miso
Fabrice Gabriel, Au cinéma Central. Lauréat du Prix Médicis essai, Fabrice Gabriel dessine un autoportrait à travers le prisme de sa passion pour le cinéma. Son éducation au monde s’est faite à travers la littérature mais de manière peut-être plus prégnante à travers le cinéma, « couture » fascinante entre l’imaginaire et le monde réel pour qui pense que rêver sa vie est tout aussi essentiel que de l’habiter réellement. Dès les premiers westerns vus à la télévision, enfant, pelotonné contre sa mère, le cinéma ne cesserait d’être un repère constant. Dans sa petite ville de Lorraine, frontalière de l’Allemagne, le cinéma le Central, dans les années soixante-dix et quatre-vingt, était ce lieu magique où se plonger dans l’obscurité, avide d’un peu plus de lumière. « Comme tant d’adolescents, j’étais persuadé que la vie se composait de secrets et qu’il faudrait, pour les élucider, voir et revoir beaucoup de films, y chercher des pistes, un chiffre, une clé. » Il est un refuge contre l’inquiétude existentielle, le lieu de tous les possibles, la promesse d’horizons nouveaux. « Il fallait étudier et partir, vite, veiller surtout à ne pas rester cette espèce de bon garçon dont on finit par se lasser, à force de changer si peu. » Partout où ses pas l’ont porté, de New York où il a été attaché culturel à Berlin où il a dirigé l’Institut français, des films l’ont accompagné. L’écrivain et critique littéraire déplie ainsi une liste de films qui l’ont marqué, d’acteurs auxquels il s’est identifié, d’actrices qui ont fait naître en lui du désir. Les noms de Samuel Fuller, Fassbinder, Wenders, Antonioni, Tarkovski, Jean-Pierre Léaud, Nastassja Kinski ou Geneviève Bujold ponctuent ainsi ce récit d’apprentissage de la vie. Dans cette histoire d’une existence reflétée, projetée par le cinéma, Fabrice Gabriel glisse le fantôme de son grand-père, un personnage mystérieux, qui incarne à lui seul cette ligne floue entre fiction et réalité. Éd. Mercure de France, 160 p., 18,80 €. Élisabeth Miso
Biographies
Marc Weitzmann, La part sauvage. C’est une forme d’essai qui tient à la fois de la biographie intellectuelle et du récit personnel et politique, où l’auteur construit une analyse qui dépasse la seule figure de l’écrivain américain Philip Roth (1933-2018) et de leurs vingt années de relation. « À quel point nous avons peu parlé de ses livres, je ne le réalise que maintenant. Il y a un dîner, un seul, un dîner de trois heures chez lui, lors de ce second voyage, il me laisse lui poser toutes les questions que j’ai en tête et l’enregistrement de cette discussion constituera le fond d’archives des articles et interviews que je pourrai écrire par la suite à son sujet. » Lorsque l’auteur rencontre Philip Roth chez lui à New-York pour une interview de journaliste en 1999, il ignore encore que leur relation ne fait que commencer. Marc Weitzmann admire Roth comme un maître absolu, une figure centrale de la littérature et de la liberté d’écrire. Il est fasciné de saisir à quel point les thèmes de ses romans — la tension entre désir et puritanisme, la question juive, la paranoïa sociale, la sexualité, l’angoisse morale, l’âge — résonnent avec sa propre vie ou avec l’époque contemporaine. Roth lui donne à lire ses manuscrits. Il établit des parallèles entre la fiction de Roth et le réel, observe comment la littérature éclaire les comportements, les désirs ou les ambivalences humaines. Conversations, correspondances, visites, dîners, événements littéraires, multiples voyages pour rendre visite à Roth, changement de vie – Weitzmann s’installe à New-York, happé par cette relation. Le livre tisse en permanence trois fils : son expérience personnelle avec Roth et sa propre vie d’écrivain journaliste ; l’analyse littéraire des romans et thèmes de Roth ; la réflexion sur le monde contemporain vue à travers le prisme de l’oeuvre, de l’amitié et de ses contradictions. Ou comment, cette part sauvage, en chacun, cette zone grise de chaos et de pulsion, de vie et de mort, affleure dans la création littéraire. Éd. Grasset, 375 p., 24 €.. Corinne Amar