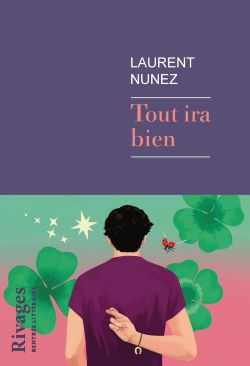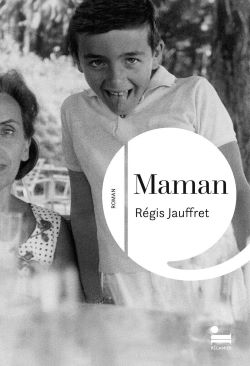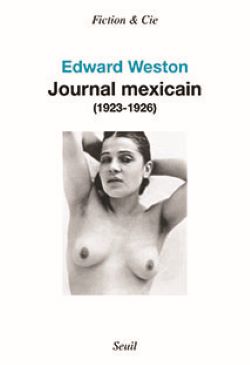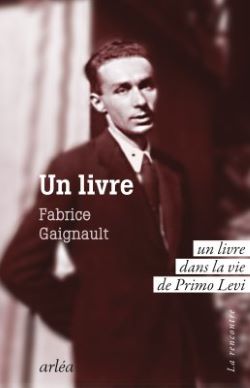Romans
Kaouther Adimi, La Joie ennemie. En 2018, Kaouther Adimi avait déjà caressé le projet d’écrire sur la peintre Baya pour la collection « Ma nuit au musée », mais rattrapée par des fantômes de son passé, elle avait dû renoncer. En 2022, le temps d’une nuit, elle parcourt seule l’exposition consacrée à l’artiste algérienne à l’Institut du monde arabe. Elle pense alors renouer avec son idée de portrait initiale mais comprend très vite que quelque chose de plus profond et de plus éprouvant est à l’oeuvre. En ouvrant les « boîtes scellées et cachées au fond d’un puits de noirceur », l’écrivaine entremêle sa propre histoire avec le destin de Baya, orpheline et artiste autodidacte, révélée en 1947 par Aimé Maeght. Kaouther Adimi a huit ans en 1994, quand son père décide de rentrer en Algérie. En quittant Grenoble, la petite fille ne se doute pas de ce qui l’attend. Depuis l’assassinat du président Mohamed Boudiaf, le pays s’enfonce dans la tragédie, livré à la violence du GIA (Groupe islamique armé). Dès le lendemain de son arrivée, en route vers le village des grands-parents, la famille rencontre un faux barrage. À partir de ce souvenir traumatisant, fragmentaire, longtemps maintenu à distance, l’autrice déploie une enquête familiale et lève enfin le silence sur cette décennie noire, sur ce cauchemar collectif. « Interroger, insister, ramener à la lumière des bribes éparses, des histoires enfouies sous des couches d’oubli. Extraire patiemment ce qui résiste, ce qui se dérobe, démêler le vrai du flou, tenter de reconstituer ce qui a été. »
Elle raconte l’angoisse permanente, les attentats, le refuge dans la littérature et la langue française, son identité nourrie des deux cultures et l’immensité de son amour pour l’Algérie. Au sortir de la guerre civile, elle découvre au musée des Beaux-Arts d’Alger les toiles de Baya. C’est un véritable éblouissement. « Devant le bleu et le rose, devant la myriade de couleurs qui me sautent aux yeux, au coeur, à l’âme. Après toutes ces années de grisaille, de peur et de silence imposés par la guerre, les couleurs sont là, vives et vibrantes. » La joie ennemie est le récit de ce passage intime de l’obscurité à la lumière, du silence à l’écriture. Éd. Stock, 256 p., 19,90 €. Élisabeth Miso
Laurent Nunez, Tout ira bien. Laurent Nunez a « eu une enfance unique et bizarre, merveilleuse, incroyablement remplie de bric et de broc : c’est-à-dire de rites, de croyances, d’amulettes, de gris-gris, de formules magiques. » Il nous invite à le suivre dans l’univers attachant, déconcertant et excentrique de sa famille si singulière. L’auteur a grandi entouré d’adultes terrifiés par la vie, qui s’échangeaient « leurs trucs et astuces pour entendre le destin, et pour se faire entendre de lui. » Chacun de leurs gestes, obéissait à une multitude de règles étonnantes. Chaque situation du quotidien trouvait toujours sa solution particulière. Pour éloigner le mauvais oeil, on pouvait compter sur le pouvoir de protection d’un vêtement rouge ou d’une main de Fatma. Faire un noeud à un torchon (le Koutoufatou) ou placer des ciseaux ouverts sur un grand bol d’eau faisait réapparaître un objet égaré. Pour attirer la prospérité, on abritait sous son toit une plante verte magique et on n’oubliait jamais de manger un plat de lentilles le premier jour du mois. Laurent Nunez évoque avec tendresse et humour la drôle d’enfance qui a été la sienne au contact de personnages hauts en couleur, comme sa tante Maruja qui décryptait les rêves de tous ses proches, ou l’oncle Pampi, infatigable traqueur de reliques sacrées. Entre le Maroc, l'Espagne et la France, il retrace l’histoire d’une famille marquée par l’exil. « Ainsi vivaient-ils dans une crainte transmise de génération en génération, dont ils furent à la fois le relais et les victimes. Une crainte sourde, asphyxiante, immense, et immensément vaine, dont j’ai mis longtemps à me débarrasser. » De ce flot de superstitions familiales, le romancier extrait une lucide réflexion sur notre quête de sens face à l’incertitude de l’existence. Éd. Rivages, 256 p., 21,00 €. Élisabeth Miso
Régis Jauffret, Maman. Au matin du 3 janvier 2020, l’auteur apprend la mort de celle qui fut sa mère, via un appel de la maison de retraite marseillaise où elle était pensionnaire depuis quatre ans. Dans un récit autobiographique qui mêle l’intime et la fiction, Régis Jauffret explore le deuil et l’absence. Cette mère qui lui manque, l’écrivain qui écrivait pour la séduire veut la faire revenir : ce trou saignant que personne ne pourrait combler après sa mort, cette Absente dont il a plein le cerveau, il veut la convoquer par l’écriture. « J’ai besoin d’être écouté. Je voudrais m’étendre à l’infini, sur ces moments. J’avais besoin d’elle, de ses paroles consolantes. Je regrette son départ tout autant qu’il me soulage. » « Je t’aime ma crapule, ma mère, mon béguin ». Elle s’appelait Madeleine, il l’appelle Mado, Magdalena, Madona ou « Petite Madelon chérie », dans une effervescence de mots et de scènes, où elle n’apparaît pas comme une mère comme les autres, elle qui voulut être une mère immense, « une Marie Curie, une Teresa ». Si fière de son fils écrivain. Et lorsqu’il retrouve l’appartement maternel à Marseille, ses portraits y sont en première place : « Partout, pendues au mur, de grandes photos de moi. Une sorte de culte de la personnalité ». Mais c’est une mère trompeuse, enjôleuse, charmante et d’autant plus mystérieuse qu’il découvre, grâce à un document glissé dans les archives maternelles, les preuves d’une trahison. Tel un enquêteur, il ouvre tous les tiroirs, décortique l'amour et la culpabilité et la folie tapie au coeur du lien. C’est un dialogue posthume qui joue avec la mémoire, un monologue enfiévré qui creuse le souvenir à vif, en un face-à-face que, peut-être, l’écriture seule permet de faire revivre. Et le lecteur lui-même devient le spectateur d’une relation mère-fils, d’une quête d’identité et de pardon. Éd Récamier, 256 p., 21,90 €. . Corinne Amar
Journaux
Edward Weston, Journal mexicain (1923-1926). Traduction de l’américain et préface de Gilles Mora. « Ô Mexique, comme tu sais profondément toucher les cœurs, de façon poignante. » Edward Weston pose le pied sur le sol mexicain en août 1923. Tina Modotti l’a poussé à ce changement de vie, persuadée de trouver dans ce pays en pleine effervescence postrévolutionnaire une stimulation nouvelle. Ils voient les choses ainsi : elle l’aidera à faire fonctionner son studio photo et il lui enseignera les secrets de sa pratique. Le photographe a laissé en Californie sa femme et trois de ses fils (l’aîné Chandler l’accompagne). Coupé de ses repères familiaux et culturels, libéré des conventions entravantes, il prend conscience de ce vers quoi il veut vraiment tendre, tant sur le plan personnel que créatif. Ces quatre années vont être décisives, il se détourne du style pictorialiste pour creuser le sillon d’une esthétique moderniste, radicalement ancrée dans le réalisme et la simplicité formelle. « La spécificité de la photographie doit, me semble-t-il, s’accomplir dans l’exploration d’autres voies : utiliser en particulier l’appareil pour enregistrer la vie, témoigner de la substance, de l’essence de la chose même, acier poli ou chair palpitante. » Dès sa première exposition, il suscite un vif intérêt. Avec Tina, il se lie avec les intellectuels et les artistes les plus captivants du Mexique des années 20, Diego Rivera, José Clemente Orozco, Jean Charlot ou Carlos Mérida. Dans son journal, Edward Weston consigne tout ce qui l’inspire : les nuages qu’il n’a de cesse de contempler, les rencontres, les corridas, la lumière, les couleurs, l’artisanat indien, les visages et les corps que son appareil capture. Il laisse aussi filtrer les difficultés financières, la frustration des heures occupées à réaliser des portraits pour gagner sa vie, le manque de ses enfants, le désir qui s’émousse entre lui et Tina. Ce Journal mexicain révèle aussi son exigence artistique, ses questionnements, la puissance de son regard à rendre visible « la beauté au sein de la banalité. » La Maison Européenne de la Photographie rendra hommage à cette figure incontournable de l’histoire de la photographie du 15 octobre 2025 au 26 janvier 2026. Éd. Seuil, 304 p., 21,00 €. Élisabeth Miso
Essais biographiques
Fabrice Gaignault, Un livre. Le 11 janvier 1945, Primo Levi attrape la scarlatine et il est envoyé en quarantaine à l’infirmerie du bloc 20 dans la section des maladies contagieuses. L’auteur évoque, dans un texte très intense et court, une scène capitale inspirée d’un extrait de Si c’est un homme de Primo Levi. Déporté à Auschwitz-Monowitz, malade, épuisé, isolé à l’infirmerie où, généralement on finit voué à l’exécution, Primo Levi trouve un instant de répit dans un geste qui va le sauver : la lecture d’un roman français. « Le roman de Roger Vercel était à part, pour les qualités littéraires et morales que Levi avait relevées – le courage, l’abnégation, le sacrifice de soi. Levi le lisait lorsqu’il s’attendait à mourir. Lorsqu’il mourait. » Il a du mal à lire, doit déchiffrer cette langue qui n’est pas la sienne, s’accroche au mot. Primo Levi a beaucoup lu dans sa vie, des classiques italiens aux français ; la lecture vient tout à coup lui restituer une partie de lui-même. Avec Vercel, il voyage, il n’a pas peur, il gagne du temps. En mêlant des paragraphes sur la vie de Primo Levi et sur son propre rapport à la lecture, Gaignault se rend compte que lui aussi a voulu communiquer sa passion des livres, transmettre à ses enfants. Ce fragment d’humanité, cet espoir si ténu, arraché à l’enfer concentrationnaire, devient le fil directeur de la réflexion de Fabrice Gaignault sur le rôle vital que le livre peut jouer dans des conditions de vie extrêmes. Il en tire une méditation intime sur la puissance de la littérature comme résistance – un livre peut nous sauver la vie –, le pouvoir des textes qui comptent, un livre en convoquant un autre ; Remorques de Roger Vercel ouvrant à son tour sur d’autres résonances : Charlotte Delbo, Conrad, Baudelaire… La couverture du roman nous est montrée, image sacrée, elle est décrite avec précision par Gaignault qui a le souci du détail, qui, par fragments, par extensions, raconte cette lutte pour la lumière dans les ténèbres. Éd. Arléa, coll. La rencontre, 86 p., 13 €. Corinne Amar