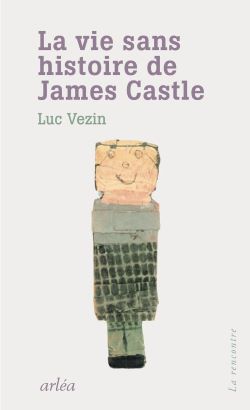MÉMOIRES
Gabriel Byrne, Mes fantômes et moi. Traduction de l’anglais (Irlande) Diane Meur. Gabriel Byrne, le magnétique comédien d’Usual Suspects (1995), de Miller’s Crossing (1990) ou de la version américaine de la série En Thérapie, a toujours gardé « ancré au fond de (s)on âme » le souvenir réconfortant de cette colline des faubourgs de Dublin où il se réfugiait enfant. Il venait y lire, rêver, contempler les champs et la rivière alentour, se délecter de plaisirs simples. Sa mère lui a transmis son goût pour la poésie et le théâtre, sa grand-mère celui pour le cinéma. Issu d’un milieu ouvrier, il n’imaginait pas devenir acteur. Maladivement timide, la notoriété lui a souvent été inconfortable. « Je suis introverti de nature. Pendant longtemps, j’en ai eu honte. Comme si c’était une sorte de défaillance morale. Je ne me sentais jamais à ma place nulle part. J’étais toujours à essayer d’être le plus vrai possible. À rechercher l’authenticité. Mais j’étais paralysé par mon masque et par celui des autres. » Dans ses Mémoires, point de strass ou de paillettes. L’artiste irlandais ne s’attarde pas sur sa réussite professionnelle. S’il évoque ses débuts sur scène ou certaines anecdotes de tournage, c’est pour mieux souligner ses doutes, le sentiment d’imposture qui l’a longtemps poursuivi ou des épisodes d’angoisse tenace, tel celui lié au succès d’Usual Suspects à Cannes. L’essentiel de son récit gravite autour de son enfance et de sa jeunesse, met en lumière les paysages irlandais, les lieux, les êtres, les émotions qui l’ont façonné. Dans son décor intime, se détachent les visages de sa mère et de son père, des commerçants de son quartier, du vieux fermier qui refusait de quitter sa propriété, de son ami Jimmy mort noyé ou encore du plombier violoniste dépressif. Il se souvient de la dureté de l’enseignement religieux. De son attirance à onze ans pour la prêtrise, d’abus sexuels subis au séminaire, et de la joie immense qu’il a éprouvée d’échapper, à quinze ans, à ce morne destin. Il a enchaîné les petits boulots, a été le premier de sa famille à entrer à l’université. Il s’est lancé dans le théâtre, a décroché un rôle dans un feuilleton télé très populaire, puis a fait ses premiers pas au cinéma dans Excalibur (1981). « Ne craignez pas l’avenir, et ne pleurez pas le passé », Gabriel Byrne, qui a fait sien ce vers de Percy Bysshe Shelley, se livre ici avec une bonne dose d’autodérision, une extrême lucidité et un talent littéraire certain. Il dévoile sa face la plus lumineuse comme la plus sombre, ne dissimulant rien de ses failles, de son addiction passée à l’alcool, de ses accès dépressifs ou de la schizophrénie qui a emporté sa sœur tant aimée. Éd. Sabine Wespieser, 296 p., 22 €. Élisabeth Miso
ROMANS
Luc Vezin, La vie sans histoire de James Castle. L’historien d’art Luc Vezin a découvert les œuvres de James Castle en 2009, dans une galerie new-yorkaise. Dans ce premier roman, il retrace le parcours si singulier de cet artiste d’art brut, considéré comme une figure majeure de l’art du XXe siècle et se penche sur les mystères de la création. Né en 1899 et mort en 1977, James Castle n’a jamais quitté l’Idaho. Sourd et illettré, il a grandi au sein d’une famille de fermiers, descendants de pionniers irlandais, sur un territoire autrefois occupé par les Indiens Nez-Percés, Bannocks et Shoshones, avant l’arrivée des trappeurs et des chercheurs d’or au début du XIXe siècle. Son apparence, son comportement, ses cris ou sa manière étrange de communiquer, l’isolaient des autres. Exceptées les cinq années qu’il a passé dans l’école Gooding pour sourds et aveugles à Boise, il est toujours resté sous la protection des siens. Ces derniers n’ont jamais contrarié son obsession créative. Il a ainsi passé son existence enfermé dans la glacière de la ferme parentale ou le grenier d’un poulailler transformés en ateliers, tout entier concentré sur son art. Il dessinait frénétiquement, accumulant et cachant régulièrement ses réalisations dans les murs ou sous les toits. Il récupérait dans le magasin-bureau de poste de ses parents tous les supports imaginables pour ses dessins, ses collages et ses pantins de carton : enveloppes, boîtes d’allumettes, journaux, magazines, catalogues de vente par correspondance, cartons d’emballage... Il confectionnait son encre en mélangeant la suie du grand poêle à sa salive. Il a représenté inlassablement l’Amérique rurale de Garden Valley, les paysages, les granges, les personnages de la vallée de son enfance. « Il dessinait avec le sérieux d’un enfant qui joue, même si ses dessins n’étaient pas pour lui des jeux et qu’il n’était pas un enfant, pas plus qu’un adulte, d’ailleurs. » Longtemps restée méconnue, son œuvre est sortie de l’anonymat dans les années 1960, grâce à l’intérêt que lui portait l’un de ses neveux et s’expose aujourd’hui dans les plus grands musées et galeries américaines. Éd. Arléa, 224 p., 19 €. Élisabeth Miso
RÉCITS
Xavier Le Clerc, Un homme sans titre. « Mon père illettré fut mon premier livre. Il regorgeait de mots et de sentiments captifs, qui ne s’échappaient que par bribes. Difficile de soudoyer le geôlier de sa mémoire, mon père avait du mal à me parler des affres de la faim qu’il comparait à un sommeil. » La faim, Mohand-Saïd Aït-Taleb, le père de l’auteur, l’a endurée pendant de nombreuses années. Dans Misère de la Kabylie, une série d’articles publiés en juin 1939 dans l’Alger républicain, Albert Camus rendait compte de l’extrême pauvreté et de la famine qui sévissaient dans les villages de montagne de la Kabylie, de l’insoutenable spectacle des enfants décharnés en haillons. Un texte percutant pour Xavier Le Clerc, qui y a reconnu l’histoire de son père, né en 1937 « dans un village d’affamés, avec la Seconde Guerre mondiale qui s’éterniserait jusqu’à ses huit ans, suivie des affres de la guerre d’Algérie qui durerait jusqu’à ses vingt-cinq ans. La faim et la guerre avaient pilonné toute chance pour lui d’aller à l’école ou de découvrir un jour l’insouciance, et il ne pouvait léguer à ses enfants qu’une grammaire du manque. » Une existence de labeur et de silence, que le fils raconte ici, pour rendre justice au courage et à la dignité de ce père et de tous ces êtres invisibles exploités qui ont « reçu l’indifférence que l’on réserve aux cailloux, pas même l’écoute que l’on prête aux grincements de graviers.» Dès l’âge de neuf ans, Mohand-Saïd rejoint la cohorte des hommes qui parcourent le pays à pied en quête de travaux agricoles. Il s’embarque pour la France en 1962, atterrit à Caen, passe cinq ans sur des chantiers de construction, puis entre à la Société métallurgique de Normandie en 1968. En 1992, sa mise en préretraite, ultime humiliation, le plonge dans une profonde dépression. L’auteur se remémore les colères de son père, irriguées par son angoisse de nourrir sa famille et par les fantômes de la guerre d’Algérie. Sa mère, tout entière dévouée à son foyer et à ses neuf enfants. Il sonde aussi la place qui lui était dévolue au sein de cette famille, l’écart qui s’est inexorablement creusé au fil du temps entre lui et les siens, entre leur monde et celui auquel il a eu accès grâce aux livres et à l’écriture. À travers l’émouvant portrait qu’il brosse de ce père, qui a fait ce qu’il a pu avec ce qu’il était, Xavier Le Clerc interroge les notions d’identité, d’intégration et de transfuge de classe. Éd. Gallimard, 128 p., 13,50 €. Élisabeth Miso
Basile Panurgias, Le doute. C’est l’histoire d’une amitié entachée par un immense scandale : qui croire, la justice ou l’ami ? L’auteur et narrateur, Basile s’adresse à celui qui fut son grand ami pendant une dizaine d’années. Il ne veut plus le voir, répondre à ses messages ni à ses cartes de vœux : écrire un livre, selon lui, est finalement une forme de réponse. Par un concours de circonstances, alors écrivain en quête de reconnaissance et de réseau social, il s’est vu ouvrir les grandes portes par ce fameux Jean-Claude, séduisant, marié à une Suédoise jurée du prix Nobel, touche-à-tout et figure éminente de la vie culturelle suédoise. Un jour de novembre 2017, ce dernier est accusé d'agressions sexuelles par dix-huit femmes. On crie au scandale en Suède, et le Nobel doit laisser en suspens la remise de son prix en 2018. Jean-Claude Arnaud est condamné à deux ans de prison et pourtant, clame son innocence. Lorsqu’ils se rencontrent à Paris, malgré le malaise qui le prend, Basile veut savoir, mais il sait qu’il ne saura pas. « Tu me connais quand même assez pour savoir que je suis doux. Jamais je ne ferai de mal à une femme. » « À notre rencontre, il y a moins de dix ans, tu es dans le Saint des saints du monde littéraire international, je suis aussitôt flatté de devenir l’ami du vieux sage. » L'écrivain mène alors sa propre enquête. On est encore étranger au phénomène #MeToo, mais la bombe Harvey Weinstein a explosé, et rien n’est plus comme avant. Alternant entre une enquête journalistique poussée pour démêler le vrai du faux et une trame narrative littéraire réussie, l’auteur revient sur son propre passé de jeune amateur de femmes, les étés d’adolescent quand il retournait dans son propre pays, la Grèce, se demande comment il se comportait quand il séduisait, se remémore les moments, les événements, à l’aune d’une époque où la drague n’est plus du tout une mode. Éd. Robert Laffont, 200 p., 20,50 €. Corinne Amar
Florence Costa, Abécédaire d’un amour contrarié. C’est une enfant qui rêve du Japon et décide qu’un-jour-quand-elle-sera-grande, elle ira vivre au pays du Soleil Levant et épousera un Japonais. Plus tard, elle fera des études brillantes de cette langue qu’elle voulait connaître, ira travailler et vivre au Japon, et épousera comme dans ses rêves un Japonais. C’est un livre qui égrène les lettres de l’alphabet et les thèmes propres au Japon – de A comme Amour à Z comme Zen ; chapitre par chapitre, c’est à la fois le témoignage personnel d’une vie de 25 ans au Japon et l’expérience de ce pays, l’apprentissage au quotidien de ses codes. C’est autant de fragments d’un discours amoureux que d’épisodes refroidis d’un Japon formaté sinon rigide, patriarcal et difficile. Emerveillement devant le pays fantasmé, évocation des saisons, de la nature, des rites, des coutumes, de son engagement conjugal, familial (elle aura trois enfants), mais aussi, son pendant ; un désenchantement qui, peu à peu, étreint, un gouffre qui sépare d’autant plus qu’on sera toujours considérée comme une étrangère, même mariée, même mère, même heureuse de vivre. « Au Japon beaucoup de femmes arrêtent de travailler après la naissance de leur premier enfant, puis elles reprennent une activité une fois que leur progéniture a quitté le nid. J’avais des amies qui avaient fait des études assez poussées et avaient un travail intéressant avant de se marier, mais qui avaient renoncé à tout dès la naissance de leur premier enfant. Elles parlaient peu de leurs études ou de leur travail d’avant (…). » C’est une succession d’événements de la vie japonaise, en même temps qu'une enquête sociologique sur ce qu’est le Japon, en réalité. Des illustrations délicates à l’encre noire qui introduisent les chapitres, des notes précieuses en bas de page qui viennent expliquer la définition des mots ou expressions japonaises, un glossaire utile à la fin du livre, font de cette édition un voyage. Illustrations de Mathias Costa. Éd. Akinomé, 176 p., 21, 90 €. Corinne Amar