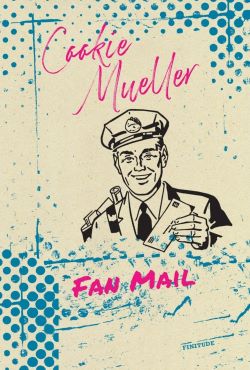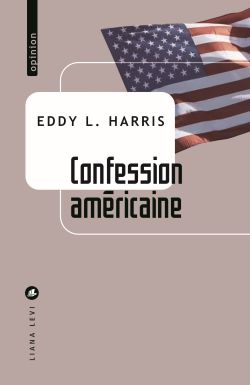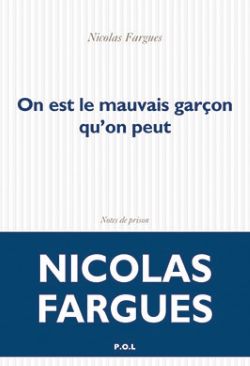Romans
Tove Ditlevsen, Dépendance. La Trilogie de Copenhague - III. Traduction du danois Christine Berlioz et Laila Flink Thullesen. Dans ce dernier tome de La Trilogie de Copenhague, une œuvre pionnière de l’autofiction, publiée entre 1967 et 1971, Tove Ditlevsen raconte comment son ambition d’écrivaine et sa quête de liberté se sont cognées aux dures réalités de la condition féminine. Elle y dévoile aussi, sans fard, son combat contre l’addiction. En 1940, la jeune poétesse danoise convole avec l’écrivain et journaliste Viggo Frederik Møller, de trente ans son aîné. Malgré leurs affinités littéraires, et bien qu’elle aspire depuis toujours à « être normale et ordinaire », à une vie sécurisante, elle étouffe dans son cocon domestique. « Je n’ai que vingt ans, mais je sens bien que la vie, hors de ces pièces vertes, file en fanfare pour les autres, alors que les journées me recouvrent insensiblement comme de la poussière, l’une après l’autre, toutes exactement semblables. » Elle travaille en secret à son premier roman. Quand elle écrit elle oublie tout, sa désillusion conjugale, les temps d’Occupation, le monde réel lui devient alors supportable. Elle se lie d’amitié avec de jeunes écrivains qui collaborent à la revue littéraire de son mari. L’un d’eux, Piet Hein, la séduit et l’encourage à divorcer. Son deuxième mari, Ebbe Munk, cherche désespérément sa voie et gère mal la célébrité de son épouse. Avec Carl Ryberg, son troisième conjoint médecin, qui l’isole peu à peu de toute vie sociale, Tove Ditlevsen va connaître, cinq années d’une descente aux enfers. Rendue totalement dépendante à un puissant analgésique, dont elle a découvert les effets lors de son deuxième avortement, elle n’est plus que l’ombre d’elle-même. Incapable d’écrire, elle regarde depuis son lit sa machine à écrire, se nourrit à peine, se désintéresse de ses trois enfants. Son quatrième époux Victor Andreasen la ramènera à la vie. « J’étais donc sauvée de ma si longue addiction, mais aujourd’hui encore en moi se réveille en sourdine l’ancien manque rien qu’en faisant une prise de sang ou en passant devant la vitrine d’une pharmacie. Ce manque ne mourra jamais vraiment, aussi longtemps que je vivrai. » Éd. Globe, 240 p. 19 €. Élisabeth Miso
Récit épistolaire
Cookie Mueller, Fan mail. Traduction de l’américain Romaric Vinet-Kammerer. Cookie Mueller, figure emblématique de la contre-culture américaine des années 1970 et 1980, morte du sida à quarante ans en 1989, a eu une vie foisonnante, marginale et transgressive. Égérie du réalisateur John Waters, amie intime de la photographe Nan Goldin, elle a été actrice, écrivaine, performeuse, go-go danseuse et critique d’art. Dans Fan mail, bref récit épistolaire, elle laisse libre cours à sa fantaisie trash et à sa liberté de pensée. Elle y met en scène un certain John Morton, un trentenaire totalement obsédé par l’actrice Georgia Banks, avec qui il a eu de fugaces rapports sexuels lors d’une fête de première théâtrale, huit ans auparavant. Depuis, cette nuit inoubliable, le fan inconditionnel tente désespérément d’entrer à nouveau en contact avec la star par courrier ou par téléphone. Il suit sa carrière de près, connaît la moindre réplique de ses films. Ses amis s’inquiètent de son délire persistant dans les lettres et les cartes postales qu’ils s’adressent ou lors de leurs conversations téléphoniques. Autour de John Morton, Cookie Mueller relie entre eux plusieurs personnages, tous plus farfelus les uns que les autres. Il y a le couple formé par Fred Knowles et Teresa Minetti, Mary Minetti sous emprise du crack qui a des visions et revend son mobilier pour se procurer sa drogue, leur oncle Joe accroc au jeu, « qui tire le diable par la queue » et ne résiste pas au charme très direct d’une richissime propriétaire de motels. Un temps, John Morton donne des nouvelles rassurantes depuis Naples où il s’accorde des vacances. Il affirme aller bien mieux après son adhésion au Groupe des Émotionnels Obsessionnels et aux Fans et Groupies Anonymes et semble avoir définitivement oublié Georgia Banks dans les bras d’Allegra Pazienza, une restauratrice d’art qui recolle les pénis de statues castrées au XIVème siècle. Mais le hasard réserve parfois de drôles de surprises… Éd. Finitude,48 p., 10 €. Élisabeth Miso
Essais
Eddy L. Harris, Confession américaine. Traduction de l’anglais (États-Unis) Grace Raushl. En 2016, l’année de ses soixante ans et de l’accession au pouvoir de Donald Trump, Eddy L. Harris comprend enfin pourquoi il a quitté les États-Unis des décennies plus tôt. Comment a-t-il pu être aussi aveugle sur l’état inquiétant de son pays ? « (…) le pays auquel j’aspirais n’était pas celui qui m’avait été donné, mais, surtout, certainement pas celui qu’on m’avait promis. » Tous les mensonges sur lesquels il s’est construit depuis l’enfance, cette croyance en « la liberté et la justice pour tous », ce mythe du rêve américain, lui sautent au visage. Il a grandi à Saint-Louis (Missouri), entre un père profondément conscient de l’ancrage du racisme et une mère qui lui a transmis sa confiance en l’avenir, persuadée que le travail et l’éducation étaient les clés pour trouver sa place en ce monde. Il a percé sur la scène littéraire avec Mississippi solo (1988), le récit de sa descente en canoë du fleuve. Ses voyages à travers les États-Unis, l’Afrique, l’Europe ont nourri ses livres et ses méditations sur l’identité. Lui qui ne s’est jamais défini comme noir américain, s’interroge sur sa propre trajectoire, sur ce que signifie faire Nation, être américain dans un pays totalement divisé et replié sur lui-même. Qu’est-ce qui a rendu possible l’élection de Trump, ce showman fortuné sans « Aucune expérience requise, comme si un pays n’était qu’un business, comme si la gouvernance n’avait pas d’importance (…) » ? L’écrivain redéroule l’histoire américaine, la question raciale, l’ascension de la droite religieuse. Les élites blanches les plus conservatrices sont parvenues à ce que les classes populaires se haïssent entre elles, plutôt que de s’unir contre ceux qui s’enrichissent sur leur dos. S’il n’avait pas choisi de vivre en France, aurait-il pu comme d’autres intellectuels, empêcher l’impensable, aider ses concitoyens les plus amers à ne pas se laisser piéger par des « constructions mentales les plus grotesques simplement pour avoir quelque chose à quoi se raccrocher, quelque chose ou quelqu’un en qui croire. » ? Eddy L. Harris dresse un constat édifiant du danger antidémocratique en marche outre-Atlantique. Éd. Liana Levi, 96 p., 12 €. Élisabeth Miso
Autobiographie
Angela Terzani Staude, L’Âge de l’enthousiasme, Ma vie avec Tiziano Terzani. Traduit de l’italien par Isabel Violante. Son nom à lui, Tiziano Terzani (1938-2004) rappelle qu’il fut l’un des journalistes écrivains voyageurs italiens les plus influents de sa génération. Son nom à elle, Angela Staude, nous dit qu’elle est la fille d’un peintre allemand et d’une architecte, qu’elle est née en 1939 à Florence, dans une famille cultivée et non-conventionnelle. « Avec le temps, les souvenirs deviennent flous comme les rêves si on ne les fixe pas avec des mots. C’est pour cette raison que je tiens mon journal depuis l’âge de quinze ans ». Angela Terzani Staude nous dévoile ici dans un prodigieux récit de vie 40 années d’une histoire d’amour avec celui qu'elle rencontre à l’âge de 17 ans à Florence, leur ville commune de naissance – alors qu’elle avait entendu parler de lui dans leurs années de lycée, sans le connaître. Dès leur première rencontre, une fin d’été 1957, une après-midi caniculaire de retour de vacances chez son amie Pina, Angela est absorbée par la lumière dont Tiziano rayonne, par ce jeune homme qui rêve comme elle de découvrir le monde. Elle est frappée par les idéaux auxquels il aspire déjà, ceux-là mêmes qui guideront sa manière d'être journaliste et son engagement éthique et politique. Comment écrit-on, à dix-sept ans, la naissance de l’éblouissement ? « (…). Le voilà enfin. Je l'observe, assise sur une chaise du XVIIIe siècle. Il porte des jeans et une chemise blanche. Ses cheveux sont noirs, ondulés, avec une raie sur le côté, ses yeux sont verts, ardents ; il regarde au loin. Il est très grand, très beau., l’air romantique de celui qui porte un rêve. Je n’avais jamais vu un garçon comme lui. » Ils s’épousent dix ans plus tard. Cette année 1967, elle le suit à New York, où il a obtenu une bourse de deux ans, offerte par une prestigieuse fondation. Ils ont deux enfants, nés à deux ans d’intervalle. Terzani devient, en 1971, correspondant pour l’Asie du Sud-Est de l’hebdomadaire allemand Der Spiegel, chargé de couvrir la guerre au Vietnam et en Indochine, conteur sur le terrain d’un monde asiatique en pleine mutation. Angela écrira sur la Chine notamment et sur le Japon, des récits documentés. L’Âge de l’enthousiasme est son premier livre traduit en français. Éd. Intervalles, 335 p., 23 €, Corinne Amar.
Journal
Nicolas Fargues, On est le mauvais garçon qu’on peut. « Pendant trente ans, j’ai longé les murs de la maison d’arrêt de la Santé, en ignorant ce qu’on pouvait bien trouver derrière. Aujourd’hui, je m’en suis fait une idée. » Après avoir beaucoup voyagé, vécu et travaillé en Alliance française et en Institut français à l’étranger, l’auteur anime à Paris des ateliers d’écriture dont, sept mois durant, un atelier d’écriture à la prison de la Santé. D’emblée, il s’interroge : pourquoi là-bas, pourquoi moi, au nom de quel statut ? Ceux qu’il va rencontrer, dit-il, entre les murs de cette prison sécurisée, ce n’est pas les grands noms certes du braquage ou du crime organisé, ce sont les petits de la délinquance quotidienne, de la violence de quartier, ces marginaux, ces rebelles à l’ordre, dont il va tenter de se faire accepter par le langage des mots. « Exercice du jour : Décrivez votre codétenu. L. me prévient poliment qu’il préfère passer son tour. Deux jours plus tôt, de retour de promenade, il a retrouvé le sien pendu dans l’encadrement de la fenêtre de leur cellule. » Sous forme de journal, Nicolas Fargues raconte, de l’intérieur, les moments ponctuels de vie quotidienne qu’il partage avec les prisonniers : paragraphes plus ou moins longs, plus ou moins courts, notes brèves, lignes retranscrites d’un dialogue, jetées sur la page parmi les centaines de notes de choses vues, vécues et entendues. Et puis, les tentatives d’approche, d’apprivoisement, de sympathie partagée, d’humour aussi, de générosité même. Comment rester sur son quant-à-soi, comment ne pas être dérouté, perturbé, attendri par ces rendez-vous, ces individualités nues qui se confient, expriment ou retiennent et finalement, se font ami. Comment ne pas donner son numéro de téléphone personnel alors qu’on n’a pas le droit de le faire, pour créer du lien, poursuivre, éprouver la confiance, l’humour, comme lorsqu’il écrit à B. pour lui demander s’il a besoin de quelque chose du dehors avant sa venue, et que B. du tac au tac lui répond « Un paquet de bonbons Haribo, et toi, Nico, tu n’as besoin de rien, dehors ? N’hésite pas. » Un témoignage brut, sans fioriture, et doux, sans jugement, qui explore la frontière si délicate, infime, entre la liberté et sa privation. Éd. P.O.L, 144 p., 16 €. Corinne Amar.