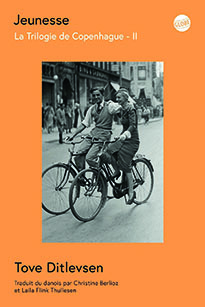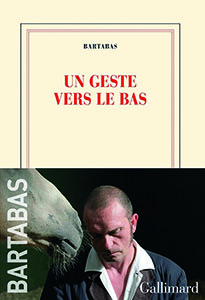Correspondances
Cécile Berly, Elles écrivent. Les plus belles lettres de femmes au XVIIIe siècle. Dans un monde dominé par les hommes, leurs correspondances font œuvre littéraire à part entière alors même que, l’espace public leur étant interdit, ces épistolières n’avaient aucune ambition et ne revendiquaient pas le statut de femmes de lettres. Historienne, spécialiste du XVIIIe siècle – ce grand siècle de la correspondance – Cécile Berly dresse le portrait de ces figures féminines qui, par leur façon de vivre et d’écrire, leur indépendance, leur modernité, illuminèrent leur époque. C’est la Marquise du Deffand qui fit de la lettre un art de vivre ; c’est Madame de Pompadour, favorite de Louis XV, Julie de Lespinasse, obsédée d’amour à en mourir, Marie-Antoinette, Reine de France pour qui l’écrit était un acte de survie ; c’est Isabelle de Bourbon-Parme, princesse et follement amoureuse de sa belle-sœur, Marie-Christine d’Autriche ; c’est Germaine de Staël, qui reçut une éducation exceptionnelle pour son temps. Devenue baronne de Staël-Holstein, femme de l’ambassadeur de Suède en France, romancière, essayiste, elle voyagea aux quatre coins de l’Europe et assuma sa liberté, ses propos et ses amours tel un homme. Elle eut de nombreux amants dont Benjamin Constant, car elle aimait les hommes de pouvoir autant qu’elle aimait séduire. Sa correspondance est monumentale : l’écrit est un pouvoir. La lettre la plus émouvante, la plus vulnérable est sans doute celle qu’elle écrivit à sa mère alors qu’elle s’apprêtait à quitter le toit familial pour un mariage de convenance. Fille unique de parents qu’elle vénérait - surtout son père, Jacques Necker, grand homme et ministre des Finances de Louis XVI. « Paris, 19 janvier 1786, Ma chère maman, Je ne reviendrai pas ce soir chez vous. Voilà le dernier jour que je passe comme j’ai passé toute ma vie. Qu’il m’en coûte pour subir un tel changement ! Je ne sais s’il y a une autre manière d’exister ; je n’en ai jamais éprouvé d’autres, et l’inconnu ajoute à ma peine. » Douloureux sacrifice, long chemin que celui de l’émancipation ! Éd. Passés composés, 286 p., 20 €. Corinne Amar. Ouvrage publié avec le soutien de la Fondation La Poste
L’amitié dans tous ses états. Correspondances. Conçu et présenté par Nicole Marchand-Zanartu et Jean Lauxerois. On doit à Nicole Marchand-Zanartu et Jean Lauxerois la conception de cet ouvrage chatoyant. Les auteurs sont nombreux, leurs tons diffèrent et leurs voix s’entremêlent à celles des épistoliers dont ils nous parlent. Ce sont des rapports de lecture aux tons variés ; académiques, humoristiques, poétiques, par exemple. À divers titres, soit en spécialistes, soit en adeptes, soit en touristes, chaque auteur explore la correspondance entre deux personnalités ayant un lien amical. Ce lien est même le centre de leurs échanges de lettres. Échanges donnant lieu à un corpus de commentaires. Cela crée un livre tout aussi riche que léger. Sa couverture reprend la roue chromatique de Goethe. Cette roue, basée sur six couleurs principales, rend compte de leurs oppositions émotionnelles mais aussi de leur harmonie. De fait, le contenu du livre témoigne de cela aussi. On y parle donc de l’amitié, dans tous ses états. Découpant la roue chromatique en catégories, le livre classe les correspondances selon un ordre original et pertinent. Un ordre affectif. Chaque chapitre rassemble des correspondances ayant en commun un sentiment ou une qualité. Ainsi, dans la zone associée au combat, associé au vermillon sur la roue chromatique, on trouvera les échanges de Tarkovski et Paradjanov, de Erice et Kiarostami, de Dreyfus et de la marquise Visconti. Pour ces derniers, le combat, c’est l’ardeur militante. Et, dans cette catégorie encore, deux êtres au funeste destin commun : Varlam Chalamov et Nadejda Mandelstam. C’est la traductrice et écrivaine, Luba Jurgenson, qui a rédigé l’article sur leur correspondance. Quarante correspondances sont évoquées. Si l’amitié y est centrale, elle n’est pas sans oppositions. Elles témoignent de toute façon d’une amitié. C’est un sentiment où il entre une part de construction en vue d’une estime réciproque, par-delà les différences. Et chaque lecture met en lumière la caractéristique de telle ou telle amitié. À l’instar de la roue chromatique, l’amitié comporte de nombreuses nuances. Éd. Médiapop, 212 p., 20 €. Gaëlle Obiégly
Autobiographies
Tove Ditlevsen, Jeunesse. La trilogie de Copenhague II. Traduction du danois Christine Berlioz et Laila Flink Thullesen. «Tant que j’habiterai ici, je serai condamnée à la solitude et à l’anonymat. Le monde m’ignore, et chaque fois que j’en attrape un pan, il me glisse des mains une fois de plus. » Après Enfance qui racontait ses origines prolétaires et sa conscience d’être différente, Tove Ditlevsen (1917-1976) se retourne, dans le deuxième volume de sa Trilogie de Copenhague, sur sa jeunesse. À quatorze ans, elle découvre médusée, la dure réalité du travail. La journée, elle s’épuise à la tâche, et le soir elle écrit, poursuivant ce rêve fou de devenir poète, qui l’habite depuis son plus jeune âge. Elle attend avec impatience ses dix-huit ans pour échapper à sa famille, au quarter ouvrier de Vesterbro. Elle aspire à avoir une pièce rien qu’à elle où écrire en toute tranquillité. Elle exerce toutes sortes d’emplois peu gratifiants, avant de gagner un peu mieux sa vie comme sténographe. Elle voudrait tant « être propriétaire de (s)on temps au lieu de toujours le vendre. » Avec son amie Nina, rencontrée dans une troupe de théâtre amateur, elle fréquente les dancings. Des jeunes hommes l’émeuvent, l’embrassent mais ne la font pas vibrer. Elle désespère de rencontrer un homme qui la comprenne, avec qui partager sa passion pour la littérature. Il n’y a guère que son frère Edvin pour apprécier ses poèmes et l’encourager dans cette voie. Chaque jour, elle voit s’épaissir un peu plus l’ombre de son existence insignifiante, mais aussi celle terrifiante d’une guerre mondiale. En de rares occasions, une éclaircie vient trouer cet horizon bouché, alléger ce combat constant pour obtenir son indépendance, comme ses rencontres avec un marchand de livres puis avec un rédacteur en chef qui publie un de ces poèmes et l’aide à trouver un éditeur. Quand elle serre entre ses mains son premier recueil de poèmes imprimé, Une jeune fille, c’est une petite fenêtre, qui s’ouvre enfin, sur des émotions insoupçonnées et sur le monde qu’elle appelle de toute son âme depuis si longtemps. « Ce soir, je veux être seule avec mon livre, car personne ne peut comprendre combien, pour moi, c’est un véritable miracle. » Éd. Globe, 208 p., 18 €. Élisabeth Miso
Farida Khelfa, Une enfance française. Figure magnifique de la mode des années 80, muse de Jean-Paul Goude, égérie d’Azzedine Alaïa, actrice, documentariste, elle est aujourd’hui auteure d’une saisissante autobiographie. Il lui fallut attendre la mort de sa mère pour pouvoir écrire un tel livre, replonger dans ses origines, revivre une enfance vécue dans la terreur et la violence incontrôlable du père. Ses parents, algériens, arrivent en France dans les années 50. Farida grandit dans une cité HLM de Vénissieux, près de Lyon, dans une fratrie de neuf enfants tous nés en France. Le père, gardien de nuit, détruit parce que colonisé, est alcoolique. Il boit sans discontinuer, puis se déchaîne sur sa femme et ses enfants. Quant à la mère, entre les fausses couches et les accouchements, internée à plusieurs reprises, sujette à la folie - comme le père, comme l’un des frères - incapable d’aimer ses enfants, elle est incapable de les protéger. Contre la violence, contre l’inceste. Frères, sœurs, ils sont d’une grande beauté et soudés par le rire. Adolescents, les garçons ont été mis dehors, les filles elles, ont fugué. Farida a seize ans, lorsqu’elle se sauve, monte dans un train pour Paris, débarque chez l’une de ses sœurs. Non loin, il y a le Palace. La bourgeoisie branchée, les célébrités y fraient avec les inconnus. L’époque est à la mixité sociale, à l’extravagance et à la fête. Farida est grande, sculpturale, sauvage. Elle y rencontre Jean-Paul Goude qui, subjugué, veut faire d’elle « la première icone arabe de la mode ». Aussitôt dans la lumière, elle découvre un autre monde. Mais on n’oublie jamais l’enfance qu’on a eue : le Palace la plonge dans l’enfer de la drogue, lui apporte la confiance qu’elle n’a pas, la détruit peu à peu. De longues années de psychanalyse auront raison de cette enfance. Une confiance regagnée, l’amour, deux enfants, un mariage… C’est l’histoire d’une émancipation, d’une résilience. « J'ai une dette envers mes parents. Je leur dois la vie. Mais pas le pardon. Pardonner m'est impossible. Le long chemin de l'immigration est un lourd héritage, j'ai dû m'inventer contre eux ». Éd. Albin Michel, 252 p., 19,90 €. Corinne Amar
Récits
Bartabas, Un geste vers le bas. En 1990, Pina Bausch vient saluer Bartabas à l’issue d’un de ses spectacles au Fort d’Aubervilliers. Entre eux, malgré le silence des timides, un dialogue s’instaure immédiatement, une évidente reconnaissance mutuelle. Ils ont beaucoup en commun, les voyages, la création, la responsabilité d’une troupe, et cette tentative « d’approcher le monde par l’univers des sens. » Un soir, l’écuyer emmène la chorégraphe allemande rencontrer Micha Figa, un de ses chevaux. Il pressent que ces deux âmes pourraient vivre quelque chose de singulier ensemble. Il est curieux de voir quelle connexion un humain, vierge de toute expérience équestre, peut établir avec un cheval. Quel langage, une danseuse qui s’exprime avec son corps, peut inventer au contact de cet animal, quelles sensations primitives peuvent filtrer dans ses mouvements. D’emblée, il est frappé par l’infinie délicatesse, le profond respect que manifeste Pina Bausch face à Micha Figa. « Elle n’est pas de ceux qui portent sur eux l’odeur de la peur. Jamais elle n’avait approché un cheval. Je sais maintenant qu’elle ne sortira pas indemne de cette aventure. » Le fondateur du Théâtre Zingaro n’intervient d’aucune manière, il observe simplement, toujours en retrait, comment ces deux êtres s’apprivoisent et communiquent. Lors de ces échanges, tard dans la nuit et jusqu’à l’aube, la danseuse s’abandonne totalement à cette présence animale, à la beauté de ce qui advient la nuit, dans un état de fatigue. Ces rendez-vous nocturnes vont s’étaler ainsi sur plus de dix ans, au gré des agendas respectifs des deux compagnies. Un été, ses danseurs repartis dans leur fief de Wuppertal, après une série de représentations à Paris, Pina Bausch s’installe même quelques jours au sein de la tribu Zingaro. Bartabas évoque avec beaucoup de poésie leur amitié, la grâce de ces moments inspirants, de ces éclats de création partagés avec l’immense chorégraphe. Entre les deux artistes, l’idée avait germé d’un spectacle autour de cette aventure. Mais, très vite, il est devenu clair que « (…) ce que révélait Micha Figa en elle était si profond, si intime, si précieux qu’il serait difficile de le représenter sur scène. L’exposer eût été le galvauder. » Éd. Gallimard, 112 p., 17 €. Élisabeth Miso
Olivier Bourdeaut, Développement personnel. Une cabane en pierre dans un paysage paradisiaque, au nord de l’île d’Ibiza. Olivier Bourdeaut espère beaucoup, en ce mois de janvier 2023, de ce changement de décor pour trois semaines. Depuis des mois, l’auteur de En attendant Bojangles, est en panne d’inspiration. Après trois romans publiés, il ne bute pas sur la page blanche mais sur la médiocrité criante de ses textes. Au tout début, il lui arrivait d’en rire, lui qui a le sens de l’autodérision, puis l’inquiétude a pris le dessus. Il a bien tiré quelques fils narratifs, tenté de donner vie à des personnages, mais rien de satisfaisant n’est sorti de son imagination. Alors qu’il a toujours considéré que parler de soi ne présentait aucun intérêt littéraire, il se met à écrire sur la place qu’occupe l’écriture dans son existence, sonde sa mémoire sur l’origine de cette activité. Dyslexique, gaucher et légèrement sourd, toute sa scolarité a été une épreuve. Il ne parvenait jamais à faire ce que les autres réalisaient facilement. Il se sentait différent, inadapté, inutile et ne comprenait pas pourquoi on l’obligeait à apprendre des choses inutiles. De ses cinq ans à ses vingt ans, il n’a pu supporter le monde qui l’entourait que grâce à la lecture. Un jour son père lui a suggéré de tenir un carnet de vocabulaire et de citations, et cela l’a enchanté. Le cancre se rêvait écrivain. « Médiocrité et mégalomanie, l’association de ces deux mots donne une définition assez précise de la bêtise. Pourtant elle a toujours été ma boussole. Plus ma réalité, mes réalisations, mes résultats étaient médiocres plus mes objectifs devenaient délirants. » À l’âge adulte, il cumule les expériences professionnelles désastreuses et se vante régulièrement, auprès de ses proches, d’avoir tout un roman en tête qui n’attend plus que le lieu idéal pour être rédigé. C’est l’un de ses frères qui va l’acculer à se frotter concrètement à ses ambitions littéraires. Olivier Bourdeaut joue ici avec les codes des manuels de développement personnel et dévoile avec beaucoup d’humour et de sincérité, le chemin tortueux qui a été le sien jusqu’au métier d’écrivain. Éd. Finitude, 176 p., 18 €. Élisabeth Miso
Revues
Les Moments littéraires n° 51. Daniel Arsand. Apprendre ce que l’on est, avec ou malgré le regard des autres. Tour à tour libraire, conseiller littéraire, attaché de presse, éditeur de littérature étrangère chez Phébus, Daniel Arsand a consacré sa vie professionnelle aux livres et aux auteurs. Écrivain, il publie son premier livre à trente-neuf ans : « J’ai attendu d’être libre. J’ai attendu la mort de mes parents pour publier. » Dans son œuvre romanesque, la violence règne. Le viol, la haine, la vengeance, les destins sombres sont toujours présents. Cette vision brutale des rapports humains est en partie la résultante des épisodes traumatisants d’une jeunesse solitaire qu’il a décrite notamment dans son dernier récit autobiographique, Moi qui ai souri le premier (Actes Sud, 2022). Tout lecteur de Daniel Arsand qui le rencontrera sera étonné par la dualité qui existe entre la brutalité qui habite chacun de ses livres et la gentillesse, la bonhommie qui émane de lui. Benoîte Groult lui a dit « Vous êtes tellement doux et vous écrivez des livres d’une rare violence ! »
Le dossier Daniel Arsand : Protéger / s'exposer de Christian Chavassieux - Entretien avec Daniel Arsand - Journal de Daniel Arsand. Également au sommaire du n°51 : Ève Morcrette, Entretien & portfolio / Évelyne Trouillot, Mon regard sur le monde / Marie-Louise Audiberti, Carnets / Valéry Meynadier, Thanathobiographie / Les chroniques littéraires d’Anne Coudreuse. Voir le site de la revue