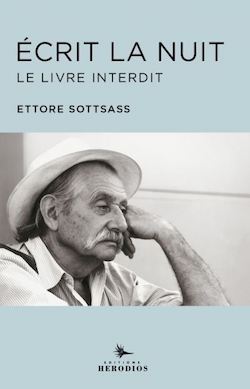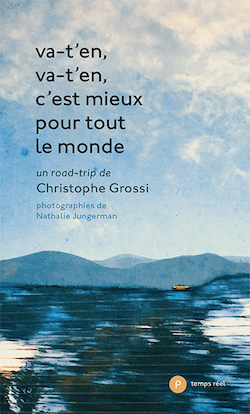ROMANS
Maïa Kanaan-Macaux, Avant qu’elle s’en aille. Sa mère perdant inexorablement la mémoire, Maïa Kanaan-Macaux sait qu’elle sera bientôt la seule à se souvenir. Alors elle veut « avoir encore un peu de temps avec elle maintenant que sa mémoire défaillante ouvre les portes d’une sensibilité gardée enfouie (…) ». Maintenant que sa mère parle du passé, de leur vie de famille, qu’elle laisse filtrer ses émotions, une relation plus étroite se tisse entre elles atténuant les manques. La fille installée en Normandie, vient régulièrement à Rome, dans le quartier de l’Aventin où réside sa mère et où elle a grandi. Chaque fois qu’elle gravit la colline, tout la ramène à son enfance : les odeurs, les rues familières où elle jouait avec son frère aîné Jean-Sélim. Ce qui a motivé l’écriture de ce premier roman à la trame autobiographique, c’est le besoin de garder vivante l’histoire familiale. L’auteure y raconte la richesse d’une enfance cosmopolite entre des parents qui ont transmis à leurs deux enfants une certaine idée de l’engagement et d’un monde ouvert. Elle y dévoile aussi les drames. Son père égyptien, diplomate pour l’ONU, partait pour de longues missions. Quand il était de retour dans la Ville éternelle, l’appartement s’emplissait de sa tendresse. Et puis, en novembre 1985, tout bascule. Le père décède mystérieusement dans une province reculée chinoise et est enterré en Égypte en l’absence de ses enfants. La mère brisée, déserte le foyer. « Je cherche à comprendre ce qui l’a poussée à sauver sa peau, à se construire un avenir sans se préoccuper de nous. » Maïa et son frère, respectivement âgés de treize et quinze ans, vont veiller l’un sur l’autre, indéfectiblement soudés. « Nous apprenons à devenir adultes sans filet, sans douceur, nous apprenons, côte à côte, chacun dans la vie qu’il se dessine, malgré la solitude, sans renoncer à son idéal d’un monde plus juste pour lui, et avec pour seul et unique objectif, pour moi, que celui d’être heureuse. » Jean-Sélim embrasse une carrière humanitaire et intervient dans les zones de conflits les plus dangereuses, Somalie, ex-Yougoslavie, Irak. Il meurt à trente-trois ans à Bagdad le 19 août 2003, lors de l’attentat contre le siège des Nations unies. Maïa Kanaan-Macaux était enceinte, son frère venait d’être père d’un petit garçon, ils étaient heureux, ils étaient inséparables. Éd. Julliard, 180 p., 19 €. Élisabeth Miso
BIOGRAPHIES
Marc Petitjean, L’ami japonais. Après lui avoir consacré un documentaire, Marc Petitjean s’est à nouveau penché sur le parcours étonnant de son ami Kunihiko Moriguchi, maître de peinture sur kimono et Trésor national vivant. Avant lui, son père Kakô a reçu le même titre prestigieux pour avoir su innover tout en perpétuant des thèmes et des motifs de la teinture traditionnelle yuzen. Kunihiko Moriguchi est né à Kyoto en 1941. Dès son plus jeune âge, il observe le savoir-faire de son père et de ses disciples, mais trop heurté par le fonctionnement archaïque de son père, il n’envisage pas un seul instant de marcher sur ses pas. Il rêve de devenir artiste peintre. Il apprend le français et décroche en 1963 une bourse pour étudier aux Arts décoratifs. À Paris, il s’émancipe vraiment loin du carcan familial et des conventions de la société japonaise. Il se distingue très vite par sa dextérité et s’intéresse plus particulièrement au design graphique. Sollicité par deux amis de son père, deux conservateurs du musée de Tokyo venus présenter des œuvres anciennes japonaises au Petit Palais, il fait la connaissance de Balthus, commissaire de l’exposition choisi par Malraux. Au contact du peintre, le jeune homme fréquente le milieu artistique et intellectuel parisien, côtoyant ainsi Miró, Max Ernst, Chagall, les frères Giacometti ou Jacques Prévert. Son diplôme en poche en 1966, beaucoup d’opportunités professionnelles s’offrent à lui en France. En plein questionnement sur son avenir, il rejoint Balthus à la Villa Médicis. Le peintre, très sensible à la culture ancestrale japonaise, attire son attention sur l’importance de la tradition transmise de génération en génération. « (…) ce qu’il me disait me faisait reconsidérer tout ce que j’avais bâti pour échapper au monde de mon père. Ces paroles venant de Balthus, un grand artiste attaché à la tradition et qui réussissait ! J’étais complètement défait… et refait peut-être aussi par lui. » Contre toute attente, il rentre au Japon et cherche son propre mode d’expression au sein de l’atelier de son père. Pour se démarquer de la virtuosité de ce dernier, il élabore des motifs abstraits inspirés de l’art optique. « Ce qu’il cherchait, ce n’était pas la maîtrise du dessin, mais plutôt que le kimono tout entier devienne un dessin, et une sculpture en mouvement. Une révolution dans le monde du yuzen. ». Kunihiko Moriguchi a inscrit son œuvre dans l’histoire du kimono, ses créations mettent en valeur la beauté du corps humain par le biais d’un subtil alliage entre tradition et modernité. Éd. Arléa, 176 p., 17 €. Élisabeth Miso
RÉCITS
Claro, La maison indigène. Longtemps Claro s’est refusé à faire sienne l’histoire familiale, tenant à distance ce qu’il savait d’un passé marqué par la colonisation et l’indépendance de l’Algérie. Et puis à la faveur d’une série de hasards, un travail de mémoire s’est imposé à lui, nourri de questionnements intimes et de son rapport à la littérature. Tout est parti d’un signe de correspondance entre Albert Camus et son grand-père paternel, l’architecte Léon Claro, pointé par son ami Arno Bertina. En 1930, Léon Claro fait bâtir au pied de la Casbah d’Alger la Maison indigène, à l’occasion du centenaire de l’Algérie française. En 1933, Albert Camus la visite avec son ami Jean de Maisonseul et impressionné par les lieux, écrit à dix-neuf ans La Maison mauresque, son premier texte paru seulement après sa mort. En pénétrant à son tour mentalement dans cette Maison indigène qu’il n’a jamais vue, en rassemblant des archives et ses propres souvenirs, le romancier et traducteur déploie un subtil jeu de résonances personnelles et historiques. Surgissent ainsi, au fil des pages, plusieurs figures du passé toutes reliées entre elles par la Ville Blanche et par un réseau de coïncidences : son grand-père, son père, le cercle d’artistes et d’intellectuels formé dans les années trente par Albert Camus, Jean Sénac, Jean de Maisonseul, Sauveur Galliéro, Louis Bénisti et Emmanuel Roblès ou encore Le Corbusier venu à Alger en 1931. Luchino Visconti traverse également le livre avec le tournage de L’Étranger en 1967. Claro a connu enfant le poète Jean Sénac, un ami de son père. Le récit de cette amitié le mène jusqu’au vif intérêt de son père pour la littérature, et ce faisant jusqu’à sa propre passion. Henri Claro écrivait de la poésie mais n’a jamais été publié. « J’ai compris, mais un peu tard, qu’une maison est souvent un lieu où l’on attend quelqu’un. On reste là, devant le portail, persuadé que l’attente peut précipiter la venue de l’absent. » À travers sa relation au père, l’auteur remonte aux sources de sa vocation d’écrivain, reconnaissant enfin ce qui a circulé de père en fils, après avoir imaginé s’être construit seul en dehors de tout héritage. « Mais il ne suffit pas de se retourner pour voir ce qui est derrière soi, non, ce serait trop facile, et je suppose qu’un jour arrive où l’on doit apprendre à défroisser sa propre vie, à en lisser les plis, car c’est n’en doutons pas dans ces tracés confus qu’est inscrit, souvent illisible, non pas le faux mystère de soi, mais le souvenir perdu de tant de gestes, là que se sont agrégés les signes de l’impossible transmission. » Éd. Actes Sud, 192 p., 19,50 €. Élisabeth Miso
Ettore Sottsass, Écrit la nuit, Le livre interdit. Récit traduit de l’italien par Béatrice Dunner. Son nom est associé au design moderne et contemporain en Italie et dans le monde, associé aussi au fameux groupe Memphis qu’il créa dans les années 1980, à Milan. Ettore Sottsass (1917-2008) était architecte, céramiste, designer industriel, photographe, essayiste, mais aussi un captivant conteur. Ce texte-ci, publié par les toutes nouvelles éditions Herodios, nous fait découvrir l’autre part de l’homme ; son roman privé, son journal existentiel, l’homme à nu : celui qui aime, celui qui désire. Récit confession, testament amoureux, brûlant de sensualité – et cette profonde qualité littéraire qui subjugue – romanesque, au sens magique du terme. « Étrange qu’à cinquante-sept ans on puisse tomber amoureux comme un imbécile. Qu’on puisse rêver les choses les plus fantastiques, souffrir comme jamais on n’a souffert, avoir envie de se suicider, avoir un sexe brûlant et gonflé de sang, se sentir mourir pour des lèvres et des yeux lointains, des gestes secrets qu’on ne peut même pas dire. » Parce qu’il y est question des femmes qui traversent sa vie, du corps et du regard des femmes, de l’amour qui se termine et de l’amour qui commence – du passage délicat entre les deux – de la trace, profonde ou non qui finit par disparaître, Sottsass se confie à ce livre noir que personne ne pourra jamais lire. Errance mélancolique de celui qui aime, sans bagage, sans rien et se sent bien ainsi, fragment épars et resserrés, journal de voyages, en Inde, au Japon, avec sa muse, l’éditrice traductrice, Barbara Radice (qu’il a épousée, en secondes noces, en 1976) ; propos sur l’instant qui passe, sur les gens perplexes et pas sûrs d’eux, ces modestes qu’il préfère aux autres, instantanés sur le travail, le design, la cuisine italienne, la nostalgie de ce qui a été, le bien ou le mal de vivre... « Si l’on n’y veille, toutes les histoires d’amour finissent à la poubelle. » Éd. Herodios, 102 p., 16 €. Corinne Amar
JOURNAUX
Christophe Grossi, Va-t’en, va-t’en, c’est mieux pour tout le monde. Un jour sûrement, par agacement ou par lassitude, par résolution, un jour sûrement, parce que même près, même loin, son image nous obsède tristement, cette phrase sans doute l’aura-t-on, nous aussi, prononcée : « mais va-t’en, va-t’en, c’est mieux pour tout le monde ! » Le narrateur de ce road trip n’a ni le costume ni la mallette, ni le rasage de près du commis voyageur, et pourtant, c’en est un ; sur les routes, le coffre de la voiture de location empli des livres de la maison d’édition qui l’embauche, avec ses catalogues et ses bons de commande. Marathon organisé : les villes traversées, les rendez-vous en librairies au pas de course, l’attente fébrile, les parkings à trouver, les kilomètres de route à avaler, les cafés anxieux, les sandwichs sans âme en vitesse, les petits hôtels, les livres qui ont une âme et dont il faut parler, le temps après lequel il faut courir. « Quatrième jour. Mieux dormi. Peu mais bien. Il fait beau, pas encore chaud. Ça ressemblerait presque à des vacances. (…) Je ne parviens pas à rencontrer la responsable des achats. Je vois le directeur adjoint, quelqu’un à priori ouvert, accueillant et à l’écoute. « Revenez à l’automne pour que la responsable puisse voir les produits. » Ça s’est terminé comme ça. Soudain, j’en ai assez d’aller et venir. » Tout laisser tomber, ultime tentation : disparaître, s’évaporer, lui et son corps et son anonymat, nulle part chez eux. Dans les bars, les hôtels, les librairies, il entend les histoires des autres, toutes ces vies côtoyées, quand il peut, il sort son cahier, il écrit. Son univers, c’est les livres qu’il trimballe dans sa voiture ou ceux qu’il achète, les musiques qu’il écoute au volant, les rencontres, celle à qui il écrit – extérieur intérieur qu’il ouvre, qui apparaît. Partir, c’est écrire, c’est aimer pour ne pas se sentir mourir, même si ça doit finir un jour. Un road- trip comme un long poème, sensible à la blessure et habité de littérature. Éd. Publie.net (réédition augmentée de photographies de Nathalie Jungerman), 150 p., 14 €. Corinne Amar.