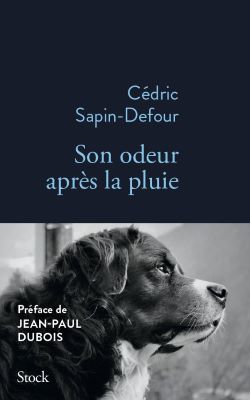Récits
Gilles Sebhan, Bacon, juillet 1964. Il disait que sa vie passait entièrement dans sa peinture, mais ce n’est qu’au tout début des années 1960 que Francis Bacon (1909-1992) connaîtra la consécration en Angleterre avec une première grande rétrospective. C’est un documentaire sur l’artiste d’une vingtaine de minutes fait par un journaliste de la Radio Télévision Suisse en 1964, portrait si troublant de vérité, si énigmatique que l’auteur en fait le sujet de son livre et entreprend de nous le raconter. Nous sommes dans l’espace de l’atelier le temps de cette soirée où on voit et entend la voix en français de l’artiste tournoyant au centre de tout, un verre à la main au milieu de ses amants, de ses amis, dans son fameux atelier du 7 Reece Mews, à Londres, répondant aux questions du journaliste venu l’interviewer. D’emblée, c’est l’aveu de son impuissance qui surgit : « il ne se sent pas grand-chose ». Habité de pessimisme, Bacon évoque pourtant la quête de magie partout. Le journaliste : Vous parliez de la situation désespérée du peintre, vous la croyez vraiment désespérée ou est-ce que vous approchez ? Non, je ne sais pas, vous savez avec moi, je n’ai jamais réussi, à cause de ça je continue. » On reconnaît chez Bacon cette hantise et cette volupté du sacrifice et du martyr à travers ses tableaux, ses références, il évoque ses relectures ; Shakespeare, Conrad, Nietzsche et la naissance de la tragédie, Eschyle, Sophocle ou la crucifixion du Christ, toutes ces présences invisibles, ces divinités qu’il est seul à voir, qui ne cessent de l’attaquer, mais il dit voir ses tableaux peu violents en comparaison de la vie même. Puis, il y a les disparitions de ses amis, les suicides autour de lui comme autant de signes de sa malédiction. Propos sur l’art, la mort, la vieillesse… Une magnifique déambulation narrative dans l’atelier du peintre, un beau texte intime, en somme. Qu’est-ce qui vous touche surtout dans la vie, qui passe dans vos toiles, demande le journaliste. Ce qui me touche, c’est la beauté. Surtout la beauté… des hommes, répond Bacon. Éd. du Rouergue, coll. la Brune, 144 p., 14, 80 €. Corinne Amar
Marc Pautrel, Un merveilleux souvenir. C’est un récit bref, délicat, saisissant par son je-ne-sais-quoi, ce presque rien, ce style qu’on reconnaît dans tous ses romans et auquel nous a habitué son auteur. Cela commence par une rencontre chez son éditeur : il est inquiet, veut lui remettre un manuscrit qu’il vient de terminer, mais c’est selon lui, « une sombre intrigue familiale et trop difficile à lire, trop triste, cela affligerait les lecteurs ». Pas du tout, lui répondra son éditeur, au contraire, les histoires de famille c’est ce qu’il y a de meilleur. Sauf que ce dernier est catégorique : le manuscrit est excellent mais impubliable, confession terrible qui porterait atteinte à la vie privée d’autrui, ce serait donc le procès, la certitude d’être traînés en justice. L’auteur cherche à tergiverser, propose de prendre un pseudonyme, publier ailleurs, mais comprend que son éditeur – le même depuis quinze ans qui, toujours l’encouragea malgré le chaos régnant à écrire – bel hommage rendu au défunt Philippe Sollers - a raison. Alors, il va transformer, modifier son manuscrit, tenter de sauver quelque chose de ce qu’il avait à dire de « cette dévastation » violente qu’on lui interdit de dire, nous emmener sur d’autres sentiers : le souvenir - le merveilleux souvenir. Si les parents, étrangement, sont absents de ce journal, ce sont les trois personnages clés de sa vie dont il s’est séparé qui reprennent corps : sa jeune sœur adorée, sa grand-mère et son grand-père qui les ont élevés, et puis le lieu : cette maison qui était la leur où il avait sa chambre, son refuge, où il était chez lui, jusqu’à ce qu’il la perde aussi. Tout en touches douces, nostalgiques, il évoque ce qu’était la famille jusqu’à un certain point. Une allégorie du secret et de la perte, de ce qu’on voudrait dire mais qu’on ne doit pas dire : ce que le romancier dit malgré tout, au cœur des mots. Un texte aussi daté, car écrit à cette époque extraordinaire, si singulière qu’était le confinement, dans cet isolement total, que le monde entier aura vécu. Éd. Gallimard, 75 p., 12 €. Corinne Amar
Romans
Aki Shimazaki, Niré. Une clochette sans battant. Nobuki Niré, ingénieur civil, est un homme comblé. À trente-sept ans, il s’épanouit dans son travail et se réjouit, avec sa femme, professeur de piano, et leurs deux fillettes, de l’arrivée d’un troisième enfant. Il rend régulièrement visite à ses parents, installés dans une résidence pour personnes âgées. Fujiko, sa mère, atteinte d’Alzheimer, ne le reconnaît plus. Il ne sait pas toujours quelle attitude adopter avec elle, contrairement à sa sœur Anzu qui a su s’adapter à la situation. Fujiko avait soixante-cinq ans quand le diagnostic est tombé. Lui, en avait vingt-cinq et venait de rencontrer Ayako, sa future femme. Ses parents s’imaginaient que leur fils, une fois marié, vivrait sous leur toit, selon la tradition qu’ils avaient eux-mêmes respectée. Mais l’héritier de la famille avait d’autres projets. Avant lui, sa sœur Kyôko, l’aînée, avait déjà bousculé les principes de ses parents, par son féminisme et son indépendance. Un jour, une de ses filles remet à Nobuki un vieux cahier épais, trouvé dans un tiroir de son bureau d’enfant. Fujiko, sentant les signes de la maladie s’accentuer, avait décidé de consigner ses souvenirs. « Si je perds toute ma mémoire et que je ne reconnais plus personne, qui deviendrais-je ? Serai-je quelqu’un d’autre ? », s’inquiète-t-elle. Dans ce journal intime, commencé le jour de son soixante-quatrième anniversaire, elle confie sa peur, ses joies et ses frustrations passées et actuelles, parle de son quotidien avec son mari, de ses trois enfants, et veut se libérer du secret qu’elle porte depuis trop longtemps. Le fils prend la mesure de la sensibilité et des réflexions de sa mère, totalement inconnues de lui jusqu’alors. Aki Shimazaki, japonaise de naissance, établie à Montréal et qui écrit en français, dépeint avec subtilité la complexité des liens familiaux et la réalité de la société contemporaine japonaise. Sa langue dépouillée rend compte par petites touches délicates et pudiques de ce que les choses infimes du quotidien, la transmission, le temps qui passe ou nos attachements impriment en nous. Éd. Actes Sud, 144 p., 16 €. Elisabeth Miso
Cédric Sapin-Defour, Son odeur après la pluie. C’est une histoire d’amour entre un homme et son chien, de ces amours mystérieuses qui soudain emplissent le cœur, l’espace, nourrissent l’altérité. Un jour, le narrateur répond à une petite annonce dans un journal, se retrouve peu après propriétaire d’un bouvier bernois, ce chien dont il rêvait, rassembleur de tous les chiens qu’il avait pu croiser dans son existence : il l’appelle Ubac – du nom de ce versant à l’abri du soleil que chez lui, on appelle, l’envers, le revers : Ubac est cet être vivant qui devient son compagnon, doté d’une intelligence et d’une intériorité profondes, et qui va transformer sa solitude et les mille détails de son quotidien, réinventer ses propres lieux : « Avant Ubac, je m’estimais seul dans les forêts et les montagnes. Avoir un chien resserre le temps et en bouleverse les pulsations. » Faire se rencontrer deux êtres vivants et joindre leur histoire ; voilà l’histoire. Au-delà du lien sacré à l’animal, le roman séduit, bouleverse même, par la conscience aigüe du temps et du monde, auquel le ramène ce chien, leur proximité, leur fusion. L’homme apprend de l’animal, observe sa vision du monde, comprend que la sienne n’en est qu’une parmi d’autres. Né dans une famille d’enseignants en éducation physique, baigné avec son frère au grand air dès l’enfance, professeur lui aussi en éducation physique et voyageur au volant de son van, Cédric Sapin-Defour, féru de montagne, est aussi journaliste, écrit sur la montagne et l’alpinisme. Ce roman est aussi une histoire d’amour où l’humain à sa place ; bientôt, Mathilde, elle aussi, enseignant la même discipline, entre dans la vie du narrateur et d’Ubac, s’installe avec eux. Variant à l’infini les combinaisons, « Ubac et moi, Mathilde et Ubac, Ubac, Mathilde et moi », l’auteur rend compte de ce que vivre intensément veut dire. Les années passent, les rendez-vous chez les vétérinaires deviennent plus douloureux, le chien meurt plus vite que l’humain, et Ubac va mourir après treize ans de vie commune. Éd. Stock, 286 p., 20, 90 €. Corinne Amar
BD
Lucie Mikaelian, Jeanne Boëzec, Lisa Chetteau, Mes quatorze ans. Enquête sur ma découverte de la sexualité. En 2020, Lucie Mikaelian et Jeanne Boëzec créent le podcast « Mes 14 ans », inspiré du journal intime que tenait Lucie Mikaelian, quand elle était en troisième. Cette introspection d’une adolescente obsédée par la perte de sa virginité, prend aujourd’hui la forme d’une bande dessinée avec la collaboration de la dessinatrice Lisa Chetteau. La journaliste trentenaire, se penche avec tendresse et humour sur la jeune fille qu’elle était en 2003, sur la manière dont s’est construit son rapport à la sexualité, à son corps, au désir, son féminisme, bien avant l’impact du mouvement #MeToo. Elle habitait Paris, du côté de la Place de Clichy, était une élève brillante et espérait entrer au lycée Condorcet. Ses parents s’adoraient mais se disputaient fréquemment. Avec ses amies, elles s’interrogeaient beaucoup sur l’amour et la sexualité. « Il y avait quelque chose d’épuisant dans le fait de s’observer grandir. J’étais traversée par une multitude d’idées, d’espoirs, d’injonctions à intégrer et digérer. J’avais l’impression que le monde changeait, alors que c’était moi qui changeais. » Elle était partagée entre l’envie de s’abandonner totalement à l’amour et la volonté d’affirmer son indépendance, sa vision des choses. Ses héroïnes, Bridget Jones et Carrie Bradshaw étaient « La parfaite illustration de ce qu’il [lui] semblait devoir faire : être définie par des histoires d’amour, mais ne pas le dire trop fort pour ne pas paraître niaise aux yeux du monde. » Elle scrutait sa métamorphose physique, parlait sans tabous de ses fantasmes sexuels, du regard des autres, de ses craintes de ne pas être à la hauteur et était déterminée à faire l’amour avec Camille, rencontré sur SMN Messenger. Dessins et récit se complètent admirablement pour brosser le portrait d’une adolescente des années 2000. Lectures, goûts musicaux, style vestimentaire, idoles, amitiés, relations familiales, questionnements existentiels, premières expériences sexuelles ; chaque détail du quotidien vient éclairer ce moment charnière qu’est le passage de l’enfance à l’âge adulte. Éd. Gallimard, 192 p., 24 €. Elisabeth Miso