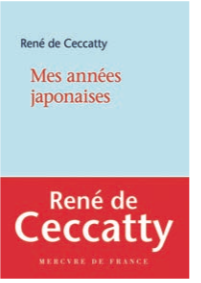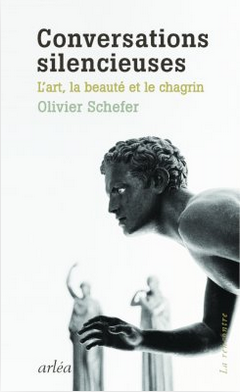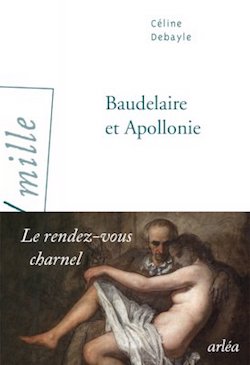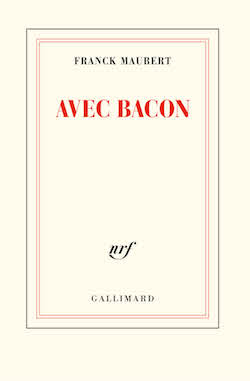Sarah Smarsh, Heartland. Au cœur de la pauvreté dans le pays le plus riche du monde. Traduction de l’anglais (États-Unis) Hélène Borraz. « J’ai commencé à prendre conscience du gouffre qui séparait mes origines des sphères du pouvoir américain lorsque j’ai quitté la maison à dix-huit ans. Il y avait quelque chose de particulier dans ma famille qui avait été volontairement passé sous silence dans l’histoire moderne de notre pays. » Cinquième génération d’agriculteurs du Kansas côté paternel, et descendante d’une longue lignée de mères-adolescentes côté maternel, la journaliste Sarah Smarsh a grandi à cinquante kilomètres de Wichita, la ville la plus proche, sur ce territoire des Grandes Plaines considéré comme arriéré, ignoré des régions les plus riches du pays. Le concept de classes sociales n’existait pas alors aux États-Unis. Toute son enfance, dans les années 1980 et 1990, elle a pu observer les humiliations, les souffrances physiques et psychiques engendrées par la pauvreté, les corps éreintés par un dur labeur, mal soignés, les corps violentés des femmes. Elle a assisté au déclin économique du monde ouvrier américain, au démantèlement du système public de santé, à l’abandon des écoles publiques, aux inégalités et à la précarité grandissantes. « Être rendu invisible en tant que classe est une invalidation. L’invalidation engendre un sentiment de honte. Un sentiment de honte aussi profond que cela – être pauvre dans un lieu rempli de récits sur les classes moyennes et supérieures – peut vous amener à croire que vous n’êtes qu’un échec. » Elle a lu dans les yeux des femmes de sa famille les frustrations, la colère, mais aussi une dignité farouche, un courage sans bornes, et une intelligence aiguë car « le fardeau psychologique de leur vie les a poussées à aller au plus profond d’elles-mêmes et à se comprendre et comprendre les autres. » La petite-fille qu’elle était a très vite compris que sa trajectoire personnelle ne serait pas sans embûches et qu’il lui faudrait une détermination sans faille pour s’arracher à son destin. Sarah Smarsh rend ici hommage aux siens, à leur rudesse, à leur tendresse, leur solidarité, leur humanité et leur poésie et démonte avec lucidité le mythe du rêve américain. La journaliste, spécialiste des questions économiques et sociales, notamment pour le Guardian et le New York Times, s’est bâtie une meilleure existence que celle de ses parents mais n’a pas fui son Kansas natal. « J’y reste par choix, dans une certaine mesure, et j’en apprécie les richesses qui m’ont façonnée – la liberté d’une enfance sans surveillance, l’absence d’expectatives, la connaissance profonde et éprouvée de mes propres aptitudes. » Éd. Christian Bourgois, 288 p., 22 €. Élisabeth Miso
René de Ceccatty, Mes années japonaises. « En juillet 1978, il y avait dix mois que j’étais au Japon. Et déjà tout était écrit. Tout, je crois. La fin de ma vie précédente, le début de mon autre vie et, d’une certaine manière, la fin de cette autre vie aussitôt. » En septembre 1977, à vingt-cinq ans, René de Ceccatty, s’installe avec son amie Cécile à Tôkyô. Il enseigne la littérature à l’institut franco-japonais, au lycée de Tôkyô et à l’Athénée Français, explorant dans ses cours la question de l’identité sexuelle à travers les textes de Jean Genet, Julien Green, Marguerite Duras, Violette Leduc ou Marcel Proust. Avant son départ, il a signé son premier contrat d’auteur. Avec Cécile il forme un couple atypique, ne dissimulant rien de son inclination homosexuelle. Ce semblant d’équilibre sentimental va être balayé par un « malheur évident, non pas sourd et sournois, mais d’une plénitude incontestable, éclatante, une plénitude d’orage. » L’auteur s’éprend de Ryôji, un de ses étudiants japonais, et cet amour va définitivement bouleverser son rapport au monde, au Japon et à sa sexualité. « Certains épisodes de ma vie, je les ai beaucoup remémorés, réécrits, nettoyés, transformés. Que reste-t-il d’authentique ? Je ne me fie même pas à mes rêves qui, désormais, s’appuient plus sur le souvenir de ma vie que sur ma vie même. Mon inconscient se nourrit d’approximations. » Pour tenter d’être au plus près de la vérité de ses années japonaises, de la personne qu’il était, René de Ceccatty s’est plongé dans ses notes de l’époque, dans ses carnets, dans les lettres adressées à sa mère (précieusement archivées par elle), lui qui a toujours perçu son existence comme « plus vraie écrite que vécue ». « Mes choix d’alors je peux les revisiter à la lumière de celui que je suis devenu », écrit-il, auscultant ses élans et ses échecs amoureux, son attachement à ses proches, sa collaboration intellectuelle fructueuse avec Ryôji. Naviguant entre passé et présent, il mesure le chemin parcouru, la connaissance de soi et des autres recherchée dans les traductions (de l’italien et du japonais), les livres lus, les correspondances assidues, la publication de ses propres livres et dessine un espace mental profondément façonné par la littérature, le Japon et l’Italie. Éd. Mercure de France, 247 p., 18 €. Élisabeth Miso
Olivier Schefer, Conversations silencieuses. L’art, la beauté et le chagrin. Enfant, Olivier Schefer passait un ou deux mercredis par mois chez son père. Il aimait leurs silences, leurs déjeuners dans la cuisine en compagnie des perruches, le temps passé en rêveries, à écouter la pluie, à se demander à quoi son père occupait son esprit enfermé dans son bureau, pièce intrigante remplie de livres, de disques, de dessins et de photographies encadrés, d’objets kabbalistiques. L’appartement de son père n’abritant ni télévision, ni bandes dessinées, sa curiosité se tourna vers les livres d’art consacrés à Piero della Francesca, Giorgione, Delacroix, Rembrandt, Titien, Picasso. Les animaux représentés qui « semblent attendre quelque chose, d’une façon qui leur est propre, mi-spectateurs de la scène, mi-acteurs » retenaient tout particulièrement son attention. « La fréquentation de ces volumes, le mercredi après-midi, m’apprit à aimer passionnément la peinture, non sans rage ni tristesse quelquefois. Depuis lors, je m’intéresse plus à l’œil fixe d’un cheval sacrifié dans La Mort de Sardanapale et aux deux chiens en laisse qui s’ennuient si étrangement au bas de l’immense toile de Paolo Véronèse, Les Noces de Cana, qu’au contenu narratif de ces œuvres célèbres », confie l’écrivain qui enseigne l’esthétique et la philosophie de l’art à l’Université Paris I. Ses premières émotions visuelles nées dans les livres d’art et dans les salles du Louvre se superposent aux réflexions sur la création de Giacometti, de Proust ou de Stendhal, dans un dialogue constant entre l’art et la vie. « La peinture est difficile à regarder et à aimer si un mouvement de la vie ne nous porte pas vers elle. » Éd. Arléa, 108 p., 17 €. Élisabeth Miso
Céline Debayle, Baudelaire et Apollonie, Le rendez-vous charnel. Le titre d’emblée séduit, pour peu que l’on soit inconditionnellement sensible à la poésie de Baudelaire, et comme lui, sous le charme de la personnalité de celle qui, courtisée par nombre d’écrivains, tenait un salon artistique à Paris que fréquentaient les grands noms de la littérature et des beaux-arts : Madame Sabatier. Lorsqu’il la rencontre pour la première fois, Baudelaire est captivé, et sa poésie immortalisera la Madone.
« Dès son arrivée, Baudelaire est ébloui. Depuis cinq ans, il admire ses contours parfaits, son exquise harmonie. Et ce soir, dans le vestibule aux oiseaux colorés et aux stores fleuris, plus que jamais la très-belle rayonne. » L’ensorceleuse, venue d’un milieu modeste, s’appelle Joséphine-Aglaé Sabatier qui se fait appeler Apollonie Sabatier, demi-mondaine, que ses amis appellent « La Présidente ». Entre le 9 décembre 1852 et le 8 mai 1854, Baudelaire écrit sept poèmes qu’il lui envoie de façon anonyme. Au poète, elle inspirera dix poèmes des Fleurs du Mal. Celui qui fut des années durant amoureux idolâtre de Madame Sabatier, celui qui voyait en elle, la Femme éternelle et déifiée, ne fut qu’une seule fois son amant, un 30 août 1857. À cette « femme trop gaie », dont il finira par se détacher, il conservera une sympathie éternelle, et de cet unique rendez-vous charnel dont peu de témoignage subsiste, l’auteure réinvente l’histoire. À partir de quelques lettres véritables échangées entre les amants, Céline Debayle explore les traces, imagine les soirs, les émois, les extases, décrit avec précision le vêtement, l’environnement, capte avec allégresse le dandysme de l’un, le bon goût de l’autre, et raconte comment cette personnalité remarquable qu’était Apollonie Sabatier que fréquentaient Flaubert, Théophile Gautier, les Goncourt, Nerval, hantera Baudelaire qui, comme pour Jeanne Duval et Marie Daubrun, lui offrit une large place dans son panthéon. Éd. Arléa, 158 p., 17 €. Corinne Amar
Franck Maubert, Avec Bacon. On connaît ses autoportraits, son visage écorché, malaxé, déformé, ses représentations de visages et de corps vus de l’intérieur – chairs en dégénérescence – sa liberté créatrice, ses couleurs adorées – les rouges, les bleus, les jaunes, les gras – ses obsessions : « Nous sommes de la viande, n’est-ce pas ? Quand je vais chez le boucher, je trouve toujours surprenant de ne pas être là, à la place des morceaux de viande. Lorsqu’alors, jeune critique d’art pour un journal, dans les années 80, Franck Maubert arrive à l’atelier de Francis Bacon, à Londres, il réalise enfin un rêve. « Rencontrer l’artiste, parler avec lui m’était devenu une obsession secrète. J’ai commencé par téléphoner à sa galerie londonienne, la Marlborough Fine Art. La réponse fut sans appel : Monsieur Bacon ne reçoit personne. Ce n’est qu’après avoir attendu plus de trois années, au moment où je m’y attendais le moins, en plein été – je m’apprêtais à partir pour la Grèce – que la voix frêle et pointue de Miss Valérie Beston de la Marlborough Fine Art m’annonça : Monsieur Francis Bacon vous attend en fin de semaine à Londres. » Ce n’est pas la première fois que l’auteur évoque sa fascination pour celui qui, selon lui, incarnait, plus que tout autre artiste, la peinture.* Souvenirs évoqués, moments retracés d’une rencontre mémorable qui se multiplie, donnant lieu à des observations, à des conversations en français, langue que Bacon maîtrisait parfaitement. Il parle de son travail, des peintres, de Picasso à Giacometti, de ses amitiés, de ses voyages, de ses lectures, de l’alcool... Il aime boire, manger, jouer, et il aime parler, il aime dépenser, se dépenser, sans tabou, tel qu’il est, joyeux, nihiliste, ivre sans regret. Et son haleine empeste l’alcool, dans les taxis du retour, pendant qu’il déclame des vers. Éd. Gallimard, 144 p., 15 €. (6 juin 2019) Corinne Amar.
*Franck Maubert, L’odeur du sang humain ne me quitte pas des yeux. Conversations avec Francis Bacon. Éd. Mille et une nuits, 2009.