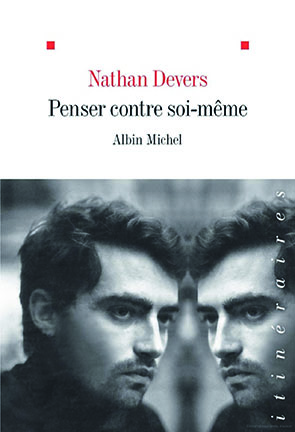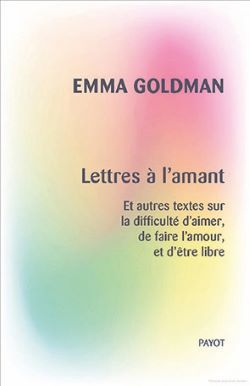Autobiographies
Miquel Barceló, La vida mía. « Majorque est mon île de naissance, je suis né d’elle. J’ai tout appris de mon enfance. La mer, c’est ma respiration. Mon corps fait partie de la nature. » Dans cet autoportrait, composé de textes, de pages de ses carnets, de photographies de ses peintures, de ses ateliers ou du Mali où il a longtemps séjourné, Miquel Barceló se penche sur son rapport au monde et à son art. « Peindre, nager, lire. C’est ce que je fais depuis toujours. », écrit-il. Pour lui, plonger ou peindre relève de la même expérience sensorielle, toile ou fond marin, il s’agit d’entrer dans une surface plane et de vivre quelque chose d’intense. Enfant, sa mère l’emmenait peindre dans la nature. Elle a abandonné la peinture pour la broderie et réalise toujours, à un âge très avancé, de grandes tapisseries d’après des dessins de son fils. Il a eu une relation compliquée avec son père qui lui a appris à reconnaître les poissons, les oiseaux et les arbres. Célèbre trop jeune, il a ressenti le besoin de s’échapper, de voir le désert. Il est parti dans le Sahara en 1986 et a exploré le Mali. La découverte du pays Dogon, en 1987, a été une véritable révélation. Ce lieu était comme fait pour lui, car profondément connecté à ses peintures, à l’île de son enfance avant qu’elle ne soit abîmée par le tourisme. Sa vision des choses en a été bouleversée. L’Afrique, avec sa cosmogonie particulière, sa beauté sidérante, s’est alors imposée comme la mesure de toute chose. Au fil des pages, l’artiste catalan convoque les objets, les animaux, les thèmes, les lieux qui habitent ses créations et son imaginaire, les peintres qu’il admire comme Picasso, Pollock, Le Tintoret ou celui de la grotte Chauvet. Il rappelle combien l’esprit et le corps sont totalement absorbés dans l’acte créatif. « C’est une pulsion, c’est sexuel, c’est du désir, il faut savoir être à l’écoute de ce désir. Et ne pas oublier qu’on l’a aussi fait enfant. C’est comme les vagues, ce ne sont jamais les mêmes, mais elles reviennent toujours, elles se ressemblent. » À quatorze ans, Miquel Barceló savait déjà qu’il vouerait sa vie entière à la peinture, et plus il peint, plus il mesure ce qu’il lui reste encore à accomplir. Éd. Mercure de France, Traits et portraits, 264 p., 35 €. Elisabeth Miso
Nathan Devers, Penser contre soi-même. « J’eus le hasard de naître avec une religion, et donc de faire dépendre l’abîme de l’être du vertige de Dieu. (…) Depuis l’illumination qui me marqua en allant à l’ENIO pour célébrer Kippour, j’ai toujours grandi dans l’idée que je serai rabbin. » De par son enfance juive parisienne au cœur du quartier d’Auteuil, Nathan Naccache reçoit une éducation orthodoxe, fréquente le centre communautaire, la synagogue, étudie l’hébreu, la Torah, le Talmud, part en voyage organisé à Jérusalem. Il est habité par la conviction profonde que son destin est de devenir rabbin : il veut devenir rabbin. Adolescent, au moment d’entreprendre des études rabbiniques, il prend conscience brutalement qu’il a perdu la foi. L’âme décapitée et le sentiment d’une solitude jamais vécue jusque-là le traversent, lors du mois qui suit sa rupture avec la religion. Ce monde d’assurance, de certitude existentielle s’écroule, tandis qu’il découvre la philosophie, telle une initiation au cheminement interne autrement, un éveil au doute et à la liberté. Nietzsche, Kant, Socrate, Heidegger, Rousseau, Hegel…, travailler, chercher, avancer dans sa quête, jusqu’au vertige. La philosophie va prendre racine en lui au fur et à mesure qu’il s’éloigne radicalement de la religion, perd des amis, des condisciples, entame une nouvelle vie. Il passe ses matinées dans les cafés à gribouiller des notes, écrire, lire, travailler, observer le monde. Penser contre soi-même – être curieux, douter, s’intéresser à l’autre différent de soi – nous dit-il, est une expérience d’altérité. Il s’agit d’apprendre à ne pas figer sa pensée. Décrivant sa trajectoire particulière, sa rencontre avec la littérature, l’écriture et la philosophie, l’auteur de vingt-six ans, normalien, agrégé de philosophie publie là son quatrième ouvrage. Au-delà de l’essai autobiographique singulier, lucide, éclairé, il raconte son engagement total en philosophie. Éd. Albin Michel, 326 p., 20,90 €. Corinne Amar
Biographies
Christophe Leclerc, Gary Cooper Personne n’est parfait. Gary Cooper (1901-1961) a grandi dans le Montana dans un milieu aisé. Ne parvenant pas à percer comme dessinateur de presse, il rejoint en 1924 un des ses amis cascadeur à Hollywood. Très bon cavalier, il débute comme figurant et cascadeur. Sans grande conviction, il fait ses premiers pas d’acteur et opte pour un style très naturel. Au début, nombreux sont ceux qui, insensibles à la sobriété de son jeu, ne voient en lui qu’une gravure de mode, un acteur sans envergure. Sous contrat avec la Paramount, il enchaîne les westerns, les drames et les comédies qui vont faire sa gloire : Morocco (1930), L’Adieu aux armes (1932), Sérénade à trois (1933). En 1931, épuisé par le rythme des tournages, il décide de prendre le large, le temps d’une parenthèse amoureuse en Italie avec la comtesse di Frasso et d’une expédition de chasse en Afrique. À son retour à Los Angeles, il pose ses conditions pour reprendre le chemin des plateaux. Des metteurs en scène comme Hathaway, Borzage, Walsh ou DeMille, conscients du magnétisme de son interprétation minimaliste, le mettent en valeur dans des rôles taillés pour lui. Incontestable star du box-office, il remporte deux Oscars pour Sergent York (1941) et pour Le Train sifflera trois fois (1952). S’il doute de ses talents d’acteur, dès ses débuts il fait des étincelles auprès des femmes, s’affiche avec ses conquêtes : Clara Bow, Lupe Vélez, Marlene Dietrich, Ingrid Bergman ou Patricia Neal. Malgré un mariage heureux avec Veronica Balfe (issue de la haute société new-yorkaise) et son attachement à sa vie de famille, il est un séducteur invétéré. À la fin des années quarante, il traverse une période difficile, aussi bien sur le plan professionnel que personnel. Puis prend à nouveau toute la lumière avec ses prestations dans Le train sifflera trois fois ou dans Vera Cruz (1954), avant d’être emporté par un cancer en 1961. Christophe Leclerc retrace le parcours jalonné d’élégance, d’intégrité et de modestie de cette légende du cinéma américain que son ami Ernest Hemingway décrivait en ces termes : « Si on inventait un personnage comme Coop, personne n’y croirait. Il est juste trop bien pour être vrai. » Éd. Capricci, 120 p., 11,50 €. Elisabeth Miso
Correspondances
Emma Goldman, Lettres à l’amant - Et autres textes sur la difficulté d’aimer, de faire l’amour et d’être libre. Textes choisis, traduits de l’anglais (États-Unis) et préfacés par Léa Gauthier. Elle pratiqua la révolution comme mode de vie, au cœur de la philosophie anarchiste, obsédée par les droits des femmes et les luttes sociales. À l’âge de trente-huit ans, elle tremblait de désir, « happée par le torrent d’une passion élémentaire » dont elle n’eût jamais pu soupçonner l’intensité de plaisir ni la joie extatique. Sa relation amoureuse dura neuf ans, mais il lui fut difficile de partager son engagement et son éthique profondément anarchistes, tout en œuvrant pour être libre et assumer sa sexualité. « Jeudi dernier, c’est la journée la plus horrible de ma vie, le jour des plus grandes humiliations. J’ai vu que ce que tu appelles amour n’était qu’un caprice à satisfaire quel qu’en soit le prix. J’ai aussi vu qu’à moins de me soumettre à ce caprice je n’avais pas de place ni dans ta vie, ni dans ton humanité, ni dans ton estime. » Qui était-elle, Emma Goldman (1869-1940) qui prend conscience soudain que ce qu’elle vient de subir, d’humiliation, de domination, ne se reproduira plus jamais dans sa vie ? Une intellectuelle née en Russie, qui émigra aux États-Unis dès l’âge de seize ans, rejoignant le mouvement anarchiste à New-York en 1889 ; une fauteuse de troubles connue pour ses discours radicaux féministes, en empathie avec les démunis, révoltée controversée, emprisonnée à plusieurs reprises pour « incitation à l'émeute », qui sut se battre et se faire entendre pour imposer ses idées. Ce recueil s’ouvre sur six lettres qu’Emma écrit à son amant au début de leur relation dans les années 1908 ; Ben Reitman, médecin des pauvres qui pratiquait des avortements clandestins, de dix ans son cadet, personnage charismatique et hautement libertaire. À ces lettres, succèdent neuf textes – extraits de Journal, articles qu’elle écrivit ou discours qu’elle tint – qui nous font découvrir l’intensité de la vie d’une personnalité hors pair. Éd. Payot & Rivages, 172 p., 9,50 €. Corinne Amar
Essais
Jennifer Kerner, Le mari de nuit. Expériences du deuil et pratiques funéraires. Jennifer Kerner, docteure en archéologie, a beaucoup appris des « morts en les étudiant et en écoutant ceux qui les connaissent le mieux. Tout autour du monde, la consigne est claire : la communication entre les vivants et les défunts ne doit jamais être totalement rompue. » Entre essai et récit intime, elle partage sa passion pour les rites funéraires dans les civilisations anciennes et contemporaines, fruit de quinze ans de recherches à travers l’espace et le temps. Quinze ans d’un deuil personnel aussi. À dix-huit ans, elle perd son grand amour, J. décédé d’une overdose. Ne pouvant se raccrocher à aucun rituel particulier, elle se retrouve complètement désemparée face à sa douleur. Elle s’envole pour l’Inde, avec l’espoir de comprendre comment ailleurs, on apprivoise le chagrin et le deuil. Dans l’Himalaya, elle découvre ce lieu de pèlerinage qu’est le lac glaciaire de Roopkund ou « lac des squelettes ». Devant ces centaines d’ossements, sa vocation d’archéologue est née et elle n’a eu de cesse depuis de sonder les comportements humains face à la mort. Jennifer Kerner nous fait voyager au cœur de toutes sortes de croyances, de pratiques mortuaires, d’hommages rendus aux disparus et de soins apportés aux endeuillés. Chez les populations traditionnelles, les ancêtres protègent leurs descendants et réciproquement. Bien accompagner le défunt dans son passage vers l’Autre Monde est essentiel et allège la souffrance de ceux qui restent. La manière dont nous maintenons à distance la mort dans nos sociétés occidentales, pose véritablement problème. Le livre est un dialogue constant avec J., un geste de libération mutuelle. Où qu’il se trouve, il peut reposer en paix, maintenant qu’il a l’assurance que le deuil est fait et qu’ils veilleront l’un sur l’autre. « (…) durant toutes ces années, je t’ai cherché partout : entre les mottes de terre de chaque site archéologique que j’ai fouillé, sous les roches des zones désertiques d’Amérique et d’Afrique, dans le vol des rapaces qui fendent l’air chargés du souvenir de toi. J’ai fouillé les cœurs des autres endeuillés pour en extraire l’encre de ce récit. » Éd. Gallimard, 224 p., 20 €. Elisabeth Miso