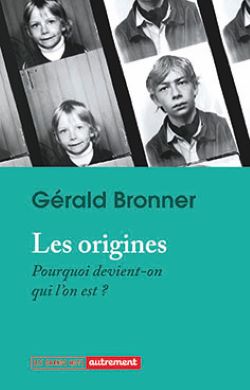RÉCITS
Laura Alcoba, Les rives de la mer Douce. Un après-midi de mars 2021, alors que Laura Alcoba longe la rive droite de l’Aven entre Pont Aven et le Moulin du Hénan, elle est saisie par la poésie d’un motif du paysage. À une heure très précise avant la marée haute, la partie émergée d’un rocher et son reflet dans l’eau y forment un cœur bien visible. À des milliers de kilomètres de là, un autre lieu, où l’eau douce rencontre aussi l’océan, comme dans ce coin du Finistère sud, a déposé en elle des images et des sensations puissantes. C’est le Río de la Plata, ce fleuve si vaste qu’on ne peut distinguer l’autre rive. « (…) dans mon imaginaire, dans mon paysage mental, il reste à tout jamais associé à la mémoire. Pas seulement parce qu’il a été mon premier fleuve. Ma première eau douce. Mais parce que, comme la mémoire, il se déploie de manière concentrique. » La romancière et traductrice garde profondément ancrés en elle, des souvenirs de son enfance en Argentine. Un voyage d’été à cinq ans avec ses parents dans les Andes, au pied de la colline aux Sept Couleurs, brille toujours du même éclat. « Ce coin des Andes, c’était la douceur et la beauté du monde d’avant la violence. » En 1976, elle a sept ans, vit à La Plata avec ses parents, tous deux journalistes. Les disparitions d’opposants politiques se multiplient. La famille déménage et sa vie bascule dans la clandestinité, elle comprend très vite que le danger est partout et qu’elle doit se taire. Son père emprisonné, sa mère et elle s’installent un temps chez Daniel et Diana, dans la maison aux lapins qui abrite une imprimerie clandestine. Elle apprendra quelques années plus tard, qu’ils ont été assassinés par la junte militaire et que leur bébé a été enlevé. Une fois séparée de sa mère qui a dû fuir en Europe, Laura Alcoba navigue entre l’univers bourgeois de ses grands-parents maternels et la banlieue ouvrière de ses grands-parents paternels. « Durant ces années passées à La Plata, entre ces deux maisons si différentes, l’école et les visites en prison, le silence était partout. Pour passer d’un espace à l’autre, je prenais de grands tunnels silencieux et n’emportais rien de l’autre côté. » En 1979, à dix ans, elle rejoint sa mère en France et échange des lettres avec son père jusqu’à sa libération en 1981, une correspondance déterminante dont elle a déjà tiré le fil dans Le bleu des abeilles et La danse de l’araignée. Laura Alcoba compose un délicat récit autobiographique au gré des mouvements de sa mémoire. Des lieux, des visages surgissent d’ici ou de son Argentine natale, dessinant les contours d’une sensibilité façonnée par la douceur, la violence et le passage d’une rive à l’autre, d’un monde à l’autre. Éd. Mercure de France, Traits et portraits, 200 p., 17 €. Élisabeth Miso
Bruno Pellegrino, Tortues. « J’ai peur de ma mémoire. Il me semble parfois que si je me retourne, il n’y aura derrière moi qu’un gouffre sans lumière, et cette pensée me terrifie comme peu d’autres. », confie Bruno Pellegrino dans son nouveau livre, sorte de condensé de sa hantise de la perte et de son obsession de l’allègement. Enfant il se lançait régulièrement dans un grand rangement de sa chambre, rassemblant dans un tiroir de son bureau les objets les plus précieux à ses yeux, ceux à sauver absolument en cas d’incendie. Il a commencé à écrire à sept ans et demi, dans un petit classeur bleu offert par sa mère, et n’a plus cessé de remplir des carnets. « J’appelais ça la paperasse, en soupirant, mais je tenais à ces pages, ou plutôt ce sont elles qui me tenaient, elles témoignaient que quelque chose avait eu lieu. » Toutes ces traces écrites se dressaient comme un rempart contre l’oubli, et ce livre procède de la même tentative. L’auteur romand y sonde les ressorts mystérieux de la mémoire et la part de fiction, de reconstruction mentale inévitable, que renferme tout récit autobiographique. Ne plus se souvenir du voyage en Turquie, effectué à l’âge de huit ans, génère chez lui un sentiment d’angoisse. Alors qu’une quantité d’images très nettes des vacances en famille en Angleterre, se bouscule, auréolant l’été de ses douze ans d’un bonheur parfait. Qu’il convoque des évènements intimes, se documente compulsivement sur l’écrivain Friedrich Dürrenmatt, une poétesse inconnue, trie les archives d’une écrivaine suisse décédée, ou se plonge lors d’une résidence d’écrivain au château de Lavigny, dans la comptabilité domestique de l’ancienne propriétaire anglaise; ce qu’il cherche inlassablement c’est « esquisser la vérité d’une personne ». Depuis ses dix-sept ans, pour ses études ou pour des raisons professionnelles, il a vécu à l’étranger et déménagé à plusieurs reprises, et s’est aperçu que ses « souvenirs avaient adopté une organisation géographique. » Au fil de ses déplacements, il a appris à se délester, à éliminer des objets, à apprivoiser sa peur de l’effacement, à se rapprocher du point d’équilibre visé : « Garder peu de choses, mais pour toujours. » Éd. Zoé, 144 p., 16,50 €. Élisabeth Miso
ROMANS
Marie-Hélène Lafon, Les sources. « Il dort sur le banc. Elle ne bouge pas, son corps est vissé sur la chaise, les filles et Gilles sont dans la cour, ils savent qu’il ne faut pas faire de bruit quand il dort. » Ainsi commence le roman, et la tension qui domine dans le récit sans doute se perçoit-elle dès les premières lignes. Il, c’est le père, elle, la mère, et puis, il y a les enfants. Nous sommes à la fin des années 60, au cœur d’une ferme isolée du Cantal – théâtre de nombreux romans de Marie-Hélène Lafon. C’est l’histoire intime d’une famille « en apparence normale », dans l’une de ces régions rurales où il faut faire semblant devant les gens. La mère est jeune encore. Son corps qu’elle observe « saccagé » par la vie lui est devenu lourd, étranger. « Trente ans, trois enfants, Isabelle, Claire et Gilles, deux filles et un garçon, sept, cinq et quatre ans, une ferme, une belle ferme, trente-trois hectares, une grande maison, vingt-sept vaches, un tracteur, un vacher, un commis, une bonne, une voiture, un permis de conduire. » On pourrait penser que c’est une chance, que tout est heureux. Ils se sont connus avant qu’il ne s’en aille au Maroc faire son service militaire, se sont mariés à son retour, en 1959. Hélas, c’est un calvaire qui démarre « aussitôt après le mariage », il est violent. Pour tenir, elle fait des listes, se concentre, s’accroche à ses enfants, a peur mais n'a pas la force de partir. Dans une deuxième partie, un saut dans le temps nous mène au dimanche 19 mai 1974, jour de l’élection de Valéry Giscard d’Estaing, et fait parler le père, tente de l’humaniser. Un troisième chapitre nous conduit au jeudi 28 octobre 2021 où Claire, la plus jeune des filles (double de l’auteure ?) ferme la maison paternelle, vendue, où elle ne reviendra plus. Une heure plus tard, elle a rendez-vous chez le notaire avec sa sœur et son frère pour signer l'acte de vente de la maison. La page est tournée, il faut vivre. Éd Buchet-Chastel, 128 p., 16,50 €. Corinne Amar.
Claire Baglin, En salle. C’est un premier roman très remarqué où, en deux récits qui s’alternent, l’auteure revient sur son enfance, évoquant la figure du père, ouvrier en usine et son présent à elle, embauchée pour l’été comme équipière dans un fast-food. Une époque se dessine, bribes du passé et du présent font résonance. Ainsi reviennent les souvenirs joyeux d’escapades, enfant, en famille au fast-food, cadeau du père pour qui, dans cette famille modeste, chaque centime compte ; les souvenirs alternent avec les vingt ans de la narratrice expérimentant un travail dans ce même type de fast-food. Et pourquoi ici plutôt qu’ailleurs ? Je suppose que vous avez postulé partout, même chez nos concurrents, sonde celui qui fait passer l’entretien, et le roman s’ouvre sur cette question qui fait durer le suspense. Le directeur fera la visite au quart de tour, jusqu’à la fameuse cuisine. « La grosse pointeuse, au centre de la cuisine. Elle indique l'heure, il faut scanner sa carte, indiquer qu'on entre, qu'on sort, la pointeuse dit bonjour quand on entre et se tait quand on sort. Chaque fois qu'une carte est scannée, la pointeuse fait le bruit d'un flash d'appareil photo. » L’auteure décrit autant qu’elle fait sentir, l’univers dans lequel elle se retrouve plongée : la formation tyrannique, le rythme effréné des cadences, le sol sous les pieds constamment humide, la cuisson des frites, l’odeur du gras, du sol, et puis, les codes et le langage propre aux chefs. C’est les mana (managers) qui exercent leur pouvoir, les tâches redoutées ou enviées, la détestation de la salle. À cela, surgissent des images des vacances en camping, quand la voiture des parents se garait devant le lieu élu, le petit frère et elle, impatients, heureux, entre un burger, des frites et un jouet, le père embarrassé par les prix, le choix… Les phrases sont courtes, les descriptions précises, les souvenirs choisis, qui donnent à ce roman, une lumière à la fois intimiste et sociologique. Éd. de Minuit, 160 p., 16 €. Corinne Amar
ESSAIS
Gérald Bronner, Les origines. Pourquoi devient-on qui l’on est ? Gérald Bronner, a grandi dans un milieu modeste de la banlieue de Nancy et n’a vraiment réalisé qu’il était pauvre qu’à l’adolescence. « Le rapport narratif que nous construisons entre nos origines et notre point d’arrivée peut être un ravissement ou une douleur. Il dépend de faits objectifs tout autant que des fictions de nous-mêmes que nous avons à tort ou à raison endossées dans notre construction identitaire. » Le sociologue et professeur à la Sorbonne se penche ici sur les mécanismes et les mythogenèses à l’œuvre dans l’élaboration de notre identité, dans notre conscience de nous-mêmes et de notre trajectoire. S’appuyant à la fois sur son histoire personnelle de « transclasse » et sur une démarche sociologique étayée, il démonte les stéréotypes, les raccourcis idéologiques ou déterministes, qui enferment la notion d’identité dans le seul prisme des origines. Même si le contexte familial et social a un impact indéniable, d’autres facteurs entrent en ligne de compte : le patrimoine génétique, le tissu amical, professionnel, le hasard… Il ne se reconnaît pas dans la narration doloriste autour du « transclasse », déployée par Annie Ernaux ou Édouard Louis. Même s’il avoue avoir parfois été embarrassé par les signes extérieurs du manque d’argent, il n’a jamais ressenti de honte pour son milieu. C’est parce qu’il se percevait comme singulier, pas à sa place, qu’il s’est mis à rêver, à stimuler son imagination et à se projeter dans d’autres possibles. La France est l’un des pays les plus reproducteurs d’inégalités sociales, aussi invite-t-il les plus jeunes à ne pas se couper de leurs ambitions par une vision fataliste de leurs racines sociales ou se laisser berner par des espoirs de réussite facile. « C’est cet écart entre ce que nous croyons pouvoir désirer et ce qui est véritablement accessible qui définit l’espace de la frustration collective : c’est une matière sociale explosive. » Il n’est pas dupe de la fiction de la méritocratie brandie par les politiques et croit fermement aux chances d’ascension sociale qu’offre l’école. Gérald Bronner, se définit davantage comme un « nomade social », qui a pu accéder à un autre horizon, à d’autres modèles et à une meilleure compréhension de lui-même grâce à la diversité des ses interactions sociales. C’est pourquoi, il milite pour que la mixité sociale devienne « un objectif prioritaire de la recomposition des territoires » et pour une analyse beaucoup plus complexe de nos représentations mentales et de notre besoin de récits. Éd. Autrement, 192 p., 19 €. Élisabeth Miso