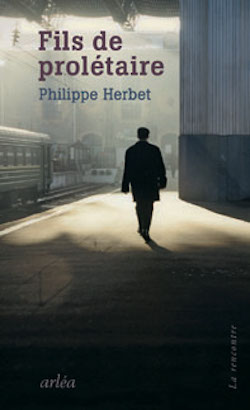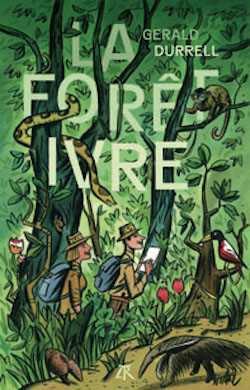RÉCITS
Norman Rosten, Marilyn, Ombre et lumière. Traduction de l’anglais (États-Unis) François Guérif. Marilyn Monroe est entrée dans la vie de Norman Rosten un jour de pluie. Elle accompagnait le photographe Sam Shaw, qui avait téléphoné pour se mettre à l’abri. Norman Rosten et sa femme Hedda ne reconnurent pas la jeune femme aux cheveux mouillés qui prenait place timidement dans leur salon de Brooklyn. Son nom était pourtant sur toutes les lèvres depuis l’énorme succès de Sept ans de réflexion. Ainsi débuta la profonde amitié qui devait unir le couple à la star de 1955 à sa mort en 1962. Au printemps 1955, elle s’était installée depuis peu à New York. Tout juste divorcée de Joe DiMaggio, elle cherchait à donner une nouvelle direction à son existence, loin des studios d’Hollywood, de son image de sex-symbol. Elle suivait les cours de Lee Strasberg à l’Actors Studio, voulait être considérée comme une véritable actrice, s’intéressait à l’art, à la littérature, à la poésie, écrivait elle-même des poèmes qu’elle faisait lire à son nouvel ami et était irrésistiblement attirée par Arthur Miller. Dans ce délicat et émouvant hommage publié en 1973, le poète et romancier, dévoile une Marilyn intime, lumineuse, généreuse, fine, avide de connaissances et de chaleur humaine, mais aussi tourmentée car terriblement marquée par les manques affectifs de son enfance. Être en sa compagnie n’était pas de tout repos, elle captait tous les regards et pouvait déclencher des comportements de fans inquiétants. « Partout où elle allait, il y avait un risque d’incident. Parce que tout pouvait arriver quand elle était là, où que ce soit. Une explosion. Rien qu’elle et l’air ambiant. Pas besoin d’allumette, la combustion était spontanée. » Norman Rosten égrène quelques moments précieux partagés dans des musées, des galeries, des dîners à Manhattan, des vacances et des week-ends à Long Island ou dans la maison de campagne de Miller dans le Connecticut. Il se souvient de sa sensualité renversante, de son pouvoir de séduction, de son âme d’enfant dans un corps de déesse. « Elle aimait que les hommes la désirent ; cela l’amusait, la flattait et l’excitait. Elle avait besoin de cette preuve qu’elle était adorée ; cela contrebalançait la crainte qu’elle avait de ne pas être désirée, le traumatisme de l’enfant illégitime et abandonnée par sa mère. Elle voyait l’amour comme le miracle caché dans toute vie humaine. L’amour faisait de vous un être équilibré – si on avait la chance de le trouver. » Ébranlée par l’échec de son troisième mariage, Marilyn repart en Californie, en quête d’un nouveau souffle personnel et professionnel. Jusqu’au bout, Norman Rosten, indéfectible soutien, répondra à son besoin impérieux d’être aimée et tentera de l’arracher à ses démons. Éd. Seghers, 128 p., 16 €. Élisabeth Miso
Philippe Herbet, Fils de prolétaire. Quand il était enfant, le photographe Philippe Herbet n’arrivait pas à croire qu’il était bien le fils biologique de ses parents, tant il ne se reconnaissait pas en eux. Il a grandi en Belgique, dans les années 1960-1970, dans une famille modeste d’une ville industrielle. Son père était mécanicien dans une usine métallurgique, sa mère « femme d’ouvrage ». Le quotidien était terne, bien réglé, sans fantaisie. À l’école puis au collège, on moquait sa maladresse, son œil gauche fermé. Ses parents, inquiets pour lui, le couvraient d’injonctions. Sans vraiment parvenir à les décrypter tout à fait, il percevait déjà leurs frustrations, leur manque d’assurance sociale, le poids du temps qui ne s’écoule pas, l’absence du sentiment d’exister. Il s’est beaucoup réfugié dans son imaginaire, partait à l’aventure en DS blanche en compagnie de Jim, un ami idéal. Quand il séjournait chez ses grands-parents paternels, il résistait au sommeil pour ne pas rater les trains de nuit filant vers Paris, Berlin, Varsovie et Moscou. L’auteur était très proche de son grand-père, disparu prématurément, qui lui racontait ses années de captivité en Allemagne et lui faisait écouter la mer dans un coquillage rapporté de son unique escapade en bord de mer du Nord. Il a appris à lire et commencé à voyager dans les albums de Tintin que lui lisait son père. Il concrétisera ses rêves d’évasion vers l’Est, adulte, grâce notamment à ses projets photographiques. Philippe Herbet se souvient de son désir fort d’ailleurs, de sa volonté d’échapper à son milieu, mais laisse aussi affleurer sa tendresse, son profond attachement aux siens. « Nous passons une grande partie de notre existence à nous différencier, à nous écarter de l’orbite familiale. Une longue ellipse se trace avant que nous revenions au point de départ. Point où il nous est donné de les rencontrer enfin, nos parents. » Éd. Arléa, 100 p., 15 €. Élisabeth Miso
Gerald Durrell, La Forêt ivre. Traduction de l’anglais Mariel Sinoir, révision entière Leïla Colombier. En 1954, Gerald Durrell (1925-1995), le frère cadet de Lawrence Durrell, entreprend avec sa femme Jacquie un voyage de six mois en Amérique du Sud. Ils doivent constituer pour les zoos anglais une collection d’oiseaux et d’animaux rares à protéger. Ils envisagent d’explorer la Terre de Feu puis de séjourner au Paraguay avant de regagner Buenos Aires par les rivières Paraná et du Paraguay. Dès leur arrivée en Argentine, ils sont contraints de modifier leurs plans. Direction la côte, à une centaine de kilomètres de la capitale où le naturaliste-écrivain se délecte de la diversité d’oiseaux qu’abritent les terres marécageuses de la pampa. « Enivré par la magnificence de ce banquet avifaune, je sombrai dans une sorte de stupeur ornithologique, ne voyant plus que chatoiements de plumages, éclaboussements sur l’eau lisse et mouvements d’ailes. » Premières découvertes enthousiasmantes avec Eggbert le kamichi, l’oiseau le plus comique qu’il ait jamais vu et les Jumelles Infernales, deux gros tatous. Le couple s’envole ensuite vers la forêt du Chaco au Paraguay, poumon vert à la faune et à la végétation exceptionnelles mais infesté de moustiques. Ils établissent leur base dans le village de Puerto Casado et aidés par les Indiens des alentours, ils réunissent en quelques mois une ribambelle d’animaux plus étonnants les uns que les autres. « Il est rare que dans une collection d’animaux l’on ne s’attache pas particulièrement à l’un ou deux d’entre eux. Non pas en raison de leur rareté ou de leur étrangeté, ni même de leur intelligence, mais plutôt de quelque chose qui échappe à l’analyse et vous séduit dès les premiers instants. Ils possèdent un rayonnement et un charme qui les sortent du lot et en font les mascottes d’un camp. » Les Durrell craquent tout particulièrement pour Cai la guenon douroucouli, Pooh le raton crabier, Lindo le faon, Foxey le renard gris de la pampa et Sarah le tamanoir. Leurs journées sont bien remplies, entre la construction et le nettoyage des cages, les soins et les menus à composer selon les besoins de chaque espèce. Gerald Durrell décrit avec l’humour qui le caractérise, les rencontres savoureuses, les comportements de leurs petits protégés, les satisfactions et les mésaventures inhérentes à ce genre d’expédition. Un coup d’État vient contrarier leurs projets, les obligeant à quitter rapidement le Paraguay et à laisser derrière eux la quasi totalité de leurs merveilles animalières. Éd. de la Table Ronde, 256 p., 14,50 €. Élisabeth Miso
Lucas Menget, Nages libres. Piscine ou mer, été, hiver, Paris ou bleus du bout du monde, c’est l’histoire d’un homme qui nage. Histoires d’eaux en toutes saisons que peuvent comprendre ceux qui aiment l’eau telle une attraction ; histoires de nageurs, nageuses légendaires tels des modèles à lire, à suivre. Et un parti pris de mêler des fragments de vie et de journal, la littérature, la petite et la grande Histoire – pays en guerre traversés au gré des reportages – Bagdad, Israël, la Colombie… où il trouvait le temps de longueurs salvatrices dans les piscines des hôtels. Histoire enfin, de la natation, dont l’auteur nous apprend qu’à la fin du XIXe siècle, elle n’était pas encore considérée comme un sport mais comme un divertissement. À Paris, à la piscine Keller, collégien, il s’entraîne – « je nage pour devenir un homme », la vie est belle encore, et la guerre, loin – avant de devenir le reporter de guerre qu’il sera. Chez lui, dans le Finistère nord, quel que soit le temps, la température, le vent, à l’heure de la marée haute, il part nager, « j’ai toujours un maillot dans mes affaires ». Ivresse merveilleuse et douloureuse, plaisir et ascèse, discipline, en un mot. « Brasser la langueur de la mer au petit matin, c’est ouvrir son corps, ramener l’eau le long de soi, immerger sa tête, glisser le plus loin possible, puis la sortir pour respirer, et en un éclair embrasser la vue. Il n’y a rien de plus sensuel que la brasse. » Il évoque les deux bains du matin tôt et du soir, dans une petite île de la mer Egée, leur volupté. Mais il y a aussi, et par-dessus tout, le rapport à l’eau froide, les premières secondes racontées comme une lutte, ce tiraillement bien connu entre la peur du froid et la témérité du plaisir, ce froid qui pétrifie, tel un shoot – en sortir au plus vite – jusqu’à ce que le corps se familiarise avec cet état de liberté intense et jouissive, et goûte enfin au Graal. Éd. Équateurs, 157 p., 17€. Corinne Amar
ROMANS
César Morgiewicz, Mon pauvre lapin. Il vient d’avoir un accès de panique dans le grand amphi de Sciences-Po, et il est parti en courant. Fini l’ENA, les concours, les grandes ambitions. Chez lui, il tourne en rond comme un poisson oppressé dans un bocal trop étroit. Elle l’appelle, mon pauvre lapin. Elle, c’est sa grand-mère, celle chez qui il trouvera refuge en prenant un vol pour Key West, en Floride, où elle mène la belle vie dans sa grande maison secondaire, en compagnie d’autres veuves, tout aussi bonnes vivantes et fantasques qu’elle. Désemparé, il se dit qu’écrire un livre l’occuperait. Et c’est ainsi qu’il nous raconte sa vie. D’aussi loin qu’il se souvienne, c’est un anxieux doublé d’une émotivité d’hypocondriaque, un enfant complexé qui souffre de son gros nez et de son appareil dentaire, et développe des manies plus ou moins guérissables. Ses parents divorcent, ce qui n’arrange rien, et il voit défiler dans les appartements de l’un ou de l’autre, belles-mères et beaux-pères, jusqu’à ce que le bon vienne carrément s’installer chez sa mère avec ses deux ados, et que l’idée de quitter Paris trop cher pour aller tous vivre à Montreuil surgisse. L’enfer, c’est les autres ! Surtout qu’il aurait bien aimé avoir moins de tares et une copine. Au lieu de ça, il squatte la chambre de bonne de chez sa grand-mère, rue du Bac, la semaine, et le week-end, il hésite à aller chez sa mère, à Montreuil. « C’était soit ça, soit passer la soirée seul avec ma boîte de sardines. Quand j’arrivais à Montreuil j’étais le messie, ma mère et ma petite sœur me couraient dans les bras en poussant des cris. « Est-ce que tu veux un verre de lait d’avoine pour l’apéro ? » Elles s’asseyaient toutes les deux sur le canapé en face de moi et elles me regardaient avec un sourire béat ». Bref, un jeune homme empêché qui ne demande qu’à prendre son envol. Un premier roman, désopilant, doué d’humour et de sensibilité, une touchante prouesse littéraire. Éd. Gallimard, 240 p., 19 €. Corinne Amar
REVUES
Les Moments littéraires n°48. La revue de l’écrit intime. 2ème semestre 2022.
Dossier Yves Charnet
Normalien, auteur d’une thèse sur Baudelaire, Yves Charnet enseigne les arts et cultures à SUPAERO.
Dès Prose du fils, publié en 1993, la poésie dans la prose de soi est sa marque de fabrique.
Son œuvre est essentiellement à caractère auto-biographique. Sans filtre, il explore à ses risques et périls et à longueur de livres, son moi à ciel ouvert. « J’essaie de faire passer les mots, comme on doit le faire avec un taureau, de plus en plus près de moi. Toréer près, écrire près ; au risque des blessures, en faire un art », dit-il.
Ses livres sont une tentative d’épuisement du sujet Yves Charnet. Il ressasse et retisse son enfance, l’absence du père, ses effondrements, l’emprise de sa mère (son « enfermaman »), sa difficulté à trouver sa place. Le ressassement comme une dynamique du sujet, une énergétique de la mémoire.
Le dossier Yves Charnet :
Autopsyves de Sarah Chiche
Entretien avec Yves Charnet
Carnets d’un été détraqué de Yves Charnet
Également au sommaire du n°48
Marie Mons : entretien & portfolio
L’intime, avec l’autoportrait comme composante principale, est au centre de l’œuvre de Marie Mons, photographe et vidéaste. Paysages et contrées personnelles résonnent dans l’ensemble de son travail pluridisciplinaire.
Paule Régnier : Journal 1947-1950
Paule Régnier (1888-1950) est une femme de lettres française. Atteinte d’une tuberculose osseuse à 18 mois, elle restera bossue. Elle gardera secret son amour pour l’écrivain Paul Drouot. Son roman L’Abbaye d’Évolayne a obtenu le Grand Prix du roman de l’Académie française en 1934. Jusqu’à quelques jours avant sa mort, elle a tenu son journal « pour se libérer de ce sang qui l’étouffe ». Elle se suicidera en décembre 1950. Le journal de Paule Régnier est introduit par Michel Braud, professeur de littérature française du XXe siècle à l’Université de Pau et des pays de l’Adour.
Maël Renouard : Nouveaux fragments d’une mémoire infinie - IV
L’auteur de La Réforme de l’opéra de Pékin, prix Décembre 2013, nous propose quelques-uns de ses Nouveaux fragments d’une mémoire infinie où il continue à s’interroger sur le rapport entre mémoire personnelle et mémoire numérique.
Jean-François Bourgain : Journal
Docteur ès lettres, Jean-François Bourgain a enseigné la langue et la littérature françaises à l’ESPE de l’académie de Rouen. Il nous livre quelques pages de son journal qu’il tient depuis plusieurs décennies.
Les chroniques littéraires d’Anne Coudreuse
https:lesmomentslitteraires.fr
Présentation de l’éditeur