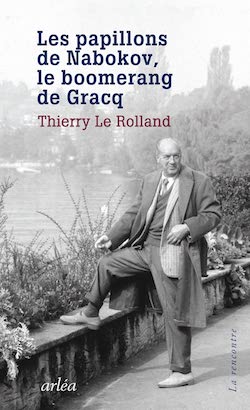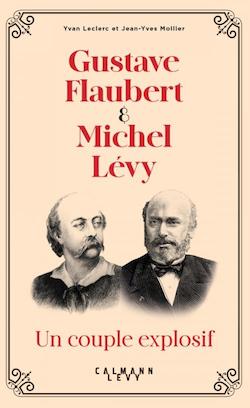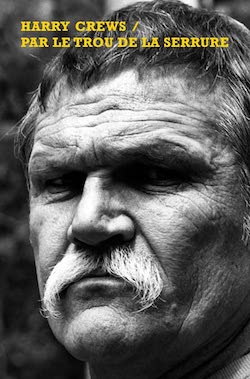BIOGRAPHIES
Sébastien Gimenez, Jean Gabin. Maintenant je sais. Sébastien Gimenez, scénariste et auteur de chansons, retrace le parcours de Jean Gabin, du héros tragique et romantique de ses débuts à la figure de patriarche autoritaire de ses derniers films, révélant l’homme derrière l’acteur légendaire. Jean Alexis Gabin Moncorgé, né en 1904, a grandi à la campagne dans le Val d’Oise et nourrira toute sa vie un amour pour la terre. Il n’a jamais souhaité suivre les traces de ses parents, tous deux artistes de music-hall (sa mère a renoncé à sa carrière de chanteuse pour s’occuper de sa progéniture). Enfant il se rêvait conducteur de locomotive ou fermier. À dix-huit ans, espérant convaincre son père qu’il n’a aucune aptitude pour le métier de comédien, il accepte une place de figurant aux Folies Bergère. Avec sa bonne humeur, son regard enjôleur, sa rigueur professionnelle, il se fait remarquer et obtient des rôles plus étoffés. Il se lance dans l’aventure du cinéma parlant, comprend très vite qu’il doit abandonner les techniques propres à la scène pour séduire un nouveau type de public. Il révolutionne ainsi le jeu d’acteur de l’époque, misant sur le naturel et l’économie de gestes. « De tous les acteurs de l’entre-deux-guerres, il sera celui qui disposera des meilleures connaissances techniques, savoir qui fera de lui un véritable animal de cinéma. » En trois films, Maria Chapdelaine (1934), La Bandera (1935), Pépé le Moko (1937), Julien Duvivier crée le mythe Gabin. De 1935 à sa mobilisation en 1939, son nom brille au générique des oeuvres inoubliables de Julien Duvivier, Marcel Carné, Jean Renoir et Jean Grémillon (La Belle Équipe (1936), Le Quai des brumes (1937), La Grande Illusion (1937), Le jour se lève (1939)…). Devenu un acteur incontournable, il impose les collaborateurs et les projets de son choix. Refusant de tourner sous l’Occupation, il s’expatrie aux États-Unis où il s’éprend de Marlene Dietrich. Il réussit à s’engager en 1943 dans les Forces navales françaises libres, et combat au sein de la prestigieuse 2e division blindée du général Leclerc. À son retour, Jean Gabin ne peut que constater qu’il n’est plus aux yeux des producteurs, des réalisateurs et des spectateurs la vedette qu’il était cinq ans auparavant. Il lui faudra attendre plusieurs années et Touchez pas au grisbi (1954) de Jacques Becker pour renouer avec le succès et occuper, jusqu’à ses dernières interprétations du début des années 70, une place de tout premier plan dans le cinéma français. Éd. Capricci, 112 p., 11,50 €. Élisabeth Miso
Thierry Le Rolland, Les papillons de Nabokov, le boomerang de Gracq. D’autres passions tout aussi dévorantes que la création littéraire ont habité nombre d’écrivains. Thierry Le Rolland s’est amusé, avec érudition, à égrener les marottes de quelques auteurs illustres. Colette a ainsi été immortalisée par Robert Doisneau dans son appartement du Palais-Royal avec plusieurs pièces de sa collection de sulfures, ces boules de verre aux inclusions polychromes de fleurs ou d’animaux, symboles d’une nature qu’elle vénérait. Truman Capote, reçu à l’heure du thé, fut à ce point subjugué qu’il devint à son tour grand amateur de ces presse-papiers. Valery Larbaud possédait dix mille soldats de plomb, aux uniformes scrupuleusement documentés. À ses amis qui s’étonnaient de tels enfantillages, il répondait qu’il s’agissait d’une occupation tout aussi productive que l’écriture, puisqu’elle supposait d’inventer des personnages. Zola pratiquait assidûment la photographie, s’équipant des meilleurs appareils de son temps, s’enfermant de longues heures dans les laboratoires de ses différentes résidences. « Le passage du livre à l’image s’opère avec le même génie et le même besoin d’éclairer le réel d’une vérité sans fard. » Enfant, Julien Gracq se pique d’un vif intérêt pour les boomerangs, mais ne parvient pas à faire revenir celui offert par son cousin. Il lui faudra attendre soixante-dix ans et le cadeau d’un de ses amis, pour enfin goûter aux joies du lancer de boomerang. Entre 1929 et 1932, Paul Éluard a amassé plus de cinq mille cartes postales. Contrairement à d’autres artistes d’avant-garde qui détournaient les cartes postales, lui se contentait de les assembler. Quatre de ses albums ont été acquis par le musée de La Poste en 1990. En 1906, alors âgé de sept ans, Vladimir Nabokov est touché par la grâce infinie d’un papillon. « Il prend à jamais le parti de l’insecte éphémère, et lie le papillon à son existence comme un fil rouge qui se déroule en spirale, « cercle spiritualisé », dont le tracé défie la flèche du temps. » Stefan Zweig considérait son exceptionnelle collection d’autographes et de manuscrits des plus grands écrivains et musiciens comme une véritable œuvre d’art. « Son grand rêve aurait été de se tenir dans l’ombre des grands artistes pour saisir le passage du rien à quelque chose, de Balzac, de Beethoven ou de Mozart. » Thierry Le Rolland scrute encore les déguisements de Loti, les pseudonymes de Stendhal ou les cannes à pêche d’Hemingway, comme autant d’indices sur l’intimité des écrivains qu’il admire et sur les mystérieuses formes qu’emprunte parfois l’expression créative. Éd. Arléa, 136 p., 17 €. Élisabeth Miso
Yvan Leclerc et Jean-Yves Mollier, Gustave Flaubert et Michel Levy, Un couple explosif. Ils sont nés la même année, en 1821. Lorsqu’ils se rencontrent, ils ont l’un et l’autre trente-cinq ans : Gustave Flaubert (1821-1880) ne s’intéressant qu’au livre, Michel Levy (1821-1875), éditeur avisé qui publiera en 1857, Madame Bovary. Jusqu’alors inconnu, Flaubert devient célèbre du jour au lendemain, grâce au procès retentissant et gagné que lui vaut son premier roman. Fils d’un Alsacien juif, Michel Lévy ouvre à Paris avec ses deux frères aînés, Nathan et Kalmus (plus tard francisé en Calmann), une librairie et un cabinet de lecture, dès l’âge de quinze ans. Soucieux de bien commercialiser le livre, en même temps qu’inventeur des collections à petits prix pour démocratiser la lecture, il est le plus novateur de son temps. Il rend visite aux nouveaux auteurs, prend des risques, réussit à publier les écrivains les plus célèbres. Il avait lu dans la Revue de Paris, les premiers chapitres de Madame Bovary, chercha à rencontrer Flaubert. Les Frère Goncourt, dans leur Journal du 28 avril 1861, racontent comment les deux hommes surent s’entendre et faire affaire. « Lorsque Gustave Flaubert alla, avant d’aller chez Levy, proposer Madame Bovary à éditer à Jaccottet et à la Librairie Nouvelle, Jaccottet lui dit : « C’est très bien votre livre, c’est ciselé ! Mais vous ne pouvez pas aspirer au succès d’Amédée Lachard. » « – C’est ciselé ! rugit Flaubert. Je trouve ça d’une insolence de la part d’un éditeur ! Un éditeur vous exploite, mais il n’a pas le droit de vous apprécier », ajoutant qu’à Michel Levy, il savait gré de ne jamais dire un mot sur son livre. Il le prenait voilà tout. Leurs affinités multiples, leur entente, perdureront quinze ans et produiront aussi Salammbô (1862) et L’Éducation sentimentale (1869), jusqu’à une malheureuse rupture définitive. Genèse d’une histoire, et genèse d’un couple solide. Éd. Calmann-Levy, 18,50 €. Corinne Amar
RÉCITS
Harry Crews, Par le trou de la serrure. Traduction de l’anglais (États-Unis) Nicolas Richard. Postface Joseph Incardona. Le fils d’Harry Crews a confié aux éditions Finitude un manuscrit inédit retrouvé après sa mort. L’écrivain américain avait rassemblé des reportages parus dans les années 1980-1990 dans Esquire, Playboy ou Fame et des textes autobiographiques. Qu’il relate un combat de boxe à Atlantic City en compagnie de Madonna et de Sean Penn, les journées à suivre un inquiétant Grand Sorcier des Chevaliers du Ku Klux Klan, le business lucratif d’un télévangéliste ou ses souvenirs d’enfance ; sa plume acérée, sensible et poétique sonde ses propres failles et celles d’une Amérique aux prises avec le racisme, la violence, les inégalités sociales. Harry Crews a vu le jour en 1935, dans une famille de fermiers pauvres du comté de Bacon, en Géorgie. Son père décède avant ses deux ans, sa mère se retrouve seule avec deux enfants en bas âge. Cette mère courageuse, volontaire, d’une droiture inébranlable, a toujours été « un point fixe, dans un monde incertain ». Son existence semée d’épreuves lui a ouvert le cœur et l’esprit. Elle a compris d’emblée ce que son fils traduisait de la condition humaine dans ses fictions. « Elle sait que les circonstances peuvent contribuer à briser les meilleurs d’entre nous, et que lorsque les circonstances nous brisent, cela ne fait pas de nous des êtres mauvais mais seulement des êtres humains. » L’auteur du Chanteur de gospel évoque son engagement dans les Marines, son entrée à l’université grâce à une bourse d’ancien combattant de la guerre de Corée, ses doutes et ses angoisses de romancier, le plaisir et l’équilibre mental que lui procure l’enseignement à l’Université de Floride. Il parle sans fard de ses blessures intimes (l’alcoolisme, la noyade de son fils aîné à l’âge de quatre ans) et laisse deviner toute l’immensité de l’amour qu’il porte à son fils Byron. Le livre est une célébration de son Sud natal, de la magie des récits entendus et des paysages parcourus, de ces « péquenots » qu’il affectionne, du marais d’Okefenokee et de la rivière Suwannee au pouvoir rassérénant. « Dès l’instant où celui en moi qui veut raconter des histoires se trouve sur la rivière, le démon ridiculement vaniteux qui vit aussi en moi m’oblige à joyeusement empoigner de nouveau le rêve fou qui insiste pour me convaincre que j’ai une bonne chance d’arriver à réinventer l’expérience du monde et de le renouveler. » Éd. Finitude, 352 p., 24 €. Élisabeth Miso
CORRESPONDANCES
George Sand, Victor Hugo, Je m’aperçois que je vous aime, heureusement que je suis vieux. Édition établie et présentée par Danielle Bahiaoui. Ils sont exacts contemporains, monuments de la littérature, l’un comme l’autre, s’estimant. Ils s’écrivirent longtemps, et pourtant ne se rencontrèrent jamais, même lorsque Victor Hugo sera revenu de son exil forcé en Angleterre puis dans les îles anglo-normandes – Jersey, Guernesey – de retour à Paris, en juillet 1970, après presque dix-neuf années loin de la France. Leur relation épistolaire commence en 1856, année où Victor Hugo (1802-1885) publie Les Contemplations, dont le succès est immédiat malgré les critiques hostiles de ses pairs dans la presse. C’est le moment où George Sand (1804-1876), de son vrai nom, Aurore Dupin, fait entendre sa voix et s’adresse à Hetzel, l’éditeur de Hugo : « Vous me demandez ce que je pense des Contemplations. J’ai acheté l’ouvrage et je n’ai pas encore tout lu, mais ce que j’ai lu est magnifique et je ne crois pas qu’on n’ait jamais fait en France rien de plus beau dans cette gamme. » Sand et Hugo finissent par s’écrire, respectueux, presque déférents, entre vive admiration réciproque et résistance franche. Il la remercie d’être une grande âme – « Voulez-vous me permettre de vous dire que je suis toujours à vos pieds », lui écrit-il le 21 août 1859, louant l’idéal en elle : « Je travaille et je songe dans ma solitude, et je pense aux nobles esprits qui comme vous entretiennent en France, le feu de cette grande vestale qu’on appelle l’idée. Oui, vous avez de l’idéal en vous, répandez-le, répandez-le. » Il termine par un « Je vous aime et je vous vénère. » Lorsqu’on connaît le tempérament impétueux de George Sand, sa grande liberté de ton et de mœurs qui ne manqua pas de scandaliser son époque, lorsqu’on connaît la stature de Victor Hugo, cet ego écrasant qui fut le sien, on se doute de la complexité d’une telle relation entretenue près de vingt ans durant, jusqu’à la mort de George Sand, en 1876. On se souvient peut-être de l’éloge funèbre de Victor Hugo lu aux obsèques à Nohant, qui commençait ainsi, par ces mots : « Je pleure une morte et je salue une immortelle ». Le Passeur Éditeur, 318 p., 8,90 €. Corinne Amar
JOURNAUX
Sándor Márai, Journal, Les années d’exil, 1949-1967. Traduit du hongrois par Catherine Fay, postfacé par András Kányádi. Année 1949, « (…) tout ce que présage l’avenir est plutôt sombre. » Le volume 2 des années d’exil en Italie de l’écrivain Sándor Márai (1900-1989) est fascinant à plus d’un titre. Écrivain, poète, traducteur, romancier au destin lié aux soubresauts de l'histoire de son pays, la Hongrie, qui mit fin à ses jours en 1989, antifasciste dans une Hongrie alliée à l’Allemagne nazie, resté à l'écart des chapelles littéraires, Sándor Márai avait vu non sans inquiétude la montée des régimes totalitaires. Exilé en 1948, en Italie, apatride, sans un sou – vers la fin de sa vie, installé définitivement en 1980, aux États-Unis – il raconte ces années d’incertitude d’après-guerre, l’existence telle qu’il la mène, retraçant avec précision la chronologie des événements historiques, confiant pourtant dans son espoir d’une vie meilleure. Si belles, ces pages de tendresse pour la beauté de l’existence, émerveillé qu’il est par la nature, la vie, l’Italie qui l’accueille, les bibliothèques où il peut se réfugier pour lire, commander un livre... « (...) Je n’ai pas un sou. Ces dernières semaines, nous avons vécu sur les réserves de L. Voilà comment je vis sans argent ; le matin, je m’assieds sur la terrasse, face à Capri et à la mer, je bois un thé anglais très fort et je mange une omelette aux lardons, du pain beurré et de la confiture. Ensuite, j’allume une cigarette américaine et je lis Poe et Montherlant, ainsi que des poèmes. Ensuite, je descends en ville, je lis dans l’une ou l’autre des bibliothèques pendant une heure, puis je bois un café serré au bord de la mer, au soleil. » Il vit de peu toutes ces fameuses années, doit compter pour emprunter le moins possible, vendre un manteau de fourrure pour espérer manger pendant un an – l’horizon est sombre toujours, en 1950, mais il espère. « Tout est terriblement dur. Même si j’étais fourreur ou boulanger, ce serait dur. Mais il se trouve que je suis un écrivain hongrois, ce qui est sans doute encore plus dur. » Il réfléchit beaucoup à l’écriture, ne veut plus écrire ni du « beau » ni du « sage », veut éviter le genre pour aller à l’essentiel, prend des résolutions ; il voyage en Europe, envisage de s’installer en Amérique avec sa femme, s’y prépare – écrit beaucoup, se repose quand il le peut, fait part de ses méditations au jour le jour, en intellectuel, en esthète, en humaniste. À travers son Journal, courent les réflexions de l’exilé qui se sait émigrant, et comme tout véritable émigrant, ne pense pas qu’un jour il pourra rentrer chez lui. « Les grands émigrés, les vrais ne reviennent pas. » Magnifiques pages, lumineuses de sobriété littéraire, de lucidité sans faille, d’une conscience éblouie de la beauté méditerranéenne, chaleureuse, enveloppante de l’Italie – « 29 décembre 1951. Rome, Fatigue cardiaque. Nicotine, alcool. J’ai sans doute atteint la frontière avec ces deux poisons (…) En Italie, j’aime tout. Il n’y a pas cette tension particulière qui règne « chez nous. » Assailli d’un sentiment de vie comme il n’en a jamais connu devant le ravissement d’un bateau qui se balance dans la lumière du soleil, mais assailli tout autant, de chagrin, en pensant à sa mère loin de lui, ou à ses proches, amis, journalistes, restés là-bas, chez lui, et enfermés en prison. Éd. Albin Michel, 615 p., 25 €. Corinne Amar