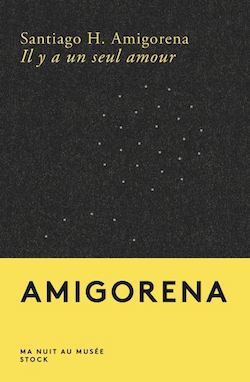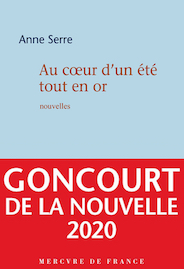ROMANS
Siri Ranva Hjelm Jacobsen, Île. Traduction du danois Andreas Saint Bonnet. « Dès que ma mère venait ici, elle semblait avoir accès à une mémoire étendue, plus profonde et plus colorée que la sienne, une mémoire connectée à tout ce qui l’entourait. Le puits de la lignée. À vrai dire, elle semblait ne plus s’adresser qu’à lui. » La narratrice d’Île, danoise par son père, féroïenne par sa mère, rend visite avec ses parents à sa famille maternelle. Sa mère a organisé ces vacances sur les Îles Féroé, par besoin de se savoir reliée à la terre et à l’histoire de ses parents décédés mais aussi parce qu’elle devine chez sa fille la même attraction, la volonté d’en savoir davantage sur ses origines. La beauté des îles est envoûtante, avec ses montagnes, ses fjords, ses maisons basses couvertes d’herbe et ses moutons. « J’aurais aimé qu’un bourgeon en moi ait grandi ici, qu’il appartienne à ce lieu, à la pierre, aux effluves verts. », confie la jeune femme. Son voyage vers les îles de ses ancêtres se juxtapose au mouvement inverse opéré des décennies plus tôt par ses grands-parents maternels, partis s’établir au Danemark. Des grands-parents, dont elle garde un souvenir nostalgique. Fritz et Marita, rêvaient d’un autre horizon que celui de la pêche ou de l’usine à poissons. Marita rejoint son mari à Copenhague au moment où éclate la Seconde Guerre mondiale, juste avant l’Occupation britannique. « (…) comment émigre-t-on ? Que fait-on de tout ce qui nous dépasse ? (…) Qui étions-nous ? Les Féroïens, ceux qui sont restés, et nous autres, les hôtes du sang, l’essaimage biologique de la migration. ». La narratrice s’attache à retracer la trajectoire de ses grands-parents et à décrypter ce qui se joue en elle, derrière ce sentiment d’être tiraillée entre deux cultures. Siri Ranva Hjelm Jacobsen, a trouvé dans sa propre histoire familiale de quoi composer un subtil et poétique premier roman porté par le thème de la quête identitaire et de l’héritage. Éd. Grasset, 240 p., 18 €. Élisabeth Miso
Marc Pautrel, Ozu. « Ozu aime venir seul ici, au milieu des arbres, le matin si possible. Il prend un taxi à la gare, il se fait déposer à l'entrée du sanctuaire et il marche, à jeun, dans le silence et le frais. Il se sent très bien ce matin, pas de vertige, pas de gueule de bois, il a l'impression d'avoir hérité d'un nouveau corps pendant la nuit, l'impression que le corps qui s'était lentement gorgé de saké toute la soirée et toute la nuit, est resté à la maison, et qu'on lui a prêté mystérieusement un second corps (...) » C’est un roman doux, vif et jubilatoire, mélancolique comme le temps qui passe, inspiré de la vie du cinéaste japonais Yasujirô Ozu (1903-1963), pour qui existence et cinéma étaient inséparables. Collégien, au lieu d’étudier, Ozu se passionnait pour le cinéma et préférait aller voir des films. À Tokyo où il vivait, il devint assistant-opérateur dans une société de production. En 1926, il montait son premier film, et dès le milieu des années 30, il devenait l’un des réalisateurs les plus célèbres au Japon, notamment pour ses scènes de la vie de famille ou du couple, sa façon de filmer l’intime. L’auteur, avec une sensibilité qu’on lui connaît pour la forme brève, empathique, poétique, réinvente le quotidien de son personnage dans l’effervescence des jours, la floraison des prunus, les amitiés, la tendresse pour l’âme des disparus, les marches le matin qui désaoulent, l’ivresse du saké nécessaire, la création, le travail. Nous voyageons avec lui dans cet autre temps, nous avançons avec lui dans ces allées des sanctuaires, quand il s’achemine heureux de sentir qu’il va pouvoir annoncer à son scénariste et ami, Noda, qu’il a progressé dans le scénario, ou qu’il apprend qu’il va recevoir des mains de l’Empereur le Prix de l’Académie des Arts du Japon pour son œuvre – une distinction qu’aucun cinéaste n’a jamais reçue. Il mourra quatre ans plus tard, mais il sait déjà qu’il est immortel. Marc Pautrel, éd. Arléa, 166 p., 9 € (parution 2 avril reportée en juin). Corinne Amar
RÉCITS
Santiago H. Amigorena, Il y a un seul amour. Santiago H. Amigorena a accepté l’invitation insolite de passer une nuit au musée Picasso. Jusqu’à minuit il peut déambuler à sa guise dans les salles désertes du musée, de minuit à six heures et demie du matin il doit rester dans le hall de l’escalier d’honneur où ont été disposés un petit bureau pour écrire et un lit de camp pour dormir. Le temps d’une nuit, le voilà séparé de la femme qu’il aime. Elle va pourtant occuper toutes ses pensées puisqu’il a le projet d’écrire sur la douceur et la violence de leur amour, sur tout ce qu’aimer suscite comme interrogations. Il veut profiter de son absence pour lui écrire longuement : « Pour te retrouver non pas telle que tu es vraiment – opaque, intense, contradictoire, insondable, insaisissable – mais pour te retrouver avec la précision distante que seule permet l’écriture. » Il parcourt l’exposition consacrée à Picasso et à Giacometti, mais plus il tente de s’absorber dans leurs œuvres, plus elles se dérobent. « Je voulais voir et mon désir, ma volonté de voir aveuglaient mon regard. » Habituellement ses yeux et sa réflexion ne sont pas empêchés de la sorte, la peinture l’inspire et se glisse fréquemment dans ses livres. « La peinture m’a toujours semblé, instinctivement, plus proche de ce que je cherche en écrivant : un espace plutôt qu’un temps, une terre plutôt qu’un air – plutôt qu’un fleuve un océan. » Il se remémore ainsi sa passion adolescente pour Vermeer, sa découverte des Offices de Florence, du Kunsthistorisches Museum à Vienne et du Rijksmuseum à Amsterdam. Le regard « fier et absolu » du Petit buste d’Annette de Giacometti lui évoque celui de la Tête de Néfertiti du musée du Caire et le ramène à celui de sa compagne. Art et vie intime sont-ils inextricablement liés ? La passion amoureuse peut-elle se comparer à l’amour de la littérature ou de la peinture ? S’agit-il du même amour ? N’y a-t-il qu’un seul amour ? se demande Santiago H. Amigorena qui sait combien son désir d’écrire s’est nourri de ses relations sentimentales. « Souvent, j’ai confondu l’amour des êtres et l’amour des œuvres, puisque leur but ultime, à tous deux, croyais-je, n’était que de me permettre de bâtir l’illusion de mon œuvre. » Éd. Stock, Collection Ma nuit au musée, 18 mars 2020, 300 p., 20 €. Élisabeth Miso
BIOGRAPHIES
Serge Toubiana, L’amie américaine. Avec L’amie américaine, Serge Toubiana, qui a dirigé Les Cahiers du Cinéma et la Cinémathèque française, met en lumière la vie romanesque d’Helen Scott, une personnalité étonnante restée au second plan. Cette américaine francophile a pourtant joué un rôle essentiel dans la reconnaissance des films de la Nouvelle Vague aux États-Unis, comme en témoigne sa correspondance avec François Truffaut. Janvier 1960, Helen Scott, en charge des relations avec la presse pour le French Film Office à New York, accueille François Truffaut à l’aéroport, convié à la sortie américaine des Quatre Cents Coups, son premier film primé à Cannes quelques mois plus tôt. C’est le premier voyage du cinéaste de vingt-huit ans aux États-Unis, Helen Scott lui sert d’interprète. Pour elle, c’est un véritable coup de foudre, qu’elle rêverait réciproque. Forte de leur complicité évidente, elle œuvre pour devenir son interlocutrice privilégiée et souhaite que s’instaure entre eux une relation profonde. À quarante-cinq ans, cette rencontre donne un nouveau tournant à son existence. « Pour elle, il est toute sa vie, l’astre autour duquel elle vibre et se met en mouvement. » Pour lui, elle est une alliée précieuse pour promouvoir les films de la Nouvelle Vague outre-Atlantique. Il fait son éducation cinématographique. Elle s’enthousiasme pour ses films, le conseille dans ses collaborations américaines. En 1962, ils s’attellent ensemble au livre d’entretiens avec Alfred Hitchcock qui deviendra un ouvrage culte. Helen Scott voit son horizon professionnel s’éclaircir enfin après avoir été longtemps black-listée, suite à son passé de militante communiste. Elle, qui s’est engagée dans sa jeunesse pour la France libre et a été attachée de presse pour le Tribunal de Nuremberg, se sent à nouveau utile auprès d’artistes français qu’elle admire comme Jean-Luc Godard ou Alain Resnais et avec qui elle se lie durablement. Par sa personnalité inclassable et ses compétences, elle se fait un nom dans le milieu du 7ème Art. Les échanges épistolaires entre les deux amis sont révélateurs de leur grande finesse d’esprit, de leur exigence intellectuelle, de leur talent littéraire, de leur humour et des multiples projets qui occupent en permanence le réalisateur et producteur. « (…) vous êtes bien la seule personne de ma vie que je suis libre d’aimer totalement, sans risque d’être blessée ; ce que vous me rendez en échange m’importe peu, et en tout cas, me satisfait pleinement. L’essentiel, c’est que je n’ai pas besoin de freiner mon élan », lui déclare-t-elle le 8 octobre 1964. Helen Scott repose au cimetière Montmartre à quelques mètres de distance de son cher Truffaut. Éd. Stock, 300 p., 20 €. Élisabeth Miso
ESSAIS
Paolo Giordano, Contagions. Traduction de l’italien Nathalie Bauer,Confiné en Italie, très touché par l’épidémie, le romancier essayiste italien, francophone, écrit Contagions, dans l'urgence, tel un témoignage coup de poing sur la pandémie, au moment où la situation est extrêmement grave en Italie et où le confinement, en France, n’a pas encore commencé. Le texte qui devait paraître au Seuil début avril, a été mis en accès libre sur le site des éditions dès le 25 mars. Quand vous lirez ces pages, la situation aura changé. Les chiffres seront différents, l’épidémie se sera étendue, elle aura atteint tous les coins civilisés du monde, ou aura été domptée – peu importe, avait prévenu, en amont de la tragédie mondiale qui allait peu après s’abattre, l’auteur en plein désarroi et submergé de réflexions dont il éprouvait la nécessité d’en faire part, persuadé qu’elles seraient encore valables. Le texte est bref, une soixantaine de pages où le mot compte autant que la gravité de la situation ; réflexions intimes et philosophiques sur la contagion, la prise de conscience, la peur et ce à quoi elle nous renvoie au plus profond de nous-mêmes : propos lucide sur ces idées volatiles qui s’évanouissent en un instant, aussitôt la peur surmontée. C’est aussi un texte qui pose la question de l’écriture, du pouvoir envers et contre tout de la création littéraire. « J’ai décidé d’employer ce vide à écrire. Pour tenir à distance les présages et trouver une meilleure façon de réfléchir à tout cela. L’écriture a parfois le pouvoir de se muer en un lest qui ancre au sol. Ce n’est pas tout : je ne veux pas passer à côté de ce que l’épidémie nous dévoile de nous-mêmes (…) ». Thème que l’on retrouve dans son dernier roman, Dévorer le ciel (Seuil, 2019), où il évoquait le rôle de la littérature et ce quelque chose en soi au fond pas très rationnel, mais juste une possibilité d'être perméable à ce qui se passe. Éd. Seuil. 28 mai 2020, 64 p., 9,50 €. Corinne Amar
MÉMOIRES
Anne Serre, Au cœur d'un été tout en or. Autoportrait en trente-trois visages, trente-trois paysages, fragments courts pour une romancière rodée à la nouvelle (qu’elle a longtemps écrite pour des revues). Un je tantôt masculin tantôt féminin, qui promène son lecteur d’un univers fantasque à l’autre ; un père, dans un hôpital, qui se prend pour Alfred de Musset et parle à sa fille comme si elle était George Sand ; une mère qui ressemble à Liz Taylor avec son joli visage au petit nez droit, des souvenirs resurgis de vieux carnets intimes, des amitiés vieilles de trente-cinq ans, des ruptures, des voyages qui ont compté ou encore, l’apparition prémonitoire d’un chat noir dans une soirée amoureuse sur une véranda d’hôtel. Il y a dans le ton de ces nouvelles un certain charme de l’écriture qui mêle la fiction et la réalité avec un talent proche du conte. L’originalité du style s’était vue déjà dans Petite table, sois mise (Verdier 2012), une fable qui racontait l’histoire d’une famille sans tabou, empruntait son titre à Grimm, et jouait allègrement avec les mystères de la sexualité et de la transgression. « Depuis que j’écris et raconte des histoires, j’ai toujours envie (et j’ai essayé cent fois de le faire) de décrire un peu ce que fut notre existence dans cette maison où nous étions une bonne dizaine et où, pour des raisons confuses, nous vivions en plein vingtième siècle comme au dix-neuvième siècle », (Sur la pelouse). La nouvelle est aussi courte que les autres, à peine plus de deux pages et pourtant, d’une densité, d’une ferveur particulière, qui ajoutent à la magie du souvenir évoqué : celui d’une enfance heureuse parce qu’originale, emplie de grâce, dans une grande maison de vingt pièces où habitaient les enfants, les parents, les grands-parents, les bonnes… Des souvenirs si précis, si empreints de leur beauté pure, qu’il arrive parfois qu’ils refusent d’apparaître. Et sans doute, alors, faut-il les imaginer... Éd. Mercure de France, 28 mai 2020, 143 p., 14,80 €. Corinne Amar
Dominique Fourcade, Magdaléniennement. C’est un ample poème habité d’intemporalité et de modernité à la fois, où les mots seraient d’une telle intransigeance existentielle, d’une telle anxiété, qu’il semblerait comme une évidence de lire longtemps une même page, et d’avoir en tête ou sous les yeux, un autre des livres de Dominique Fourcade pour avec lui, remonter le temps puis le redescendre. Essayiste, poète, commissaire d’expositions, celui qui, dans Citizen Do (2008), écrivait à propos de son œuvre, « mon métier est de voir nu », a consacré des textes sur Matisse, Cézanne ou Pollock et cherche à transposer dans sa poésie des techniques de peintres, évoque ici encore des moments d’écriture et de vie. Lascaux, les attentats de CharlieHebdo, une libellule qui traverse, des bouts de roman, Rodin et la danse au Musée Rodin, une visite de l'exposition Cézanne au Metropolitan, la musique, la danse, Merce Cunningham, Bashung. Et puis, Manet, Matisse, Richter… Prose ou poème, en autant de mouvements, d’apparitions qui emmêlent les styles de langage ou les langues – éparpillés ici ou là un mot d’allemand ou d’argot, une expression anglaise ou bien familière, « être au contact du réel », une obsession et une angoisse. Tu me dis / de ne pas m’émerveiller tant que ça, que les tailleurs sont guidés par le sentiment du corps, que cela va presque de soi : ai-je le droit de demander ce qui les guide dans le sentiment du bleu. Déséquilibre, équilibre permanents d’où naît la strophe, confrontation du poète à son époque. « Magdaléniennement » : le mot inventé à partir de Magdalénien qui désigne la période préhistorique du Paléolithique supérieur, renvoie à cette période dont le chef-d’œuvre reste la grotte de Lascaux et ses peintures pariétales, et aussi, à cette question déterminante de la modernité : Lascaux, Cézanne, infiniment modernes. Parler ou écrire, de toutes façons : « rien n’arrive si une syllabe n’est pas son corps ». Éd. P.O.L, 28 mai 2020, 188 p., 21 €. Corinne Amar