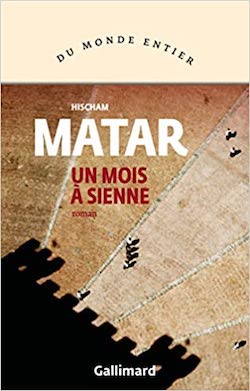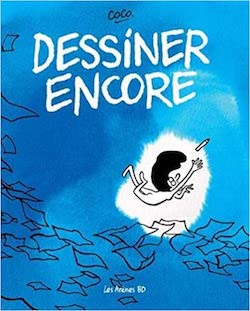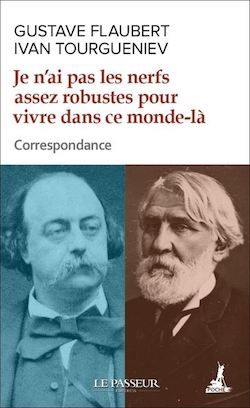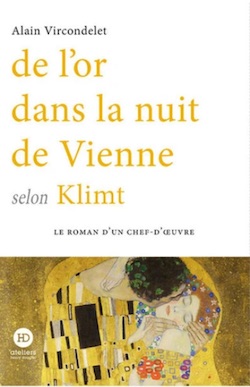ROMANS
Daniel Saldaña París, Plier bagage. Traduction de l’espagnol (Mexique) François Gaudry. Un jour d’été de 1994 à Mexico, une mère embrasse son fils et sa fille, laisse une lettre à son mari sur la table de nuit et referme derrière elle la porte du foyer familial. Elle ne réapparaîtra jamais. Le narrateur qui avait dix ans à l’époque, tente d’élucider le mystère de cet abandon maternel. Aujourd’hui âgé de trente-trois ans, il vit cloîtré dans son appartement et ne quittera pas son lit avant d’avoir couché sur le papier cette histoire familiale qui le ronge. « (…) c’est ainsi que je peux me dire les choses auxquelles je n’ose pas penser quand je suis seul. C’est seulement lorsque j’aurai tout écrit que je pourrai me regarder dans le miroir et ne plus voir le visage d’un autre, de cet autre qui me poursuit à l’intérieur de moi. », confesse-t-il. Il scrute son passé à hauteur de ses yeux d’enfant, se remémorant dans quel désarroi l’a plongé la disparition de sa mère. Après son départ, un silence pesant s’est installé. Son père n’avait toujours été qu’« un élément parmi d’autres de l’infrastructure domestique », un être sans envergure à l’intelligence limitée, dénué d’empathie, incapable « d’anticiper la douleur d’autrui. La vie intérieure des autres – y compris de ses enfants – fut toujours un coffre-fort dont il ignorait la combinaison. » L’enfant qu’il était, trompait sa solitude dans la confection d’origamis. Peu doué pour l’art de la pliure, il s’obstinait pourtant, cherchant dans ce jeu de parfaite symétrie à étouffer l’angoisse provoquée par un monde qu’il ne comprenait pas. De la lettre, il n’avait pu lire qu’une seule phrase indiquant que sa mère partait rejoindre les rangs de la révolution zapatiste au Chiapas. Aussi s’était-il aventuré hors des frontières de son quartier pour embarquer dans un bus, bien décidé à la retrouver. Daniel Saldaña París dépeint admirablement les affres de son jeune héros, la fin de l’enfance et de l’innocence, la confrontation à une réalité complexe, l’effondrement d’une famille sur fond de violence mexicaine. « De même que le pli, qui constitue le fondement de l’origami, repose sur une idée fausse, de même que le pli le plus intime de notre personnalité, le pli auquel nul n’accède, le pli de l’intimité – l’envers douloureux que nous cachons, que nous gardons comme une lettre secrète dans la table de nuit de notre vie –, ce pli, disais-je, est aussi une illusion d’optique, et en réalité nous n’avons pour toute essence que nos peurs, pour toute identité que nos frustrations, pour tout sens que nos sanglots dans la profonde nuit des temps. » Éd. Métailié, 192 p., 18 €. Élisabeth Miso
RÉCITS
Hisham Matar, Un mois à Sienne. Traduction de l’anglais Sarah Gurcel. Vidé par ses trois années d’écriture de La terre qui les sépare (prix Pulitzer de la biographie 2017), qui relate son périple et son échec à faire toute la lumière sur la mort de son père, et dans l’entre-deux livres, Hisham Matar décide de se rendre à Sienne, ce dont il rêve depuis très longtemps. Peu après la disparition de son père en 1990, un opposant au régime de Kadhafi, kidnappé en Égypte et enfermé dans la prison d’Abou Salim, il prend l’habitude d’aller chaque jour à la National Gallery. C’est ainsi qu’à dix-neuf ans, étudiant à Londres, il est ébloui par la peinture de l’école siennoise, dans laquelle il peut « surprendre une des plus passionnantes discussions de l’histoire de l’art : celle qui cherche à définir ce que peut être un tableau, sa raison d’être, ce qu’il est susceptible d’accomplir à l’intérieur du drame intime se jouant dans la relation unique qu’il noue avec l’inconnu devant lui. » Sa femme Diana l’accompagne pour quelques jours, le temps d’admirer ensemble les Allégories de Lorenzetti au Palazzo Pubblico. Le temps de savourer la douceur d’aimer et de se savoir aimé pour soi-même. Une fois seul, il poursuit ses déambulations dans la cité toscane, se laissant porter par les œuvres picturales, les rencontres, par ses pensées. Et très vite, il réalise qu’en marchant jusqu’aux confins de la ville, il explore en fait ses propres limites, et que ce voyage agit sur lui comme un révélateur. Passé et présent s’entremêlent. Sienne appelle d’autres lieux, des souvenirs d’un séjour à Rome et de Tripoli, où il a grandi et où il est retourné après plus de trente ans d’absence. Des visages aimés lui apparaissent, celui de son père plus particulièrement. « J’ai compris alors que je n’étais pas venu à Sienne pour seulement contempler des tableaux. J’étais aussi venu y faire mon deuil en solitaire, étudier la nouvelle topographie qui s’offrait à moi et déterminer comment avancer désormais. » Hisham Matar déploie une méditation d’une rare finesse sur l’art, la littérature, les connexions mentales qui nous relient aux êtres chers vivants ou perdus. Dans une interview accordée au Monde en 2017, il évoquait en ces termes le formidable pouvoir de notre dynamique mentale. « La conscience me fascine. Quand on y réfléchit, on comprend que le temps n’est pas linéaire, que les événements coexistent et qu’il y a un lien entre ce qui nous arrive et la mémoire. Ce que nous vivons ne détermine pas seulement le présent et l’avenir mais informe le passé. » Éd. Gallimard, Du monde entier, 144 p., 14 €. Élisabeth Miso
ROMANS GRAPHIQUES / BD
Coco, Dessiner encore. Le 7 janvier 2015, la vie de la dessinatrice de presse Coco a basculé. Peu avant midi, elle quitte la première conférence de rédaction de l’année de Charlie Hebdo pour filer chercher sa fille à la halte-garderie ; lorsque deux hommes cagoulés font subitement irruption dans l’immeuble, et la contraignent sous la menace de leurs armes à composer le code d’entrée du journal. Douze personnes périssent sous les balles des deux djihadistes. Dessiner encore est le récit intime d’une blessure collective et d’un long chemin personnel vers la reconstruction. Vaincre sa culpabilité de survivante n’a pas été facile. Et si elle n’avait pas tapé le code, et si elle avait résisté, et si, et si… les choses auraient-elles pris une tout autre tournure ? L’attentat est très pudiquement relaté en quelques pages d’une grande force visuelle. Coco y décrit son effroi, les kalachnikovs braquées sur elle, dans un rythme de plus en plus fragmenté, un kaléidoscope de détails de la scène à l’encre noire et de taches rouges. Le drame tourne en boucle dans sa tête, la submerge régulièrement, une angoisse qui prend graphiquement la forme de la Grande Vague d’Hokusai. « C’est incontrôlable. Ça vient à tout moment m’avaler et me replonger dans cette poignée de minutes qui a bouleversé ma vie. » Alors pour tenir à distance cette lame de fond et tous les cauchemars qu’elle charrie, elle s’accroche au dessin. « On se relève et on lutte par tous les moyens. Comme on peut. Moi, j’ai essayé de faire obstruction par le dessin. Barrage à l’insensé. Dessiner pour ne plus penser. Dessiner, dessiner, dessiner… » Dessiner et s’investir totalement dans le journal ont été les deux seuls remparts contre le chaos. Dessiner pour continuer à faire vivre cet esprit satirique et libertaire qu’incarnaient si bien Cabu, Charb, Tignous et les autres, tous passionnés par leur métier. Arrivée à Charlie Hebdo pour un stage en novembre 2007, elle s’est tout de suite sentie à l’aise dans cette ambiance d’humour ravageur et de complicité. Elle se souvient du fil des événements depuis l’affaire « des caricatures danoises », du vent de solidarité qui a suivi l’attentat, de cette foule compacte défilant les 10 et 11 janvier dans plusieurs grandes villes françaises au nom de la liberté d’expression. Avec Dessiner encore, la caricaturiste rejoint ses camarades Philippe Lançon (Le Lambeau), Catherine Meurisse (La légèreté), Luz (Catharsis) et Riss (Une minute quarante-neuf secondes) dans le récit qu’il restera de ce traumatisme collectif. Éd. Les Arènes, 352 p., 28 €. Élisabeth Miso
CORRESPONDANCES
Gustave Flaubert, Ivan Tourgueniev, Je n’ai pas les nerfs assez robustes pour vivre dans ce monde-là. Correspondance. Préface de Franck Lanot. Flaubert à Tourgueniev, Croisset, 3 juillet [1875] « (…) Ça ne va pas du tout ! B. et P. sont restés en plan. Je me suis lancé dans une entreprise absurde. Je m’en aperçois maintenant et j’ai peur d’en rester là. Je crois que je suis vidé. Ma pauvre tête est endolorie comme si on m’avait donné des coups de bâton ! Le présent n’est pas drôle et l’avenir m’effraie. Comme je suis incapable de tout travail, il est possible que j’aille, vers le milieu d’août, passer deux mois à Concarneau, dans la compagnie de G. Pouchet. Je ferai de la pisciculture et je mangerai des homards ! » Gustave Flaubert (1821-1880) et Ivan Tourgueniev (1818-1883) se rencontrent à Paris en 1863. Sans se connaître, ils s’estiment pour s’être lus. Ils ont vingt ans encore devant eux de coup de foudre intellectuel, de rencontres et de partages. Leur correspondance entre 1863 et 1880, année de la mort de Flaubert dit beaucoup d’une amitié en écriture entre deux grands de la littérature qui échangent sur tout. Tourgueniev est installé à Bougival, son « chalet » lui plaît beaucoup, il est sensible au vert des arbres devant sa fenêtre, à leurs « splendeurs veloutées ». Le temps passe si vite – parfois il se demande ce qu’il a fait tandis que « les jours ont fui comme de l’eau, comme du sable » ou encore, éprouve cette joie qui le fait rougir quand Flaubert le couvre d’éloges comme au début de leur rencontre alors qu’il lui a fait parvenir ses Scènes de la vie russe. Août 1877, Tourgueniev a la goutte, broie du noir, Flaubert continue d’œuvrer comme un fou, s’inquiète, appelle son ami « mon vieux chéri », voudrait dormir davantage, se sent harassé par l’existence. Toujours plongé dans l’entreprise de Bouvard et Pécuchet qui le ronge : « Il est temps que ça finisse ». Quelle paire de géants ! Éd. Le Passeur, 300 p., 8,50 €. Corinne Amar
BIOGRAPHIE
Alain Vircondelet, De l’or dans la nuit de Vienne selon Klimt. C’est une enquête historique et un récit romanesque que mène l’auteur, biographe et essayiste par ailleurs, revisitant le tableau le plus célèbre, le plus copié du XXe siècle, Le Baiser ; une toile carrée du peintre autrichien, Gustav Klimt (1862-1918), au format plutôt rare – 1,80 m sur 1,80 m – peinte entre 1908 et 1909, et recouverte de feuilles d’or. Le baiser est sur la joue, l'homme enlace la femme, il est au-dessus d'elle, recouvert d'un manteau jaune, elle porte une cape de petites fleurs et de motifs végétaux, et autour d’eux comme une prairie parsemée de fleurs, elle aussi. Le paysage est baigné d’or, relié au soleil, à cette lumière divine dans laquelle le peintre enchâsse le couple. Car le peintre a à l’esprit l’idée d’un Baiser non pas érotique, mais résolument sacré. Celle qui l’inspire, lui, le grand séducteur entouré de femmes ou de prostituées évoluant nues dans son atelier, celle dont il fera sa muse, qui posera pour lui tel un Idéal près de vingt années durant, c’est elle : Émilie Louise Flöge, l’amante secrète à laquelle il n’osera succomber – mystère à la féminité fascinante – une jeune couturière qui habille la bourgeoisie de Vienne, et dont la sœur a épousé le frère de Gustav Klimt. Elle demeurera sa source d’inspiration pour nombre de ses chefs-d’œuvre, le reliant à une élévation spirituelle voire cosmique. Avec Le Baiser, il a en tête un motif et une toile qui tiendraient dans le temps et résisteraient dans leur tension éternelle. « Chaque promenade avec Émilie, chaque rêve qu’il faisait d’elle, le ramenaient à ce nouveau programme. À ce qu’il appelait un « cycle », parce qu’il y avait un sens à suivre, à la fois géographique, existentiel mais surtout spirituel (…). Ce serait un baiser immense et éternel qui se fonderait dans un seul corps, dans une vaste coulée d’or et de signes. » Roman d’un chef-d’œuvre et titre d’une toute nouvelle collection. Éd. Ateliers Henry Dougier, 125 p., 12,90 €. Corinne Amar