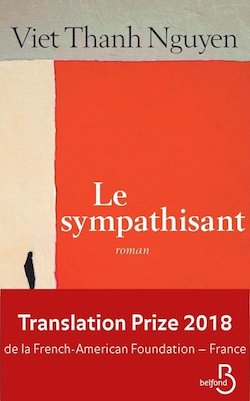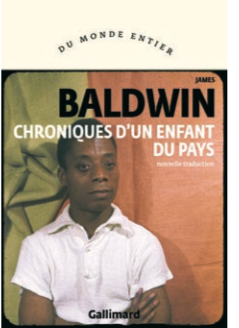Par CORINNE AMAR et ÉLISABETH MISO
Chris Kraus, I love Dick. Traduit de l’anglais (États-Unis) par Alice Zeniter.
L’héroïne s’appelle Chris Kraus et commence ainsi son Journal : « 3 décembre 1994, Chris Kraus, une vidéaste expérimentale de 39 ans, et Sylvère Lotringer, un professeur d’université, venu de New York, 56 ans, dînent avec Dick****, une bonne connaissance de Sylvère, dans un bar à sushis de Pasadena. Dick est un critique culturel anglais revenu de Melbourne pour s’installer à L.A. (...) » Chris veut se détacher de son être-en-couple, et l’affiche volontairement. Au cours du repas, elle a remarqué – ou du moins, elle a eu l’impression – que Dick ne la quittait pas des yeux. Sortis tardivement du restaurant, le temps étant menaçant, ils vont passer la nuit chez lui qui les y convie puisqu’il habite non loin. Lorsqu’ils repartent le lendemain matin, Chris est tombée amoureuse de Dick, persuadée d’une rencontre intime entre Dick et elle, d’une connexion secrète, ce qu’elle appelle une sorte de « baise conceptuelle ».
« 6 ou 8 décembre 1994, Mardi, mercredi et jeudi sont flous, ils passent sans laisser de traces. (...) Ils se lèvent à 8 heures, quittent Cresline et descendent la colline, prennent un café à San Bernardino, roulent quatre-vingt-dix minutes, de sorte qu’ils atteignent L.A juste après l’heure de pointe. Il est probable qu’ils parlent de Dick la plus grande partie du trajet. » Sylvère sentant sa femme toute excitée par ce coup de cœur qui l’excite aussi suggère à Chris d’écrire à Dick. Chris et Sylvère se disent tout : par jeu, Chris propose à Sylvère de faire de même.
Ainsi naît peu à peu une correspondance de l’un comme de l’autre, à l’intention d’un destinataire commun. Romancer un peu leur vie, sinon la pimenter, voilà ce qui les pousse tout à coup, pris au jeu de leur propre désir, à écrire à Dick, à se raconter ce qu’ils écrivent, à faire en sorte que Dick finisse par téléphoner, que Sylvère finisse par le prendre à témoin de l’excitation de sa femme pour lui, et lui fasse part de possibles retrouvailles à trois, voire d’un projet qu’il nommerait artistique où ils seraient – à la façon d’un événement à la Sophie Calle – tous les trois, partie prenante.
Dans un récit à la première personne, une femme, raconte son désir obsessionnel et à sens unique pour un critique d’art du nom de Dick. Au fur et à mesure qu’elle se voit s’éloigner de son mari – lui-même intellectuel et universitaire – prendre la route à travers les États-Unis, elle comprend que tout n’est que prétexte à un voyage intérieur, à une réflexion : quel rôle joue une femme, quelle place a-t-elle dans son couple, dans le monde ? Constat pur et simple de la revendication féministe d’une femme qui s’affirme dans un monde d’hommes et en évoque aussi la difficulté, dans un milieu comme celui de l’art, du cinéma, de l’écriture, où les femmes sont souvent vues comme secondaires sinon par rapport aux hommes.
La deuxième partie du roman nous entraîne avec Chris dans sa traversée des États-Unis, seule en voiture. Elle veut revoir Dick, le poursuit de ses assiduités, le harcèle. Plaidoyer pour les femmes artistes ou amoureuses, si peu comprises, sinon dans un rapport aux hommes qu’elles épousent ou du moins, dans l’entourage desquels elles vivent.
L’auteure, par ailleurs éditrice d’une maison d’édition indépendante qui publie des écrits de femmes à la première personne et qui y fait paraître le roman pour la première fois en 1997 – confiait, en préambule, que I love Dick avait fait figure de livre précurseur, que les années durant lesquelles elle avait elle-même vécu, puis écrit l’histoire de I love Dick avaient été exaltantes, parce qu’elle y avait trouvé la source de tous ses écrits à venir. Éd. Flammarion, 2016, 272 p., 20 €. Corinne Amar
Joana Preiss et Olivier Martinaud lisent I love Dick
de Chris Kraus le 30 juin 2019 à 14h30 à Chapelle des Carmélites, Toulouse.
Programme Marathon des Mots
La lecture est soutenue par la Fondation La Poste
Viet Thanh Nguyen, Le sympathisant. Traduit de l’anglais (États-Unis) par Clément Baude.
C’est un récit à la première personne ; la confession d’un agent secret. C’est un roman d’espionnage et de guerre, un roman politique, en même temps qu’une réflexion sur l’héritage de la guerre du Vietnam, l’Histoire et ses engagements idéologiques, la violence, les compromissions, le mensonge, la trahison, la conscience, les amitiés aussi. C’est un roman qui nous emmène du Saïgon chaotique des années 1975, au Los Angeles des années 1980, via un narrateur aux ambiguïtés annoncées dès le premier paragraphe de la première page ; il est une taupe, un agent secret, un homme au visage double, en somme, un « sympathisant ». On ne connaîtra pas son nom, celui qui entreprend ainsi de raconter sa vie en un long aveu, alors qu’il est emprisonné et qu’on en ignore encore la raison. On sait toutefois qu’il est né des amours interdites d’un prêtre français et d’une Vietnamienne, et que Saïgon étant sur le point de tomber, il décide de fuir vers les États-Unis accompagnant le général de l’armée sud-vietnamienne en tant que son conseiller alors qu’en réalité, il est un agent communiste infiltré. C’est un roman qui résonnera, tout au long de ses pages, par ses personnages secondaires et ses rebondissements, comme un cri violent d’humanité pour les combattants des deux camps, une histoire ample et soucieuse de redonner à chacun sa vitale dignité. « Je suis un espion, une taupe, un agent secret, un homme au visage double. Sans surprise peut-être, je suis aussi un homme à l’esprit double. Bien que certains m’aient traité de la sorte, je n’ai rien d’un mutant incompris, sorti d’une bande-dessinée ou d’un film d’horreur. Simplement, je suis capable de voir n’importe quel problème des deux côtés. » Un dédoublement perpétuel qui mènera notre héros jusqu’en Californie, devenu conseiller technique d’une superproduction hollywoodienne sur la guerre du Vietnam tournée aux Philippines où des figurants des deux camps rejouent la guerre. « Comme toujours, l’argent régla le problème. Sur mes conseils appuyés, Violet accepta de doubler le salaire des figurants qui joueraient des vietcongs, ce qui permit à ces combattants de la liberté d’oublier qu’incarner ces autres combattants de la liberté leur avait tant répugné. (...) Le plus grand, le sous-officier le plus gradé, un sergent dit, il veut qu’on torture ce type et qu’on ait l’air de s’amuser c’est ça ? Le plus petit des figurants demanda, Mais quel rapport avec être naturel ? (...) Tout OK, répondit le grand sergent. Nous pas de problème. Nous meilleurs. On est des fils de putes de vietcongs. Compris ? Ils comprirent, et plutôt deux fois qu’une. C’était la méthode Stanislavski dans toute sa splendeur. »
C’est un prodigieux récit de guerre, d’espionnage et d’exil, un premier roman couronné du Prix Pulitzer, dont tous les critiques s’accordent à dire qu’il est magistral.
L’auteur, Viet Thanh Nguyen, né en 1971 à Buôn Ma Thuôt, au Sud-Vietnam, dans un pays en pleine débâcle, boat-people à l’âge de quatre ans, contraint avec sa famille de partir, de fuir la ville sur un bateau. Moult péripéties avant d’arriver aux États-Unis pour y vivre, avant de rejoindre la communauté vietnamienne de Los Angeles. Souvenirs de guerre, de troubles identitaires propres aux réfugiés, de traumatismes prégnants. L’auteur dira qu’aujourd’hui la majeure partie de son travail d’écrivain consiste à explorer la frontière entre ce dont il se souvient, ce dont il croit se souvenir, et ce qu’il a complètement oublié. Un travail de mémoire intime et salvateur, qu’il renouvelle avec un recueil de nouvelles cette fois-ci, à paraître à la rentrée littéraire de septembre 2019, chez le même éditeur : Les Réfugiés. Huit nouvelles, sur la Californie des années 1980, les fantômes (parce qu’ils sont hors du temps), le drame des boat-people, la mort, « l’âme vietnamienne », le souvenir, à ne jamais oublier... Éd. Belfond 2017, 490 p., 23,50 €. Corinne Amar
Emmanuel Noblet lit Le sympathisant
de Viet Thanh Nguyen le 30 juin 2019 à 14h30
Salle du Sénéchal, Toulouse
Programme Marathon des mots
Erwan Desplanques, L’Amérique derrière moi.
Le jour de Noël, le narrateur apprend que son père, âgé de soixante-dix ans, est atteint d’un cancer des poumons incurable. Deux jours plus tard, sa femme lui annonce qu’elle attend un enfant. « Il ne m’échappait pas que ces deux horizons cohabitaient, se fondaient l’un dans l’autre, et qu’il me faudrait suivre deux croissances simultanées, celle d’une tumeur et d’un embryon qui aboutiraient aux résultats opposés, une mort et une naissance, deux réalités jumelles circonscrivant la totalité du spectre et qui, avec la célérité d’un tour de passe-passe, signeraient la disparition d’un père et l’apparition concomitante d’un fils. » La maladie du père et la perspective de sa perte occupent tout l’espace mental du fils, le ramènent au passé, à la nature de leur relation, à celle tissée avec le grand-père maternel, psychiatre, prisonnier pendant la guerre du Stalag XVII A en Autriche. Après un premier roman (Si j’y suis, 2013) et un recueil de nouvelles (Une chance unique, 2016), Erwan Desplanques, ancien journaliste à Télérama, fait ici le portrait d’une famille fantasque, la sienne. Avec pudeur, tendresse, lucidité et humour, il livre des bribes de son enfance et de son adolescence à Reims, décrit le couple volcanique puis harmonieux formé par ses parents. Il raconte les derniers moments de son père, l’impuissance des proches, l’incapacité des hommes de cette famille à exprimer leurs sentiments. Son père ancien militaire devenu assureur, était fasciné par les États-Unis et la guerre. Né en 1943, il aurait aimé être un héros américain, collectionnait les armes à feu, embarquait sa famille le samedi à bord de sa Jeep Willys ou de son Dodge, écrivait à ses proches en anglais, choisissait ses vêtements et ceux de ses deux fils dans des surplus de l’armée et présidait le comité de jumelage entre Reims et Arlington en Virginie. « Les États-Unis incarnaient à ses yeux la possibilité de s’inventer, de bâtir ses propres fictions. C’était une terre de conquête, de résilience, de progrès. » Entre décryptage des mythes familiaux, désir de changement, dernier souffle de son père et premier contact charnel avec son fils, le romancier trace une ligne de réflexion sensible porteuse d’un nouvel horizon. Éd. de l’Olivier, janvier 2019. 176 p., 16 €. Élisabeth Miso
Article publié dans le numéro 201 de FloriLettres (Rubrique « Dernières parutions », février 2019)
Rencontre avec Erwan Desplanques, animée par Pascal Alquier
le 27 juin 2019 à 18h.
Médiathèque Grand M - Toulouse
Pierre-François Garel lit L’Amérique derrière moi d’Erwan Desplanques
le 28 juin 2019 à 16h30
Espace diversités laïcité - Toulouse
Programme Marathon des mots
James Baldwin, Chroniques d’un enfant du pays. Nouvelle traduction de l‘anglais (États-Unis), Marie Darrieussecq.
« L’histoire du Noir en Amérique est l’histoire de l’Amérique – ou plus précisément, est l’histoire des Américains. » Dans ces essais parus en 1955 et rédigés entre vingt-quatre et trente ans, James Baldwin s’attaque aux mythes, aux préjugés, aux non-dits, aux peurs et aux fantasmes raciaux qui nourrissent la violence et les injustices de son pays. Scrutant la littérature, le cinéma, la presse, la religion, la politique, il décortique une histoire de l’Amérique édifiée sur la question raciale et s’interroge sur ce que signifie être Noir à l’intérieur de ses frontières. Il fustige la perception caricaturale des Blancs, leur aveuglement à envisager la communauté noire comme un problème social et non humain et n’épargne pas plus les Noirs qui se détournent de leur héritage par désir d’intégration. Quiconque se coupe de ses origines et de son histoire passera inévitablement à côté de lui-même. « Notre déshumanisation du Noir est ainsi indissociable de notre déshumanisation de nous-mêmes ; la perte de notre propre identité est le prix que nous payons quand nous anéantissons la sienne. » La puissance du livre tient aux subtiles passerelles jetées entre son implacable analyse des mécanismes et des contradictions de la société américaine et son expérience intime, aux résonances entre trajectoire et lutte personnelles et histoire collective. « (…) il ne faut jamais, dans sa propre vie, accepter les injustices comme une banalité mais il faut les combattre de toute sa force. Or ce combat commence dans le cœur, et sur moi reposait désormais la charge de protéger mon propre cœur de la haine et du désespoir. » Aîné d’une fratrie de neuf enfants, l’écrivain a grandi à Harlem et a très tôt pris conscience des tensions entre Blancs et Noirs, de sa propre terreur et de sa révolte. Il évoque sa relation à son père, un pasteur rigide, amer et paranoïaque, et sa mort survenue pendant les émeutes d’Harlem en 1943 ; relate le voyage à Atlanta de deux de ses frères censés se produire avec leur ensemble vocal lors de la campagne du candidat Wallace en 1948 et leur désillusion face aux mentalités faussement progressistes. Il se remémore les humiliations racistes subies dans le New Jersey et le réel danger que représentait alors sa propre rage, l’oxygène de sa vie en France malgré le manque d’argent et un épisode carcéral à Fresnes. James Baldwin, par sa redoutable acuité, la force de son engagement civique et artistique, sa noblesse d’âme, s’inscrit parmi les figures les plus remarquables de la littérature du XXe siècle. Éd. Gallimard, Du monde entier, 224 p., 20 €. Élisabeth Miso.
Article publié dans le numéro 203 de FloriLettres (Rubrique « Dernières parutions », avril 2019)
Alex Descas lit Chroniques d’un enfant du pays de James Baldwin
le 28 juin 2019 à 17h
Théâtre de la Cité - Toulouse
Programme Marathon des Mots