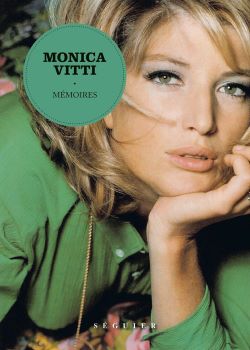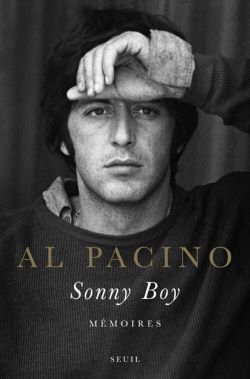Romans
Martino Gozzi, Le Chant de la pluie. Traduit de l’italien par Vincent Raynaud. Dans la famille de Martino Gozzi on ne parle jamais ni des morts ni de ses émotions. En 2018, il perd son meilleur ami, Simone, emporté par une leucémie à moins de quarante ans. Les questions récurrentes de sa fille de trois ans à son sujet, l’obligent à faire le portrait de cet ami bassiste qui lui a appris tant de choses « sur la musique, le bonheur et la beauté de cette fuite en avant, si brève et si longue, qu’est la vie. » Ils étaient toute une bande soudée depuis leur jeunesse, que la mort de Simone a profondément ébranlée. Le romancier, traducteur et directeur de l’école Holden à Turin, se penche sur cette amitié lumineuse, cette « sorte d’immense champ gravitationnel » qu’était Simone pour lui. Son récit navigue entre passé et présent, entrelaçant des souvenirs de jeunesse, la maladie de Simone, la fin de son histoire d’amour avec sa femme et une réflexion sur le pouvoir de l’écriture. Entre Martino et Simone, depuis leur adolescence, la musique a toujours été un point d’ancrage de leur complicité, et le roman en est imprégné tout entier. L’écrivain décrit le courage de son ami et de sa compagne face à la maladie, sa propre impuissance et l’angoisse qui l’étreint à l’idée de l’issue inéluctable. Quand une psychothérapeute de l’hôpital de Bologne, où est soigné Simone, le sollicite pour animer un atelier d’écriture pour de jeunes cancéreux, il pressent qu’il va vivre une expérience révélatrice. Par les extraits de livres qu’il choisit, par la qualité de ses échanges avec les jeunes participants, il leur fait entrevoir cette fonction essentielle de l’écriture : « mettre des mots sur ce que nous ressentons ». Avec Le Chant de la pluie, Martino Gozzi signe une magnifique déclaration d’amour à son ami disparu et rend compte de son cheminement intérieur pour ne plus redouter ses propres émotions. « On écrit peut-être tous dans l’illusion de sauver quelque chose. Ceux qui nous ont quittés, leurs gestes. Les lieux où nous avons vécu et où il ne reste plus personne. » Éd. La table Ronde, 224 p., 22 €. Élisabeth Miso
Mémoires
Monica Vitti, Mémoires. Traduit de l’italien par Florence Rigollet. « Quand j’ai pris la décision, à quatorze ans et demi, de m’arrêter de vivre, j’ai compris que je ne pourrais m’en sortir qu’en faisant semblant d’être une autre et en faisant rire le plus possible. » Dans ses Mémoires parus en deux volumes dans les années 1990 et aujourd’hui traduits en français, Monica Vitti (1931-2022) dévoile son besoin viscéral de se fondre dans des personnages, ses passions, ses peurs, les êtres qui ont compté. Elle a grandi en Sicile, à Naples puis à Rome, a dû veiller seule sur sa mère malade, à dix ans, pendant la guerre. Son enfance a été une période douloureuse. En tant que fille, tout lui était interdit, ce qui ne l’empêchait pas de suivre son intrépide frère Giorgio partout. Le silence des adultes, face aux questions qui l’assaillaient, a installé une angoisse qui allait la poursuivre toute sa vie. Elle décide de devenir comédienne contre l’avis de ses parents, entre au Conservatoire puis débute au théâtre. En quatre films, L’Avventura (1960), La Notte (1961), L’Éclipse (1962) et Le Désert rouge (1964), Michelangelo Antonioni impose sa beauté inédite, son jeu troublant et énigmatique. « Il m’écoutait et me regardait vivre avec une attention que je n’avais jamais reçue. C’est une fierté si j’ai pu servir à ses films. » Exceptée sa rencontre décisive avec Antonioni, elle ne s’attarde guère sur sa trajectoire professionnelle. Son talent s’est illustré dans les drames et les comédies de Dino Risi, Ettore Scola, Mario Monicelli ou Franco Rosi. Luis Buñuel a insisté pour tourner avec elle, fasciné par sa « façon étrange et érotique de regarder les choses, de les toucher. » Avec une grande sincérité et infiniment d’humour, la star italienne évoque ses difficultés existentielles, ses peurs qui entravent son quotidien depuis son plus jeune âge, et l’équilibre qu’elle a trouvé auprès de son époux, le réalisateur Roberto Russo. Être actrice lui a permis d’échapper à la réalité, de s’oublier soi-même dans d’autres enveloppes que la sienne. « Bien jouer, ou au moins s’en sentir capable, c’est quand vous vous sentez enfin loin de tout, c’est-à-dire loin de votre vie. », écrit-elle. Éd. Séguier, 288 p., 22 €. Élisabeth Miso
Al Pacino, Sonny Boy, Mémoires. Traduit de l’anglais (États-Unis) par Nicolas Richard. À quatre-vingt-quatre ans, l’un des acteurs les plus emblématiques de l’histoire du cinéma se retourne sur son incroyable parcours. Né en 1940, Al Pacino passe son enfance et son adolescence dans le South Bronx, à New York. Outre sa famille sicilienne, son univers tourne autour de sa bande de copains avec laquelle il fait les quatre cents coups. Sa mère, qui lui a transmis sa passion pour le cinéma et qui l’a empêché de glisser dans la délinquance, souffre d’une fragilité psychique. Il est dévasté à sa mort, quand il a vingt-deux ans. Il fréquente la High School of Performing Arts à Manhattan, puis intègre le Herbert Berghof Studio et l’Actors Studio, tout en enchaînant quantité de petits boulots. Il se nourrit de cet enseignement stimulant, mais ne suit que son intuition et sa propre imagination. Malgré les difficultés, il est convaincu de percer comme comédien et s’accroche à son rêve, car pour lui c’est « l’unique façon de survivre en ce monde ». Il fait ses premiers pas sur les planches et les textes du théâtre de répertoire transforment sa vie, aiguisant sa capacité à plonger en lui-même pour y « exprimer ce qui s’y trouve ». Cet amour du théâtre ne l’a jamais quitté, au point de réaliser en 1996 un passionnant documentaire sur Richard III, la pièce de William Shakespeare. Dans les années 1960-1970, dans le sillage de James Dean, Montgomery Clift et Marlon Brando, un nouveau style d’acteur émerge qui révolutionne le 7ème Art. En 1971, Al Pacino explose au cinéma dans Panique à NeedlePark. Le Parrain (1972), Le Parrain 2 (1974), L’Épouvantail (1973) Serpico (1973) et Un après-midi de chien (1975) assoient sa légende. À trente-cinq ans, il est une figure incontournable du théâtre et du cinéma. La star américaine balaie ainsi plus de cinquante ans de carrière, convoque ses succès, ses périodes fastes, ses déboires financiers, son addiction à l’alcool et aux drogues, sa méfiance envers la célébrité, ses précieuses amitiés, ses relations amoureuses. Au fil des pages, se dessine un destin exceptionnel, porté par une énergie folle et un besoin insatiable de sonder par l’art les mystères de l’âme humaine. Éd. Seuil, 384 p., 27 €. Élisabeth Miso
Henri Raczymow, Variations pour Anna. Fervent admirateur de Proust, petit-fils d'émigrants juifs polonais arrivés dans les années 1920 à Paris, fils d'Etienne Raczymow, ayant appartenu aux FTP-MOI, l’auteur a souvent, dans ses livres, évoqué son passé, son enfance, son adolescence à Belleville où vivaient un grand nombre de Juifs qui parlaient yiddish ; un auteur attiré irrésistiblement vers le passé parisien de ses parents, de ses grands-parents, celui de ses aïeux quelque part en Pologne avant la Catastrophe. Renommer les morts et aussi les vivants, « sauver les noms », rechercher les traces presqu’effacées de quelqu’un, suivre son parcours et le réinscrire dans un livre, comme dans ces Variations pour Anna. Ici, il rend hommage à la figure d’Anna, sa mère, par de courts chapitres formant une sorte de kaléidoscope. Par petites touches, il fait revivre les relations qu’il eut avec elle. « J'ai pensé qu'il était encore temps, après tout, d'infléchir l'image que j'avais toujours eue de ma mère et celle que j'avais parfois laissé entrevoir dans mes livres. C’est que nous ne nous étions jamais bien entendus, elle et moi, ni dans mon enfance, ni dans ma jeunesse, ni du temps où elle fut malade et où j'aurais dû, au moins par humanité, me rapprocher d'elle. » Cette femme simple, aux traits singuliers, dont il dit qu’il ne l’a jamais vraiment comprise, enjouée, timide, colérique, jalouse et aussi, coquette, possessive, émotive, était née en Pologne. Mais la grande affaire, pour elle, ce fut l’Occupation dont elle ne parlait pas. « De même que mon père ne parlait jamais de sa mère, Rywka, déportée à Auschwitz en juillet 1942 ». Anna avait, entres autres frayeurs, la phobie des trains, symbole de la déportation. De cette période, elle retenait aussi le souvenir des épisodes marquants d’une assignation à résidence avec ses parents dans un coin perdu de Charente. En vingt-trois chapitres aux titres brefs, l’auteur recompose toute l’ambivalence du regard porté sur sa mère, héroïne humble et épouse d’un authentique résistant. Éd Gallimard, Haute enfance, 107 p., 15,90 €. Corinne Amar