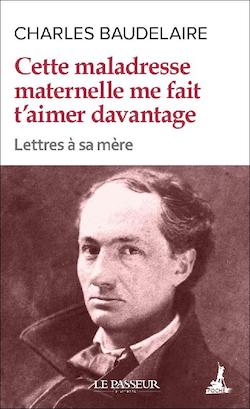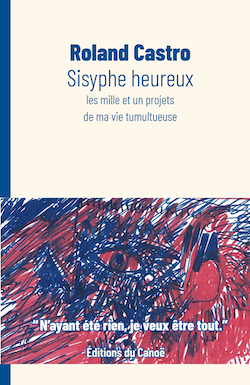BIOGRAPHIES
Camille Larbey, Marlene Dietrich, Celle qui avait la voix. Marlene Dietrich a très tôt mesuré l’immense pouvoir de séduction de sa voix rauque et cajoleuse. Elle a ainsi toujours affirmé avoir entamé sa carrière d’actrice en 1930 avec L’Ange bleu, reléguant aux oubliettes la quinzaine de films muets où elle était apparue auparavant. « S’il n’y avait rien d’autre que sa voix, elle pourrait s’en servir pour briser votre cœur », a écrit son ami Ernest Hemingway dans Life en 1952. Le journaliste Camille Larbey retrace la trajectoire de la star à l’aune de cette voix inimitable. Issue d’une famille bourgeoise, la jeune aspirante comédienne veut se faire un nom dans le Berlin du début des années 1920, marqué par l’inflation. Elle commence à chanter dans les cabarets et court les auditions. On la trouve séduisante mais dénuée de talent. En 1929, le réalisateur austro-américain Josef von Sternberg de la Paramount, débarque à Berlin dans les studios de la UFA pour diriger L’Ange bleu, le premier film sonore allemand. Il tombe sous le charme de cette jeune actrice qu’il impose dans le rôle de Lola-Lola. La Paramount, qui voit en elle une personnalité de taille à concurrencer « la Divine » Greta Garbo de la MGM, lui offre un contrat. Avec son nouveau look aux joues creuses, aux sourcils redessinés et aux cheveux blond platine, elle explose dans les films de Josef von Sternberg, Morocco (1930) et Agent X 27 (1931). « Le Mythe » Dietrich est né. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle part en tournée en Europe et chante pour distraire les GI’s, apprenant au passage quelques recettes infaillibles pour conquérir un public auprès de Dany Thomas, un artiste de music-hall de Chicago. On a prêté à Marlene Dietrich un grand nombre d’aventures sentimentales. Elle a entretenu avec son mari Rudolf Sieber, le père de sa fille Maria, une vie de couple très libre et n’a jamais divorcé. Jean Gabin, à qui elle fut liée de 1941 à 1948, reste à ses yeux son seul grand amour. Après le déclin de son aura sur grand écran, sa voix, encore, lui permet en 1953 de débuter une carrière de music-hall et ce pendant plus de vingt ans. En parallèle de ses films, sa voix résonnait régulièrement sur les ondes américaines. Elle rejouait pour la radio certains de ces rôles phares, participait à des sketchs ou aux shows radiophoniques de Dean Martin et Jerry Lewis. Elle a fini sa vie recluse dans son appartement parisien de l’avenue Montaigne, cachant aux yeux du monde l’empreinte du temps sur son visage de légende, offrant encore par téléphone le timbre si singulier de sa voix. Éd. Capricci, 112 p., 11,50 €. Élisabeth Miso
CORRESPONDANCES
Charles Baudelaire, Cette maladresse maternelle me fait t’aimer davantage. Lettres à sa mère. « Je n’ai que ma plume et ma mère », écrit Baudelaire à son tuteur le 5 mars 1852. À cette mère, Caroline Dufays, plus célèbre sous le nom de Mme Aupick, dont il fut séparé tout enfant, alors qu’il perdait son père, mort quand il avait cinq ans, à cette mère qui fut son seul amour comme Charles fut le sien, il ne parle à vrai dire, dans cette correspondance qui les lie, jamais de poésie ou d'art mais d’argent : toujours en manque et croulant continuellement sous les dettes, c’est à elle qu’il se plaint de ses soucis matériels, de ses problèmes du quotidien. Elle est à Honfleur où elle aimerait le voir définitivement s’installer, mais il préfère vivre à Bruxelles. Il l’aime et la déteste – reproches constants et remords de ces reproches. « Tu es dans une jolie habitation, et tu ne vois personne. Moi, je n’ai pas de livres, je suis mal logé ; je suis privé d’argent, je ne vois que des gens que je hais, et tous les matins, je vais palpitant chez la concierge pour savoir s’il y a des lettres, si mes amis s’occupent de moi, si mes articles paraissent, s’il y a de l’argent. » Un Baudelaire plaintif qui veut faire croire que les seules lettres qu’il reçoit sont celles des créanciers de Paris, les seuls gens à s’intéresser à lui. Quand il ne lui réclame pas d’argent, il veut qu’elle lui envoie des livres, ou encore et toujours, de l’amour comme un dû. Il évoque un livre à écrire comme une malédiction, des conférences à venir, ce qu’il doit de nuits à son hôtel ou de dettes à un cordonnier ; l’avenir est horrible, et il a besoin d’elle pour subvenir à ses dépenses, si petites qu’elles soient. De temps en temps, maigre consolation, le fils indigne demande à sa mère de ses nouvelles. « Je t’aime bien, écris-moi si tu peux, quelques lignes ». Avec une préface de Michel Schneider. Éd. Le Passeur, 125 p., 5,90 €. Corinne Amar
ROMANS
Annie Lulu, La mer Noire dans les Grands Lacs. Assise sur les bords du lac Kivu à Bukavu en République démocratique du Congo, Nili, la narratrice, s’adresse à son enfant qui va naître. Elle tient à ce qu’il sache d’où il vient, dans quelle histoire familiale il va s’inscrire. Elle ne veut pour son fils ni du terrible silence, ni de la dureté maternelle contre lesquels elle s’est cognée durant toute son enfance. Elle veut l’assurer de tout son amour et lui dévoiler sa longue errance personnelle avant de se sentir enfin vivante, ici au Congo, malgré la guerre civile qui sévit et la perte de l’homme qui la faisait palpiter. Nili a vu le jour en 1989, à Iasi en Roumanie. Elena Abramovici, sa mère roumaine étudiait la littérature, Exaucé Makasi Motembe, son père congolais, les mathématiques. Ce dernier a dû quitter subitement le pays à la chute de Ceausescu. Nili a grandi en maudissant chaque jour son père de l’avoir abandonnée « dans ce vieux coin pourri de l’Europe », la laissant endurer sans sa protection « (…) ce que c’est qu’être le rare enfant d’un Noir dans une province du monde où la lune est encore pleine de pogroms. » Avant de sortir, sa mère lui bouchait les oreilles avec du coton pour qu’elle n’entende pas les insultes racistes qui fusaient sur leur passage. Toute sa scolarité, elle a été harcelée par les autres enfants. En rupture avec sa famille, sa mère, devenue professeure de lettres à la faculté de Bucarest, l’a élevée seule dans le culte du mérite intellectuel, incapable de la moindre tendresse. Son obsession de la propreté reflétait l’étendue de son sentiment de honte et de ses regrets. « Elle était triste d’être une femme et elle avait peur que j’en sois une aussi. Alors elle nous lavait toutes les deux incessamment de la tache de m’avoir mise au monde. » À six ans, Elena la roue de coups, quand elle se risque à demander où se trouve son père. « J’aurais dû te noyer quand t’es née, j’aurais dû t’écraser avec une brique », enrage-t-elle. Elle lui a toujours caché les lettres qu’Exaucé leur écrivait et dont des extraits jalonnent le récit. À vingt-cinq ans, la narratrice part au Congo, en quête de ses racines africaines et de son père et trouvera sa place en ce monde. Sans être véritablement autobiographique, l’impressionnant premier roman d’Annie Lulu, née à Iasi d’une mère roumaine et d’un père congolais, s’est nourri de ses propres origines et de son intérêt pour ce qui se transmet de génération en génération par le biais de la langue et l’imbrication de cultures multiples. Éd. Jullliard, 224 p., 19 €. Élisabeth Miso
Nashiki Kaho, L’été de la sorcière. Traduction du japonais Déborah Pierret-Watanabe. La mort de sa grand-mère est un véritable choc pour Mai. Dans la voiture qui les conduit elle et sa mère jusqu’à la maison de la défunte, la jeune fille se remémore son dernier séjour chez cette grand-mère anglaise tant aimée, surnommée la Sorcière de l’Ouest. « Les odeurs ressurgirent au creux de ses narines, celles de la maison et du jardin, la lumière, la sensation du vent qui lui caressait la peau… plus que de souvenirs, c’était comme si son corps tout entier était brusquement ramené dans le passé, comme aspiré en arrière par une force incroyable. » Deux ans auparavant, alors qu’elle traversait à treize ans un épisode de phobie scolaire, ses parents l’avaient confiée à sa grand-mère maternelle durant un mois. Dans cette maison de montagne, au contact de la nature et de cette vieille dame affectueuse et lumineuse, l’adolescente s’apaise et confie ce qui la trouble ou la terrifie, comme de savoir ce que l’on devient après la mort. Sa grand-mère lui explique que les blessures de l’existence ne sont pas mortelles et qu’il faut apprivoiser l’idée de la mort pour vivre pleinement. Elle lui raconte qu’enfant, fascinée par le récit du voyage au Japon de son grand-père, elle a rêvé de ce pays, s’y est installée en allant y enseigner l’anglais et y a rencontré son mari japonais. Elle lui parle aussi des visions de sa propre grand-mère. Mai se demande si elle a hérité de ces pouvoirs surnaturels. Durant ces semaines auprès de son aïeule, elle va apprendre à exercer sa force mentale, à mieux gérer ses émotions, son anxiété, à ressentir les bienfaits de la nature, à connaître quelques secrets des plantes, à savourer une multitude de plaisirs simples. Sa grand-mère lui offre un endroit de son choix dans sa propriété, un bout de terre rien que pour elle. Mai est séduite par un coin où trônent de vieilles souches d’arbres entre des bosquets de cèdres et des bambous. « La lumière du soleil, l’humus tendre recouvert de feuilles sèches, les jeunes arbres aux feuillages d’un vert éclatant qui l’encerclaient comme pour la protéger… Tout cela, elle l’aimait de tout son cœur. » À travers sa jeune héroïne, Nashiki Kaho rend un vibrant hommage à sa grand-mère, à tous ces éclats d’amour et de beauté qu’elle a déposés à jamais en elle. Éd. Picquier, 168 p., 18 €. Élisabeth Miso
AUTOBIOGRAPHIES
Roland Castro, Sisyphe heureux, Les mille et un projets de ma vie bâtisseuse. « Dans ma jeunesse, il y avait Lacan et il disait « d’où tu parles ? » D’où parlé-je ? Je parle d’un môme dont le premier voyage est l’exode dans le ventre de sa mère en 1940. Je parle d’un tout petit Juif sauvé avec mon père, ma mère et ma sœur par les maquis communistes du Limousin et les habitants de Saint-Léonard-de-Noblat. Ça m’a laissé une dette imprescriptible à la République. N’ayant été rien, je veux être tout. » Un père juif grec, une mère juive espagnole, une naissance un 16 octobre 1940, à Limoges, Roland Castro est cet architecte de formation reconnu, penseur de la ville qui fit de l’habitat un enjeu majeur, et militant politique acharné, notamment pour des espaces urbains vivables pour tous. Il est aussi et surtout ce jeune idéaliste à l’énergie folle qui voulait être tout à la fois : architecte célèbre, écrivain, peintre, philosophe, homme politique, saltimbanque, poète, et qui réussit à incarner ce tout. C’est à lui qu’on doit, entre autres grands projets urbains, une réflexion autour du Grand-Paris et la défense de l'implantation de hauts lieux symboliques de la République et de la culture dans le but de redonner de l'intensité et de la beauté à la banlieue. Dans une autobiographie où la confidence sonne juste parce qu’elle vient de l’essence même de l’être, à l’heure où la psychanalyse et Lacan sont une rencontre décisive dans sa vie, l’auteur évoque tous ces souvenirs marquants qui l’ont fait devenir ce qu’il est et comprendre comment une enfance de petit Juif persécuté pouvait influer sur un fort sentiment adulte de révolte à l’encontre de toute pratique colonialiste ou encore, d’une volonté farouche de projets urbains humanistes. Car l’architecture n’est pas sans rappeler un sport de combat, et Sisyphe, condamné à faire rouler éternellement jusqu'en haut d'une colline ce rocher qui en redescend chaque fois, est un homme qui se retourne, debout et heureux. Éd. du Canoë, 144 p., 18 €. Corinne Amar